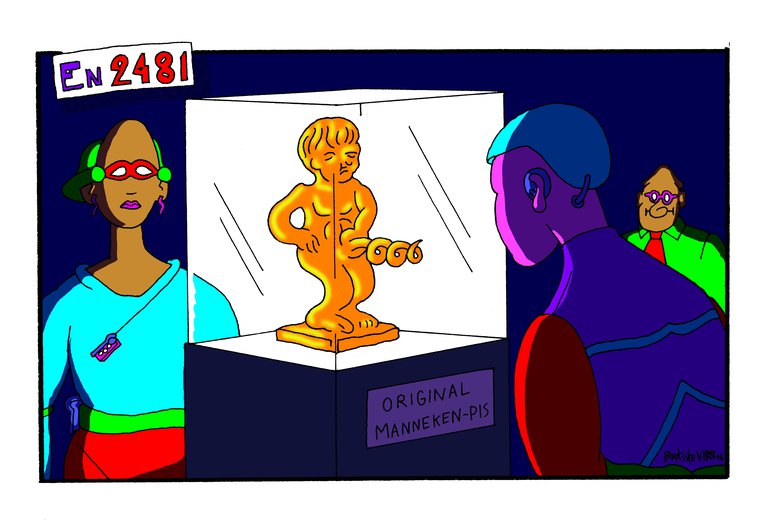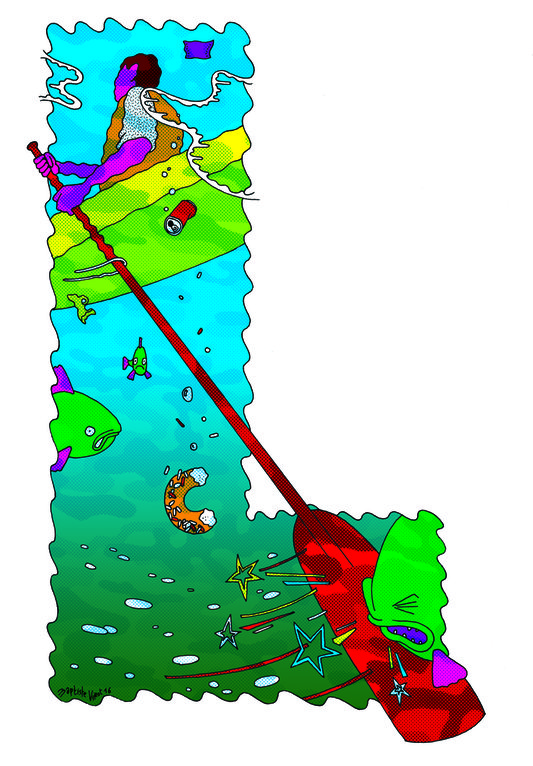Passeuses de mondes
Enquête (CC BY-NC-ND) : Quentin Noirfalisse
Publié le

Margarida est psychologue. Valeria est éducatrice. Elles ne viennent pas de Belgique, mais c’est ici qu’elles creusent leur sillon, dans un centre d’accueil de la Croix-Rouge au profil un peu spécial. Chaque jour, elles aident des demandeurs d’asile en souffrance mentale à affronter les traumas nés de la violence, du fracas des bombes et des épines féroces de l’exil.
Il fallait se rendre à l’évidence : son pays était à bout de souffle. À court de promesses pour elle, qui était à la tête d’un centre d’accueil pour mineurs placés par le juge à Lisbonne. La crise passant, on sabre dans le budget des asbl. Elle le sait : à son âge elle ne va jamais retrouver de travail. Margarida Silva a 52 ans et elle fait ses valises, emporte avec elle ses cheveux blonds bouclés, son profond regard vert, une solide expérience de psychologue et son mari. Cap au nord. La Belgique, là où on n’a pas décapité tout le social. Première haie effacée : le chômage. Elle travaille dans une association d’activités extrascolaires. En août 2014, elle plonge ailleurs, dans un gros défi, qui se nomme en cinq lettres : CARDA. Centre d’accueil rapproché pour demandeurs d’asile. Le seul en Belgique. Un « cocon » où des psychologues et des éducateurs façonnent une piste thérapeutique pour des demandeurs d’asile en souffrance mentale. Un lieu avec des règles, des routines, des moments de crise, des bonds en avant, des régressions et, aussi, des dénouements heureux.
À l’époque, ce centre ouvert par la Croix-Rouge se trouve à Yvoir. Margarida s’occupe du suivi psychologique des mineurs étrangers non accompagnés. Les MENA, comme on les raccourcit dans la sphère de l’asile. Elle n’oubliera jamais son premier entretien. « Il s’appelait Issa et avait passé toute sa vie dans un petit village malien. Il n’avait jamais utilisé une montre. Le soleil lui permettait de se repérer dans le temps. Il était analphabète mais débordait d’intelligence. » Margarida le découvre dans un état de stress post-traumatique profond.
« Chez Issa, c’était la guerre. Son papa avait des contacts avec des militaires du gouvernement. Il faisait du trafic d’armes. Un jour, il a été assassiné par une milice. Le lendemain, les mêmes milices sont venues pour assassiner ses frères, éventrer sa maman, égorger un bébé de trois mois. Caché, il a assisté à tout, avant de s’enfuir. Il a pu entrer en contact avec une demi-sœur qui habitait au Sénégal et a pris la mer. Dans une cale, sans lumière. J’ai dû contrôler mes émotions en écoutant son récit. » Issa va rester un an à Carda. Margarida et l’équipe tentent de lui donner ce qu’il faut d’urgence. De l’affection, des premiers repères pour réussir à s’engouffrer dans une procédure d’asile dont il ne connaît rien. La réponse de l’administration sera négative. Le récit d’Issa n’entre pas dans le moule. « Ils ne croyaient pas qu’il était mineur. Lui, il disait simplement que c’était un jeune homme, qu’il était encore petit. Il ne savait pas donner les faits, les dates. »
Issa a reçu l’ordre de quitter le territoire, est devenu sans-abri à Bruxelles, a été récupéré par les services sociaux et a réintroduit une nouvelle demande d’asile. Margarida, elle, a continué son travail.
Valeria dans la tour de Babel
La Méditerranée engloutit des centaines de réfugiés, venus de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan, d’Érythrée, du Nigeria, d’Afrique de l’Ouest. C’était déjà le cas avant, mais cette fois, en septembre 2015, les médias s’y attardent. C’est que des milliers d’autres, épargnés par les courants, viennent chercher un refuge en Europe. La « crise migratoire » fait les gros titres – jusqu’à l’excès.
Carda, à l’étroit à Yvoir, déménage à Bierset, dans un grand centre d’accueil de la Croix-Rouge. Quarante résidents au maximum peuvent y vivre, dans un endroit bien à eux, mais à proximité d’autres demandeurs d’asile. Valeria Ancona décroche un CDD d’éducatrice en septembre. Son accent, doux et énergique à la fois, ne trompe pas : elle a quitté sa Sicile il n’y a pas longtemps. Après des études d’éducatrice à Palerme, elle a tenté l’Erasmus à Liège, réalisé un stage dans une maison de jeunes à Angleur. Sans perspective d’emploi dans son île, elle est revenue sur les bords de Meuse. Elle anime des enfants à Droixhe et fait ses armes dans le difficile secteur de l’Aide à la jeunesse à Oupeye.
Mais Valeria a envie de se frotter à autre chose. La voilà servie. Elle débarque à Carda en pleine crise de l’accueil. Des centaines de lits manquent. Le centre ouvre ses portes à des « non-malades ». « On a dû accueillir trente Irakiens la première semaine. » Valeria aide ceux qui ont besoin d’un « premier secours », d’un lit, d’une assiette chaude. En même temps, elle découvre les résidents dans cet endroit qui n’est surtout pas « un asile psychiatrique ». Elle plonge au cœur de la tour de Babel. Ici, on parle pachtou, albanais, dari, russe, arabe avec les dialectes en prime, farsi, kirundi, swahili, croate.
Triple trauma
Margarida fume une cigarette dehors, en discutant avec un jeune irakien, très maigre, qui parle plutôt bien anglais. Elle essaie de le faire rigoler, lui donne un léger coup de coude. Elle est comme ça, Margarida : le rapport thérapeutique ne s’arrête pas à la salle d’entretien et aux résidents dont elle est la psychologue « référente ». « Je travaille dans le paradigme de la bientraitance : il faut non seulement faire une intervention sur la psyché mais aussi sur le corps et sur l’aspect social. »
À Carda, il n’y a pas de statistiques précises sur les pathologies des résidents. Une chose est sûre : ils sont passés par la guerre, la fuite, les tortures parfois, le déracinement toujours. Au risque de répéter une évidence, Margarida précise : « Pour tout le monde, le parcours migratoire est très difficile. Il y a un trauma au pays, un trauma durant le parcours et puis le trauma du séjour dans un pays étranger où la procédure d’asile est inconnue. En plus, il n’y a pas toujours d’interprète lors du rendez-vous avec l’avocat qui va défendre le cas ou avec l’assistante sociale qui doit les renseigner. Ça angoisse encore plus. »
Le triangle des mots
Chez certaines personnes, qui pouvaient déjà souffrir de problèmes psychologiques au pays, ces traumas et leurs symptômes s’accumulent. « Le stress post-traumatique peut se signaler de multiples manières. Le sommeil devient chaotique, les troubles psychosomatiques s’entassent, on constate de l’activation neuro-végétative : tremblements, sensation constante de peur, hypervigilance. Les flash-backs se succèdent. Ici, on n’accueille pas des gens dans un état de décompensation psychiatrique : ceux qui peuvent venir ont déjà été vus par un psychiatre, ont un traitement et sont stabilisés. » Carda va lancer une « opération rapprochée » qui vise l’« ici et maintenant », comme le dit un document distribué aux collaborateurs du centre. La « durée de séjour à Carda est limitée et la fin de celui-ci peut arriver très brusquement ». Le résident peut essuyer un refus dans sa procédure et devoir quitter le pays. Ou partir du centre de son plein gré, du jour au lendemain.
Le résident et le psychologue se voient une fois par semaine. Entre eux, un interprète, transmetteur indispensable, s’intercale. Et c’est tout – pas question d’ouvrir la porte aux journalistes. « Comment ça se passe avec les interprètes ?, rigole Margarida. Ça prend plus de temps parce que, parfois, les messages ne passent pas correctement : l’interprète est un canal de communication qui reste humain. Ainsi, je ne parle que par phrases courtes et je vérifie dès le début si la communication entre interprète et patient est claire. J’essaie d’être objective dans mes questions et d’être attentive au non-verbal. Le non-verbal, ça permet aussi de voir si quelqu’un tente de se faire passer pour malade, croyant que ça va l’aider dans sa procédure. Et j’en ai vu qui construisaient des histoires comme des pros ! »
Parfois, des interprètes fondent en larmes en entretien, face à la violence du parcours des demandeurs d’asile. Alors, il faut s’arrêter, laisser du temps pour digérer, et reprendre en masquant ses émotions.
La tablette de Saïda, traductrice français-arabe qui vient en train depuis Bruxelles, abrite un précieux lexique de termes issus des dialectes ou du vocabulaire médical. Chaque jour, elle l’enrichit entre deux entretiens. Elle peut en enchaîner jusqu’à huit par jour. Lors d’une séance, un homme lui explique qu’il possédait quelque chose de précieux, là-bas, dans son Proche-Orient d’origine. Saïda ne comprend pas. Quand les mots atteignent leur limite, les gestes débarquent. Petit sourire en coin. Il parlait d’une vache, tout simplement. C’est moins agréable quand quelqu’un décrit comment il a vu des gens se faire écorcher.
Saïda se place toujours de façon à ne tourner la tête à personne. Elle ne restructure pas les phrases, parfois boiteuses, des résidents. Sa tâche est exigeante : après tout, c’est elle qui parle le plus pendant l’entretien. Au mois de septembre dernier, elle ne pouvait plus se concentrer. « Les mots les plus banals ne surgissaient plus. Je ne parle même pas du vocabulaire médical. » Au bord du burn-out, elle est partie s’isoler quelques semaines dans son village d’origine, à quarante kilomètres de Fès.
Reposée, Saïda continue à remplir sa mission de passeuse de mondes. Lorsqu’il n’y a pas de sens dans les paroles du résident, Saïda n’a d’autre choix que de le dire au psychologue. Il faut être inventif, souple avec la langue. Un jour, une jeune fille évoque des mangeurs de cerveaux. Signe de folie ? Souvenir atroce ? « C’était en fait une belle idée. Elle utilisait cette image pour parler des beaux parleurs. » Ceux qui essaient de grignoter les esprits des dames.
Natacha doit partir
Un dessin grandiose pend dans la salle d’expression artistique au rez-de-chaussée. Ils se sont bien amusés, les quatre enfants qui se sont couchés l’un après l’autre sur le papier avant de se colorier de mille couleurs, façon Jackson Pollock aux dents de lait. Valeria sourit. « Tu vois, la dernière, on dirait qu’elle a une forme de tête bizarre. C’est parce qu’elle avait un gros chignon sur la tête. » En quelques mois, Valeria a pris ses marques. Elle sait comment divertir les enfants mais aussi leur permettre de se développer et s’exprimer dans un contexte hors norme. Le plus souvent, ce sont leurs parents qui sont en thérapie. Pas eux. L’angoisse de l’inconnu n’en disparaît pas pour autant.
Natacha traîne dans la salle artistique, chipote aux crayons, l’air grave. Elle a 11 ans et ses parents suivent un parcours un peu houleux ici, avec une thérapie pas très fructueuse. Ils viennent de lui dire qu’il fallait faire ses valises. Ils ont reçu un avis négatif et doivent quitter le territoire. Elle, elle ne veut pas partir. Ses repères, son univers de jeu et d’apprentissage, c’est ici. Ce jour-là, elle a demandé à Valeria de quoi son avenir serait fait. Valeria ne peut pas répondre à la place des parents, mais doit rassurer, trouver les mots. « Protéger », comme elle dit.
Le cuisinier d’Al-Anbar
Toutes les deux semaines, l’éducateur évoque au cours d’un entretien avec le résident dont il est le référent ce qu’il a pu observer ou apprendre : anxiété, maux de tête, problème d’isolement, perte de cheveux, soucis d’alimentation ou d’hygiène. « Au début, on présente surtout le centre et on discute des ateliers auxquels le résident va participer », explique Valeria. Les ateliers font partie de la thérapie. Valeria a eu carte blanche pour créer les siens. Le jeudi après-midi, elle tient le vestiaire, où les résidents peuvent venir chercher des vêtements. Un conseil beauté peut recréer du lien. Le lundi, c’est l’atelier récupération, où les hommes, surtout, bricolent. Le mardi, Valeria s’accorde un peu de temps avec les femmes – juste elles, pour des questions d’orientation religieuse et parce qu’elles sont moins branchées bricolage – et leur propose une séance de relaxation pour « réveiller les corps », dans un lieu où les gens dorment beaucoup.
Un jeudi d’avril, Valeria fait le « tard ». La jonction entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit. Le jeudi, c’est aussi le jour où les résidents s’emparent de la cuisine. Aziz est aux fourneaux. Il a fui sa province irakienne d’Al-Anbar, un des bastions de l’État islamique, où il était cuisinier. Il s’en donne à cœur joie, découpe des fleurs dans des carottes, sculpte des concombres, malaxe des pois chiches, fabrique une mixture d’épices pour accompagner son hachis. Valeria le complimente, fait en sorte qu’il ait tout sous la main. « C’est un des rares moments où ils peuvent reprendre un contact concret avec leur culture. »
Ce soir, tout le monde n’appréciera pas le repas d’Aziz. Certains trient la nourriture, mettent les crudités à part. L’ambiance enjouée des cuisines ne peut pas cacher le mal-être que l’on combat ici. Heureusement pour Aziz, la plupart des résidents terminent leur assiette. Une vidéo virale partagée sur Facebook et des chatouilles au bébé d’une résidente dérident l’ambiance. Valeria vérifie que tous les couteaux de cuisine ont bien été remis dans les armoires fermées et part distribuer les piluliers.
L’objet du déni
Isabelle, la directrice, est partie vers un « nouveau défi professionnel », dans la santé. En quelques mois, plusieurs personnes ont abandonné leur boulot. Les métiers de l’accueil sont exigeants. Lessivants, presque, tant on doit y impliquer tout son esprit, son empathie et son ouverture à l’autre. Pour tenir le coup, Margarida joue la carte de la transparence. « Quand j’ai la sensation que je dois partager quelque chose, je prends un collègue dehors, je fume ma clope et je parle. Cela peut être vu comme une faiblesse, mais je ne pense pas qu’un psychologue doit rester neutre à la fin de la journée. »
À la maison, elle se met sur sa terrasse, regarde son jardin, avec un verre à la main. C’est plutôt son mari qui s’épanche sur son travail. Les amis avec qui elle pourrait parler de tout cela sont au Portugal. Margarida aussi est un peu déracinée. « Avant de dormir, je pense à ce que je peux faire en plus ou autrement pour les résidents. Mais je sais que si ça se passe toutes les nuits, attention, ce n’est pas normal. »
Une fois par mois, les collaborateurs du centre ont une séance de « supervision ». Il s’agit d’un moment où ils peuvent se livrer à un professionnel. C’est insuffisant, estiment Margarida et Valeria, qui situent leur idéal : avoir une coordination thérapeutique qui fasse de la supervision chaque semaine.
À force d’expérience, Margarida a développé une approche. « En fonction de ce qui tourmente la personne, la famille en danger, les séquelles mentales d’une bombe qui a explosé près d’elle, je travaille les angoisses du moment et j’identifie une hypothèse d’intervention spécifique. » S’il faut, elle varie les techniques. Elle associe des exercices de relaxation et de respiration à « des souvenirs positifs ». Ou alors elle tente des pratiques de thérapie narrative. « Évoquer les mémoires traumatiques, recréer un récit, la sensation d’un sursaut, d’un moment de terreur, d’une explosion peut redonner du sens, même si cela crée aussi de la souffrance et du stress. Je dis aux résidents d’accepter les émotions liées à ces moments-là, d’accepter la torture, les bombardements. L’objectif est de faire de la personne le témoin de quelque chose, quelqu’un qui peut partager ces événements, parler de ce qu’est l’humanité. Dans un état de stress post-traumatique, une des raisons du blocage, c’est justement le déni, la croyance que tout cela n’est jamais arrivé. »
Nouveaux départs
Monsieur Ahmed est journaliste. Il s’essaie à un ou deux mots d’anglais. Son média, à Bagdad, a été « explosé » par des milices. Il mime comment on a versé de l’acide sur le visage d’un de ses collègues. Dégaine son Whatsapp et montre son dos couvert des cicatrices issues d’une torture en règle, et des images de sa famille, qui se cache quelque part en Irak. Pour extérioriser le chaos qui grouille dans sa tête, Ahmed dessine. Il ne l’avait plus fait depuis les années 90. Des dessins sombres, où l’on voit un homme torturé au couteau, les mains pendues à une corde, ou une coupe de son cerveau en plein tohu-bohu. Et des dessins lumineux, même si toujours en noir et blanc, avec une pointe de rouge, par lesquels il remercie Carda pour l’accueil et esquisse un étang irakien où des canards sauvages s’envolent.
Valeria regarde dehors avec fierté. « Tu as vu la terrasse ? » Tiens, non. Avant, il n’y avait rien, à part des dalles grises et des arbres en bataille. Avec une association, Valeria et les résidents ont construit des meubles en palettes. Depuis septembre, on lui a confirmé son CDI et elle s’occupe désormais des personnes isolées – dont des hommes, avec qui le cadre est parfois plus difficile à installer. Les idées à long terme peuvent germer. Aller à la piscine le vendredi avec les femmes ? Il faudra gérer le rapport à leur corps, mais pourquoi pas. Ou bien construire cette bibliothèque qui lui tient tant à cœur.
Avant, Valeria pouvait partir de Carda avec la « boule au ventre ». Les crises des résidents laissent des marques. Aujourd’hui, elle maintient la distance et se nourrit des réussites. Il y a cette femme, venue de l’Afrique des Grands Lacs, qui était comme « un fantôme, là sans être là », et qui suit aujourd’hui un enseignement à distance pour obtenir son diplôme de secondaire. Ou ce jeune homme, originaire du Moyen-Orient, qui n’arrêtait pas de se scarifier et travaille désormais dans le bâtiment, après avoir signalé son envie d’apprendre le néerlandais.
Comme le dit Margarida : « C’est avant tout leur parcours, pas le nôtre. S’ils peuvent aller mieux, c’est parce qu’ils ont fait un effort pour changer. Nous ne faisons que pousser un peu. Voir quelqu’un qui dit qu’il est prêt pour quitter Carda, c’est ça notre récompense. »
C’est le plein automne, les nouvelles pour Monsieur Ahmed sont bonnes : avec son « dossier lourd », il a obtenu un avis positif. Il remercie Valeria, longuement et espère faire sortir sa famille de la clandestinité pour qu’elle la rejoigne.
Avant, dans sa vie sicilienne, Valeria a été à Lampedusa, où des amis avaient une maison. Elle a vu les demandeurs d’asile sur les plages, perdus dans les rues. « Je voulais les connaître, là-bas, et c’est ici que j’ai appris avec mes yeux qui ils étaient. J’ai rencontré des gens qui n’étaient pas ce qu’en disent certains médias. Des gens qui savent beaucoup, qui parlent plus de langues que des Européens, qui avaient un métier, une vie professionnelle importante. » Surtout, termine Valeria avant de me dire au revoir, la relation ne va jamais dans un sens. « Avec eux, une chose est sûre : tu vas apprendre plein de choses. »