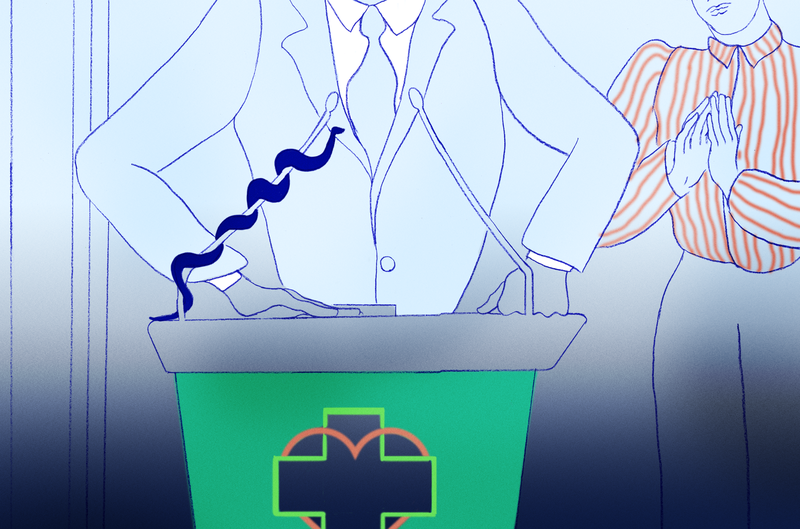- ép. 9
Les bodycams : ça marche. Ou pas.
S’équiper pour surveiller. Episode 2
Dans le premier épisode, nous avons appris que Namur a été la première zone de police francophone à installer la bodycam à grande échelle, en lui collant une bardée d’objectifs à remplir. Trop ? La ville de Montréal avait été une source d’inspiration. Au bout d’une phase de test, la ville québecoise publiait ses résultats, un an avant l’acquisition de 90 bodycams par Namur.
Cette investigation par épisodes est l’un des volets de notre grande enquête participative sur l’hypersurveillance à la belge.

Au Québec, on hésite encore. Après avoir injecté plus d’un million d’euros pour une phase pilote en bonne et due forme, on aurait pu s’attendre à ce que Montréal dise : on fonce, les gars. Eh bien pas du tout. En janvier 2019, un rapport sort. Pas un PowerPoint ficelé à la va-vite. Non. Un document de 235 pages qui explique dans les plus profonds détails la mise en place du projet.
À la page 185, le couperet de la conclusion tombe : « L’expérience du projet n’a pas permis de démontrer sans équivoque que les caméras portatives favorisent la transparence des interventions policières, consolident le lien de confiance entre le policier et le citoyen et assurent la sécurité des policiers. » C’était pourtant les objectifs principaux avancés au moment du lancement.
Souvent pris dans un « contexte d’urgence », les testeurs de Montréal ont généré des enregistrements vidéo fragmentaires de leurs interventions. Difficile, dès lors, de garantir la transparence totale proposée à la population si les vidéos ne sont pas complètes, estime le rapport.
Pas d’impact sur les interventions
Autre constat intéressant : les bodycams n’ont pas eu d’incidence sur « le nombre de cas d’usage de la force par les policiers ou sur le nombre d’entraves et de voies de faits commis par les citoyens à leur encontre. » Bref : à Montréal, la bodycams en mode test n’a eu « que très peu d’impact sur le déroulement des interventions policières ». Avec, quand même, des effets positifs, aux yeux de la police : la bodycam a été efficace pour collecter des preuves et donne un sentiment de protection juridique aux policiers, au cas où ils seraient poursuivis pour leurs actions.
Le coût d’un déploiement à grande échelle (11 millions d’euros) acheva de décourager la maire de Montréal. Un an plus tard, elle changea pourtant d’avis, suite à un vote de trois quartiers de la ville et une demande populaire. Il faut le préciser : au Canada, « les personnes indigènes et noires ont en moyenne cinq à dix fois plus de chances d’être arrêtées par la police », rappelle la Ligue des droits humains belge dans une note d’analyse sur les bodycams.
A-t-on lu ces conclusions, à Namur, avant d’engager la ville dans l’achat et la maintenance de 90 bodycams, en 2020 ? Le Commissaire Libois n’a pas répondu à cette question.
Les évaluations effectuées dans d’autres pays permettent d’aboutir à une conclusion : la bodycam, ça marche. Ou ça marche pas. Des études menées aux Etats-unis, aux Pays-Bas ou en Suisse tirent des enseignements radicalement différents. À la police de Washington, porter une caméra ou pas ne changeait rien à l’usage de la force.
Aux Pays-Bas et en Suisse, une désescalade de situations conflictuelle était constatée. Mais côté batave, la bodycam a surtout été introduite pour contrebalancer les vidéos des interventions prises par les citoyens (ce que la police appelle « l’équiveillance »). Comme le souligne une étude de Bits of Freedom et l’Université de Groningue, dans les faits, le fait que le policier décide ce qu’il filme et quand il filme empêche cet équilibre, tout comme les images tremblotantes et l’angle de la caméra, dont la perspective fait passer les citoyens pour plus grands (et donc plus menaçants). De plus, l’accès aux images est dans la pratique « exclusivement pour la police. »
Pas de test caméra
À Namur, ville pionnière en Belgique francophone, la seule phase de test effectuée pour les bodycams a été évaluée d’un point de vue technique mais pas opérationnel, comme l’a précisé le chef de corps Olivier Dubois devant le Conseil communal, en septembre 2020.
Pauline Golard, ancienne étudiante en criminologie, a effectué un mémoire sur l’utilisation de bodycams par la police de Namur durant cette phase. Elle nous a déclaré que si, dans l’ensemble, les policiers interviewés étaient contents du dispositif (2 avis négatifs et 2 avis mitigés sur 10, quand même), certains estimaient que prévenir les personnes qu’on les filmait pouvait les encourager elles-mêmes à filmer et parfois les rendre plus agressives.
« Une dernière question que vous pourriez vous poser, c’est beaucoup 90 caméras, mais est-ce que l’on n’aurait pas essayé d’abord une quinzaine ? », ajouta Olivier Dubois au cours du même conseil communal de septembre 2020. Pour éviter, répond-il à sa propre question, « d’acheter aujourd’hui 30 caméras de la marque X, l’année prochaine 30 caméras de la marque Y, avec des modalités d’exécution, d’utilisation différentes. » Pour rappel, l’investissement est d’115 000 euros.
Il n’y a donc pas eu, à Namur, de volonté, comme au Canton de Vaud ou à Montréal, de produire une phase de test opérationnel et un rapport public indépendant, avec une prise de recul, avant de procéder à un investissement.
Ce n’est qu’à la mi-novembre 2021, qu’un premier rapport d’évaluation commandité par le Ministère de l’intérieur donnera un regard sur l’usage des bodycams en Belgique, usage qui est de toute façon enclenché.
Un « temps de respiration »
Bertrand Renard, professeur à la faculté de droit et de criminologie de l’Université catholique de Louvain, regrette qu’en Belgique, on ne se donne pas « un temps de respiration », avant de s’engouffrer dans un choix technologique. « En Belgique, les policiers sont assermentés. Contrebalancer leur version des faits avec des images représente un changement sociétal très important. Je ne porte pas de jugement sur le choix des bodycams, mais il faut être conscient de la modification que cela va amener dans le travail de police. Avec les caméras fixes, la police a vu que l’engouement démarrait au Royaume-Uni, puis en France, et on a embrayé. Sans attendre d’évaluation profonde. On refait la même chose avec les bodycams. »

Le chercheur rappelle qu’en septembre 2021, la Haute-Commissaire aux droits humains des Nations Unies, Michelle Bachelet, a appelé à un moratoire des états sur l’intelligence artificielle (notamment la reconnaissance faciale) dans les lieux publics. Jusqu’à ce que les autorités puissent démontrer que ces systèmes respectent « des standards robustes de respect de la vie privée et de protections des données. »
Un appel « intéressant », juge Bertrand Renard qui devrait agir aussi comme un rappel pour les bodycams. « Au lieu de se jeter dessus, il faudrait instaurer des tests, définir des objectifs précis et raisonnables pour l’évaluation, appliquer des méthodes scientifiques. Et se rappeler, aussi, que la technologie n’est pas une arme miracle. Rappelez-vous l’affaire Joe Van Holsbeeck. On avait les images des caméras, et pourtant la parquet a d’abord dit que l’on recherchait des personnes de type maghrébin alors que les meurtriers étaient… Polonais. »
Solutionnisme technologique
La Ligue des droits humains s’est penchée sur le fonctionnement du déploiement de bodycams dans deux zones de police à Bruxelles, et a tenté d’obtenir des renseignements sur d’autres zones. Elle note qu’on cède, en Belgique, à « un solutionnisme technologique » sur cette question et que « la pertinence de l’outil ne semble plus être questionnée. »
Pierre-Arnaud Perrouty, directeur de la Ligue des Droits Humains, déplore un manque de transparence dans la mise en place des bodycams et de leurs objectifs. « Chaque zone est libre de faire ce qu’elle veut, sans que cela ne soit réglé de façon générale. Dans certains cas on a eu accès à la directive opérationnelle. Dans d’autres, je ne suis même pas sûr qu’il y en ait une. On ne sait pas toujours très bien quand le policier déclenche la caméra et à partir de quand il enregistre. On aimerait aussi avoir plus de réponses sur le lieu et la durée du stockage des images. Qui y accède et si les gens filmés pourront y avoir accès ? »
Pour Namur, le Commissaire Libois a répondu à nos questions sur les règles d’utilisation de la bodycam, mais nous n’avons pas été en mesure de trouver un document public contenant la directive opérationnelle ou bien un document l’expliquant aux citoyens. Hormis un folder informatif…
Mode stand-by illégal
Les bodycams posent, par ailleurs, des enjeux juridiques très concrets. La loi sur la fonction de police contient des conditions assez précises d’utilisation des caméras mobiles (dont la bodycam) et de gestion de leurs données. Le COC, l’Organe de contrôle de l’information policière, a émis, en 2020, un avis d’initiative après avoir été questionné à plusieurs reprises sur l’usage des bodycams. Il a ainsi épluché les directives opérationnelles des zones de police et fait une enquête sur l’utilisation des bodycams dans les zones de Mechelen-Willebroeck et Bruges. Et il a constaté des problèmes, ou, en langage administratif, « une zone de tension claire » entre le cadre juridique et l’utilisation effective des bodycams.
Un seul exemple : certaines zones de police utilisaient au moment de l’enquête une fonctionnalité de la bodycam qu’on appelle le buffer (mémoire-tampon). Les policiers portent la caméra et un enregistrement de 20 à 90 secondes est mis en mémoire-tampon avant activation manuelle. Les policiers n’ont donc pas encore lancé volontairement la caméra, et donc prévenu les citoyens qu’ils filmaient. Pour les zones de police, écrit le COC, il ne s’agirait pas d’un enregistrement et donc les dispositions de la Loi sur la fonction de police ne s’appliqueraient pas à ce mode stand-by. « L’Organe de contrôle ne peut pas adhérer à ce point de vue », lit-on dans l’avis. Car des images sont bel et bien enregistrées et traitées. Or la loi sur la fonction de police dit que l’utilisation visible d’une bodycam est annoncée par « un avertissement oral émanant de membres du cadre opérationnel des services de police, identifiables comme tels. »
Ainsi, l’utilisation du mode stand-by (sauf s’il s’agit d’une utilisation secrète, qui n’est prévue que pour un nombre restreints de cas) est contraire à la loi même si les zones de police consultées par le COC justifient ce « pré-enregistrement » par la nécessité de montrer la petite période de temps ou d’escalade ayant justifié l’activation de la bodycam.
Consciente que le policier se trouve coincé dans un grand écart entre la loi et la pratique, le COC n’en rappelle pas moins que « la toute grande majorité des cas » d’utilisation du mode stand-by sont « illégaux, irréguliers et constituent donc un traitement de données à caractère personnel illégitime punissable. Les preuves qui pourraient venir de cette « mémoire-tampon » sont « frappées » d’irrégularité.
À Namur, cette fonctionnalité de pré-enregistrement a d’ailleurs été désactivée au moment de la mise en place des caméras, suite à l’avis du COC. Même si le Commissaire Libois estime que ne pas l’utiliser est un « inconvénient ».
Cette investigation par épisodes est l’un des volets de notre grande enquête participative sur l’hypersurveillance à la belge. Après 7 publications sur la BNG, la base de données générale de la police, voici un focus sur les équipements de surveillance qui viennent en soutien aux agents.