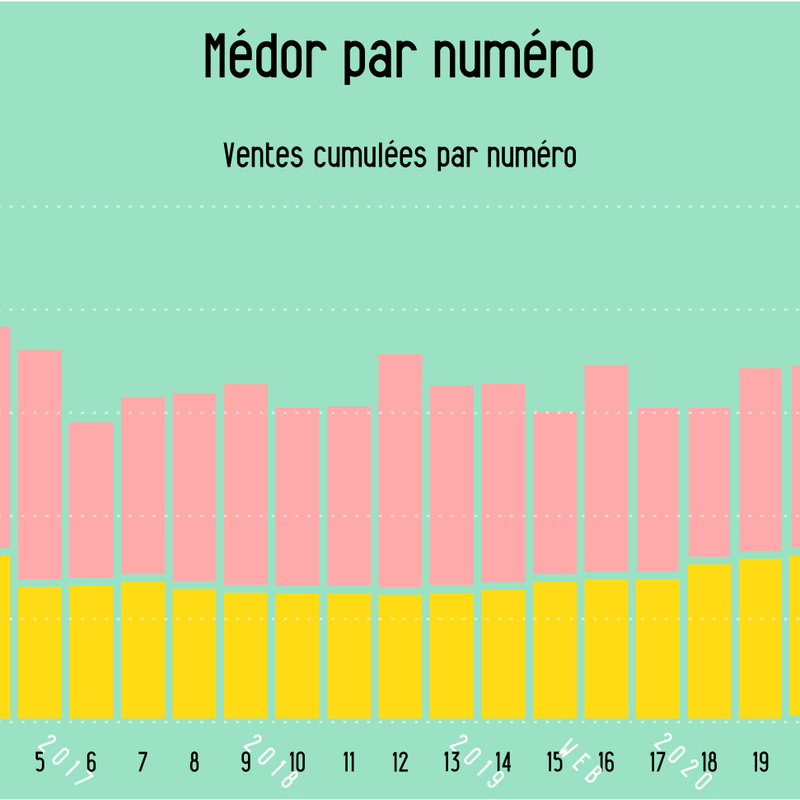Frederike Migom : les périls jeunes

Après le succès de Binti, la réalisatrice Frederike Migom se frotte aux mineurs confrontés à la psychiatrie. Un chemin de fiction qui interroge la solitude et l’exil.
Plus jeune, Frederike Migom rêvait d’échapper à la routine. Elle grandit à Anvers dans un milieu qu’elle décrit comme normal, voire ennuyeux. À 17 ans, elle fuit la monotonie et part prendre des cours de comédie à New York, poursuit en réalisation à Paris, avant de revenir s’installer à Bruxelles.
Rapidement, elle enchaîne les courts-métrages et fait parler d’elle en 2019, avec son premier long-métrage Binti. Le film est sélectionné à Sundance, le prestigieux festival américain, et tourne ensuite dans une ribambelle de festivals, dont certains spécialisés pour les enfants. Il remporte l’Ensor du meilleur film pour jeunes (l’équivalent flamand d’un Magritte).
L’exil, sous un autre angle
Binti, c’est un film pop et coloré, destiné au jeune public. Migom, 34 ans l’année de la sortie, part d’une réalité qu’elle trouve injuste : « Chaque année, on entend des histoires d’enfants qui fuient leur pays et ne peuvent célébrer Noël. » Elle raconte alors l’histoire de Binti, une enfant de 12 ans qui rêve de devenir vlogueuse (blogueuse vidéo). Elle vit avec son père, Jovial. Le duo est interprété par l’artiste belgo-congolais Baloji et une actrice de 9 ans qui crève l’écran, Bebel Tshiani. À deux, ils vivent en Belgique, mais n’ont pas de papiers. Pour éviter l’expulsion vers le Congo, ils vivent cachés chez Elias (un garçon que Binti rencontre par hasard) et sa mère, qui vont tenter de les aider à vivre légalement en Belgique.
Pour Frederike Migom, la thématique de l’immigration est souvent dépeinte de manière clichée. Une vision banalisée, où les migrants sont à peine nommés, souvent objectifiés et semblent interchangeables. Ici la cinéaste veut personnifier ses récits : « Souvent, dans les films, on ne connaît même pas le pays d’origine de la personne, et c’est un lieu perçu comme dangereux. Je voulais montrer le Congo comme un pays riche et beau. »
Pour mieux permettre à ce jeune public de s’interroger sur la trajectoire de Binti, elle la croise avec la quête d’identité à laquelle se frotte tout adolescent, notamment à travers les réseaux sociaux. « Si tu n’as pas de papiers, Papa dit que tu es en vie, mais que tu n’existes pas », dit Binti, qui se dit qu’avec ses 1 000 followers, désormais, ça veut dire qu’elle « existe, non ? »
Frederike Migom préfère s’emparer de sujets auxquels elle se sent liée. Comme dans Nkosi Coiffure (2015), où elle interroge, dans un salon de coiffure, les perceptions des femmes occidentales et africaines, dans leurs rapports aux hommes. Dans cette fiction, elle rend aussi secrètement hommage à une rencontre inopinée entre deux mondes : celle de sa maman, flamande, et d’une femme sénégalaise, qui se sont liées d’amitié à la suite de la disparition du frère de la cinéaste, décédé au Sénégal.
Le piège du sauveur blanc
Dans Nkosi Coiffure et dans Binti, la réalisatrice a fait un choix peu courant dans la fiction belge : écrire des rôles principaux joués par des personnes noires. Pourquoi ce choix ? « Pendant mes études aux États-Unis, j’ai été confrontée aux discussions sur la diversité dans le cinéma et les perceptions que l’on a en tant que Blanc sur les personnages de couleur, comme ces notions d’exotisme et de complexe du sauveur blanc (soit, au cinéma, le fait de raconter l’histoire de personnes de couleur en se centrant sur les actions bienveillantes d’un héros blanc qui se voit glorifié par sa posture de sauveur, comme Leonardo DiCaprio dans Blood Diamond, NDLR). J’essaie donc d’en tenir compte ; après, est-ce que c’est réussi ou non, je ne sais pas. » Elle se tait un instant et reprend : « Avec le recul, Binti, je ne sais pas si je le referais aujourd’hui encore de cette manière-là. Par exemple, au casting, j’ai beaucoup hésité entre avoir une actrice métisse, mais congolaise ou une actrice noire, mais burundaise. Et puis, il y a ma légitimité à raconter le récit de personnes noires en tant que Blanche. Car les questions sur ce que l’on peut faire ou non en tant que réalisateur blanc ont évolué depuis. En tout cas, je suis ouverte à la critique. Mais c’est important pour moi de faire ces films et d’en débattre plutôt que de ne rien faire. »
Survivre dans la société
Frederike Migom s’interroge constamment. Daniel Lambo, réalisateur, collègue d’écriture et ami, la décrit comme une éternelle curieuse, pleine d’empathie : « Sur le plateau comme dans l’écriture, Frederike s’investit corps et âme. Elle fait beaucoup de recherches sur ses sujets, elle est touchée par les témoignages des personnes qu’elle interroge. »
« Pourquoi cette société exclut-elle autant de personnes ? Pourquoi les dépressions dévastent-elles nos vies ? », se demande Migom. Ces dysfonctionnements, la réalisatrice les met en lumière à travers les regards de jeunes héros. Une réalité, parfois crue, qui semble plus facile à regarder à hauteur d’enfant. Ce point de vue lui permet d’aborder des sujets durs avec légèreté et une once de naïveté. Mais, surtout, elle crédibilise les ressentis des jeunes, dont les vécus sont parfois minimisés, voire invisibilisés.
Après Boos, un court-métrage sur les récits d’enfants placés dans un service de pédopsychiatrie, la trentenaire approfondit ce registre avec Jessie, son prochain long-métrage. Jessie a 18 ans et sort tout juste d’un foyer d’accueil. Sans famille, l’adolescente atterrit en hôpital psychiatrique où elle rencontre une patiente internée pour burn-out. « Jessie a grandi seule et croit qu’elle n’a besoin de personne. Or, je veux montrer qu’on a tous besoin des autres. À travers elle, je parle de solitude et de connexion humaine. En général, mes personnages sont incompris et recherchent du lien. C’est ça le fil rouge », explique la cinéaste.
C’est un fait divers qui a lancé Frederike Migom dans cette histoire. « En 2016, j’ai découvert qu’un garçon souffrant de troubles mentaux, Jordy, a été retrouvé mort [de faim, NDLR] dans sa tente, seul, après avoir vécu toute son enfance dans un foyer. J’ai réalisé que les jeunes ne sont pas tous armés pour survivre dans la société, c’est pour cela que j’explore comment des enfants placés éprouvent la transition à la vie indépendante. Je trouve ça fou de devoir être armé pour vivre dans ce monde. »
Hors cases
Après une dizaine d’œuvres, allant du documentaire à la série télévisée, la réalisatrice se cherche encore. Elle veut se détacher de l’étiquette de réalisatrice de films pour ados qu’on lui a trop vite collée : « Au départ, mes films n’étaient pas destinés à cette audience. Puis un jour, le Fonds audiovisuel flamand a sorti sa première bourse pour soutenir les films jeune public. Alors j’ai écrit Binti et ça a bien marché. Mais je ne veux pas me sentir limitée par cette case. Une chose m’importe, quel que soit l’âge de mes personnages : creuser le plus loin possible dans leur psychologie. » Prochains sur la liste : Bianca, 12 ans, et sa maman, qui vont devoir se retrouver après que la maladie du cœur du frère de Bianca, 9 ans, n’en finit pas de distendre leur relation. Reste pour Frederike Migom à continuer l’essentiel : faire du cinéma, peu importe les cases dans lesquelles on la coince.