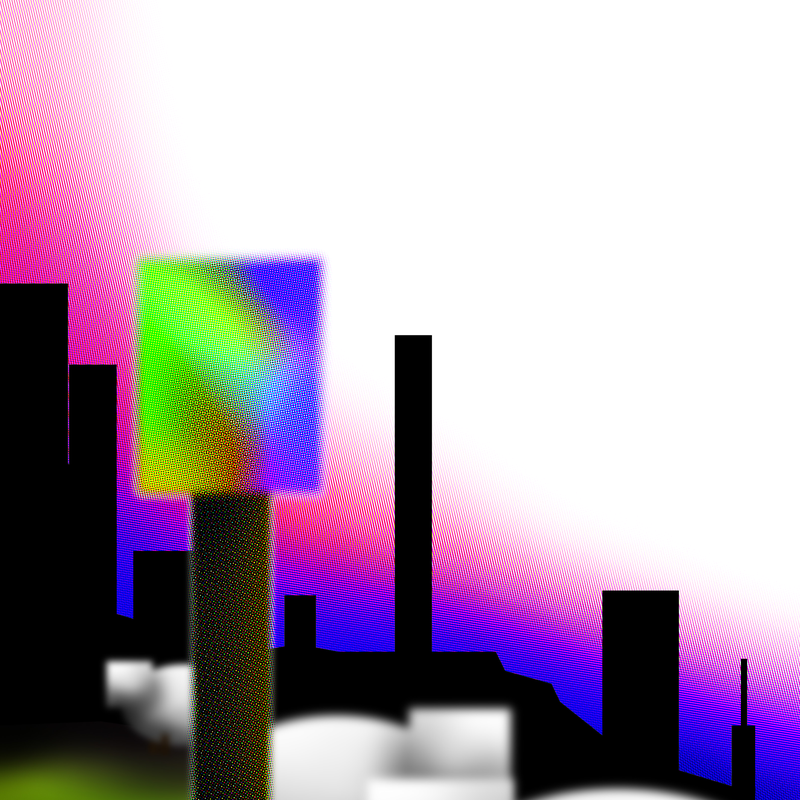Mon arrière-grand-oncle ce nazi

Une enquête sur les traces de mon aïeul, Julien Carlier, membre influent du parti rexiste. Pas un petit collabo, non, le chef de la propagande active. Condamné à mort par contumace au lendemain de la guerre, il a disparu (ou presque) de la mémoire collective. Et ce, jusqu’à ce que je m’en mêle… Son histoire, c’est notre sombre Histoire.
Tout commence à l’été 2019 à Bruxelles. Je suis assise à une terrasse, avec ma mère, on parle de choses et d’autres. Entre deux gorgées de limonade, elle raconte : « Comme tu le sais, ma grand-mère avait un frère missionnaire, mort en Haïti bouffé par les cannibales, mais elle en avait aussi un autre, un collabo qui a travaillé pour Radio Bruxelles. » Les yeux écarquillés, ma gorge se serre. « Radio quoi ? » La bombe est lâchée, ma curiosité est piquée, il est temps de fouiller dans les archives de cette famille d’exaltés.
Quelques clics, le monde de l’Internet me confirme l’existence de cet arrière-grand-oncle, né le 30 juillet 1908 à Nivelles (80 ans avant moi). Ingénieur commercial, il devient journaliste et membre de Rex.
Hiver 2019. Une nuit d’insomnie, sur Google, je découvre des archives du Moniteur belge : Julien Carlier, condamné à mort pour avoir été le chef de la propagande de Rex, le parti collabo de Wallonie. Je dois relire le document trois fois pour le croire : « chef de la propagande de Rex ». Cette fois, il ne s’agit plus de curiosité piquée, mais d’urgence de savoir, de comprendre, de raconter.
Antisystèmes
Julien Carlier est issu d’une famille bourgeoise, très catholique. Il se marie en 1930 à 22 ans. Un an plus tard arrive le premier enfant. Et puis, tout s’accélère, ça dégénère. Déserteur de l’armée belge, il s’engage en 1931 dans la Légion étrangère à Sidi Bel Abbès en Algérie sous le nom de Pierre Van Damme. Il déserte une nouvelle fois après six mois et devient caissier central des ventes à la Radio socialiste belge d’expression française, mais est révoqué en 1934 du Parti socialiste. En quelques mois, il claque porte après porte et passe au rexisme. Il devient l’homme de confiance de Degrelle, leader charismatique et égotique du parti.
C’est dans le contexte de ressentiment antidémocratique de l’après-Première Guerre mondiale que perce le parti Rex. Son objectif est de remplacer le système parlementaire multipartite par un ordre nouveau : un système autoritaire dirigé par un chef puissant et une élite politique autoproclamée. Les premiers rexistes sont de jeunes militants catholiques qui, pour la plupart, ont étudié à l’Université de Louvain. Tête brûlée et dégoûté par les normes de son temps, mon ancêtre semble trouver sa place parmi cette bande d’agités.
« Le parcours de Carlier, une fois intégré pour de bon à Rex, est assez semblable à celui des autres militants engagés dans ce mouvement : ce sont des “antisystèmes” viscéraux, éclaire Alain Colignon, historien spécialisé dans la Collaboration francophone. Le jeune parti rexiste se présente plus comme un mouvement de type national-populiste “à la belge” et comme une sorte de dissidence catholique que comme une véritable formation d’extrême droite. »
C’est au CegeSoma, le Centre d’études guerre et société des Archives de l’État, que je rencontre Alain Colignon. Il m’aide à dénouer le fil de la vie de mon ancêtre. Dans les caves du centre, les livres et les caisses s’empilent. Dans l’une d’elles, je tombe sur une photo de 1936. On y distingue le leader Léon Degrelle, mais aussi Victor Matthys, José Streel et Julien Carlier, les cadres de Rex. 1936, c’est l’année des élections historiques. Le parti explose les scores avec 11,49 % des votes et 21 des 202 sièges à la Chambre des députés… Degrelle a 30 ans, il est le plus jeune politicien d’Europe.
« Pendant la campagne, les rexistes se posent surtout en contestataires des politiciens en place [le Parti catholique, le Parti ouvrier belge et le Parti libéral, NDLR], impliqués peu ou prou dans des scandales à relents “politico-financiers” », continue l’historien.
Reconnu comme « un orateur hors pair », Carlier harangue les foules dans les meetings, de Bruxelles à Liège en passant par Verviers. « Aujourd’hui, c’est le voleur qui demande des comptes à l’honnête homme », scande-t-il pour soulever la colère du peuple contre les gouvernants.
Fake news
La stratégie médiatique est l’un des fondements de l’histoire de Rex. Le parti est d’ailleurs né de la maison d’édition catholique Christus-Rex et a plusieurs journaux à son compte. Les deux parutions les plus importantes sont le périodique Rex et le quotidien Le Pays réel qui atteint 200 000 tirages par jour en 1936. « Ils fonctionnent à partir de slogans, de bonnes blagues, désignent des ennemis, pratiquent des mensonges, un peu à la Trump. Ils utilisent un ton vociférant et polémique, mais très métaphorique pour interpeller les gens, les prendre par l’affect », indique Alain Colignon.
Au hasard, sur l’onglet Belgicapress de la KBR (catalogue en ligne de la Bibliothèque royale de Belgique), j’ouvre plusieurs éditions de 1936 du Pays réel. Quelques titres : « On veut nous imposer une procédure d’exception qui porterait un coup mortel à la liberté de la presse », « Les socialistes au secours des banksters », « Pas un sou aux journaux des pourris et gouvernement », « 25 000 morts, 200 enfants fauchés à la mitrailleuse par les marxistes pour terroriser Madrid affamé ». « Mais pourquoi tu t’intéresses tellement à cet odieux personnage ?, me demande ma mère. C’est le passé, ça intéresse qui ? »
Je lui réponds : « Ces discours antisystèmes, ce recours aux outils de communication, cette domination ultra-patriarcale, ces individus extrêmes qui surgissent en période de crise… C’est révoltant et passionnant. Et heureusement, Facebook n’existait pas encore ! »
Étonnamment, cette enquête historico-familiale favorise le dialogue entre ma mère et moi. Ce nazi resserre nos liens, on a un ennemi commun.
C’est aux Archives de l’Auditorat militaire, le Saint-Graal en matière de recherche des collaborateurs condamnés, que je fais mes plus grandes découvertes. Pour y avoir accès, il faut faire une demande argumentée au Conseil des procureurs généraux qui accepte ou non la requête. Des historiens et historiennes belges luttent depuis des années pour l’ouverture des archives au public.

Journaliste et descendante pas trop lointaine de la personne sur qui j’enquête, je reçois l’autorisation « exceptionnelle » de consulter le dossier répressif de mon arrière-grand-oncle. Comme le dit l’adage dans le milieu des historiens, « l’importance du personnage se calcule à la grosseur du dossier ». Celui de Carlier mesure 15 cm, c’est beaucoup. Des rapports d’enquête, des lettres d’admirateurs, des articles de presse, des photos de réunions, la naissance d’un enfant caché, mais aussi des discours fascistes, des conseils de propagandiste, des traces de commerce de meubles en bois pour les baraquements des camps allemands, un projet de fuite…
La presse marron
Saut dans le temps. Après la gloire de 1936, Rex est condamné par l’Église et, en 1939, le parti n’obtient que 4,4 % des voix aux élections. Pendant ce temps, les yeux rivés vers l’Allemagne, la population se demande comment va évoluer la « drôle de guerre ». Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la Belgique. Les rexistes y voient l’opportunité de redevenir une force politique influente. « À l’origine, les occupants essayent d’instaurer l’ordre et le calme parce qu’ils pensent que c’est comme ça que le pays sera le plus rentable pour eux. Ils considèrent les rexistes en partie comme des excités. Au début, ils sont très hésitants à collaborer avec eux », m’explique Louis Fortemps, historien et doctorant sur l’histoire de la propagande nazie en Belgique.
Le 19 mai 1940, la presse libre cesse d’exister à Bruxelles. C’est cette année-là aussi que Julien Carlier abandonne sa famille à Nivelles. Il s’installe à la capitale et travaille à la Nation belge, qui fait partie des journaux volés par l’occupant. La feuille de chou est surnommée « La nation boche », tellement la récupération est maladroite, le sous-titre passe de « Journal quotidien d’union nationale » à « Quotidien de redressement national et social ». En quête de plus de subtilité, les Allemands jettent aussi leur dévolu sur les grands titres. Les rotatives du journal Le Soir volé sont remises en marche le 14 juin, ils y maintiennent une ligne belgiciste et modérée – rien de tel pour faire passer de manière feutrée le message collaborationniste.
Les journaux volés ne sont que l’une de leurs techniques. L’occupant prend le contrôle de toute la chaîne, depuis la production de l’information jusqu’à la distribution des journaux. L’agence Belga devient Belgapress, une espèce de succursale de la DNB (Deutsches Nachrichtenbüro, l’agence de presse nazie), et les journalistes doivent s’embrigader à l’Association des journalistes belges présidée par Paul Colin, un scribouillard ouvertement fasciste. Après la guerre, l’Association générale de la presse belge (ancêtre de l’Association des journalistes professionnels) rayera leurs noms des registres.
Et du côté de la presse rexiste, que reste-t-il à l’heure où les bottes battent le pavé ? Le Pays réel tombe à la veille de l’invasion à 18 000 exemplaires, le quotidien (à l’image du parti) est presque aux oubliettes. Mais le 25 août 1940 sort le premier numéro post-invasion à la hauteur de toutes les contradictions du parti… L’édito du chef Degrelle se conclut comme ceci : « Ce journal est, aujourd’hui comme hier, libre de toute attache […] Nous n’aurons pas d’autre argent que celui que le public belge nous apportera. Seuls notre conscience, notre souci de la paix européenne, notre amour de la Patrie et notre fidélité au Roi nous guideront. »
Sauf que… le journal est financé par les services de Joseph Goebbels et par les publicités des firmes allemandes. (Quand on vous dit chez Médor que vérifier les financements d’un média est important !) Malgré les efforts de l’équipe de journalistes (Carlier en fait partie), les lecteurs ne suivent pas. En 1942, le quotidien n’est plus tiré qu’à 5 270 exemplaires dont 1 395 invendus…
De son côté, en 1941, Carlier, qui ne tient pas en place, part travailler une année en Allemagne comme volontaire pour « approfondir ses connaissances du régime national-socialiste ». Depuis l’outre-Rhin, il tient une chronique propagandiste « Je travaille en Allemagne » dans un autre média collaborationniste, Le nouveau journal. Le 31 décembre 1941, par exemple, il écrit : « La cadence de travail qui est demandée à l’ouvrier est infiniment moins rapide et, dès lors, moins pénible que celle pratiquée dans nos propres usines en période normale. »
Pour le reste, l’influence de la presse collabo sur l’opinion reste limitée. Le public continue d’acheter les journaux, surtout pour se procurer des informations d’ordre pratique (ravitaillement, réglementations) ou pour se distraire pendant les longues soirées confinées de l’Occupation. D’ailleurs, ce qui fonctionne le mieux dans les kiosques, ce sont les magazines féminins avec, au sommaire, des recettes pour préparer les restes ou des astuces pour garder le style avec deux bouts de chiffon, et les magazines de jeunesse pour s’évader un peu.
« Ici Radio Bruxelles »
Bien entendu, il n’y a pas que la presse écrite. La propagande s’organise aussi sur les ondes. « On est dans une époque où les nazis ont une croyance immense dans le pouvoir du média, et le pouvoir du média radiophonique en particulier », introduit Céline Rase, journaliste, historienne et autrice. Les émetteurs de l’Institut national de radiodiffusion (INR), premier service public belge de radio-télévision, sont saccagés par les employés pour que le matériel ne serve pas à l’ennemi. « C’est symbolique, mais concrètement, ça ne sert à rien, continue Céline Rase. Il faut 18 jours aux Allemands pour tout remettre en place. Les émissions reprennent le 28 mai, soit le jour même de la capitulation belge ! L’administration militaire allemande reprend au maximum les mêmes émissions et les mêmes voix qu’avant l’invasion pour ne pas créer de ruptures. Dans un premier temps, on peut écouter Radio Bruxelles sans avoir les poils hérissés. »
La guerre se poursuit. En 1941, la Légion Wallonie, destinée à combattre sur le front de l’Est, est créée. Au fil des mois, les discours sont toujours plus antisémites, antibolchéviques, anti-alliés. La fin de l’hégémonie allemande sur le front militaire depuis la perte de Stalingrad en février 1943 attise encore plus la haine des rexistes. Carlier écrit une chronique le 4 septembre 1943 dans le Pays réel. Ce passage à lui seul est un condensé anti-tout : « Uncle Sam et John Bull [personnages représentant les États-Unis et le Royaume-Uni, NDLR], pieds et poings liés entre les pattes du Haut-Capital juif, ont cru très malin de recourir aux bons offices de Staline pour mener à bien leur entreprise d’asservissement de l’Europe. »
« À la radio, il y a une radicalisation progressive qui est parallèle à celle de l’Occupation. Le personnel démissionne et est remplacé par des pro-nazis », continue Céline Rase.
C’est dans ce contexte qu’en 1943, Julien Carlier entre à Radio Bruxelles. Tous les soirs à 21 h, il tient sa chronique « La voix du pays » sous le pseudonyme de Pierre Van Damme, tandis qu’il signe ses articles de son vrai nom. Une visibilité à haut risque. « Il y a des listes avec des noms de collaborateurs qui circulent, la résistance organise des attentats », explique l’historienne. Dans une lettre adressée à Carlier, la mère de sa maîtresse lui enjoint de se faire plus discret, « vous qui savez mieux que personne combien il en tombe chaque semaine ». En vain.
Que ce soit dans ses discours, à la radio ou dans ses écrits, mon aïeul utilise un langage agressif assignant aux Belges de collaborer économiquement et militairement. « Nous regardons la menace et le danger en face […] Que les couards s’en aillent. Nous ne sommes pas de ces rats qui fuient le navire quand il menace de sombrer », déclare-t-il dans le Pays réel le 17 septembre 1943.
Décidément, cette année-là est la sienne. En septembre, Julien Carlier est également nommé chef de la propagande active. Son but est d’imprégner l’opinion par tous les moyens, y compris en structurant la désinformation. Dans une note signée, je découvre qu’il propose de faire distribuer des tracts et des journaux clandestins « qui emprunteront les titres de journaux déjà existants, éventuellement La Libre Belgique ou autre journal ».
1943 marque aussi une rupture très importante au sein du parti rexiste. En janvier, Degrelle proclame un discours sur la germanité des Wallons. Les Allemands allongent l’argent pour cet alignement, mais cette prise de décision divise les rexistes qui sont nombreux à quitter le parti. Les ultras restent. Carlier en est, évidemment. Il prononce d’ailleurs lui aussi, en tant que chef de la propagande, un discours en septembre au palais des Beaux-Arts, qui se termine par « Pour le germanisme, le national-socialisme et l’Empire. Fidélité au Chef ! Fidélité au Führer ! Sieg Heil ! ».
La débâcle
Au printemps 1944, la défaite allemande devient inévitable. L’armée soviétique avance à l’Est, les Alliés se préparent à l’Ouest ; les rexistes sombrent dans un délire jusqu’au-boutiste.
Le 6 avril, en tant que chef de la propagande, Carlier édite une note demandant le regroupement de tous les films ayant trait aux manifestations rexistes depuis le début du mouvement. Pour montrer combien ses services sont actifs ? Pour rassembler les pièces les plus compromettantes et les détruire si cela tourne mal ? Tout est possible. Mai-juin, c’est le chaos. Bruxelles est bombardée, les Alliés ciblent systématiquement le réseau ferroviaire contrôlé par la Wehrmacht entre Loire et Rhin. Survolté comme jamais, à la veille de la libération, Julien Carlier dévoile sa véritable identité en direct sur les ondes de Radio Bruxelles…

L’heure est à la fuite. En septembre 1944, l’État-Major rexiste prend le chemin de l’exil avec les Allemands. Carlier rejoint l’équipe de feu Radio Bruxelles envoyée à Bad Mergentheim, entre Francfort et Nuremberg. Il devient directeur de Radio Wallonie, un émetteur secret pro-nazi qui se fait passer pour un poste clandestin des résistants. C’est ce qu’on appelle de « la propagande noire ». Leur but est de brouiller les pistes. « Quelle hystérie !, s’exclame Céline Rase. Il est évident que l’Allemagne perd la guerre, mais ils continuent de croire au pouvoir de la radio et de la propagande, alors que l’Europe est en ruine. » Le premier lundi de Pâques, Carlier quitte Hildesheim avec l’État-Major. Depuis, plus aucune trace… Mort dans le chaos de l’Allemagne du printemps 1945 ? Disparu dans la nature, en Espagne, en Argentine, au Canada comme beaucoup d’autres ? L’histoire ne le dit pas.
Répression et mémoire
À la fin de la guerre, 0,52 % des Belges francophones sont condamnés pour collaboration. Parmi eux, Carlier, fugitif, est condamné à mort par fusillade et à payer cinq millions de francs à titre de dommages et intérêts, le 22 janvier 1945. « Julien Carlier a signé des articles, il a enregistré les disques, toutes les preuves sont là, elles sont accablantes, c’est facile de faire un procès très rapidement. C’est bien connu, à la libération, les passions sont mal éteintes et les tribunaux se montrent sévères dans un premier temps », éclaire Céline Rase. Entre novembre 1944 et août 1950, 242 personnes sur les 2 940 condamnations à mort prononcées par les tribunaux militaires sont exécutées par fusillade. La dernière exécution capitale en Belgique a lieu le 8 août 1950. Il s’agit d’un ancien commandant du camp de Breendonck.
« La Belgique est de facto en paix avec l’Allemagne depuis 1949, explique Xavier Rousseaux, historien du droit et de la justice. Il n’y aura jamais d’amnistie, mais on va libérer progressivement les détenus. Fin des années 50, il n’y a pratiquement plus aucun condamné pour collaboration en prison. »
En 1952, l’acte de décès de Julien Carlier est édité, sans qu’on ait de preuve de sa mort. Sans acte de décès, les familles de disparus se retrouvent coincées dans des impasses administratives, notamment pour régler les héritages. Une loi en 1948 vient faciliter les démarches : en l’absence de ces actes, les tribunaux peuvent déclarer tout décès survenu entre le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945, s’il s’est produit à l’étranger.
Le mystère reste entier. Septante-cinq ans après la fin de guerre, que reste-t-il de cet arrière-grand-oncle ?
J’interroge une dernière fois ma mère sur les réactions de la famille dans les années cinquante, soixante.
« Tu comprends bien que, sans être tabou, le sujet était évité. Les quelques fois où ma grand-mère m’a parlé de son frère, criminel de guerre, elle sautait de sa chaise, ça la rongeait. Mais si j’avais su tout ce que tu as découvert, souffle ma mère, je l’aurais questionnée. Tu connais la formule, “ceux qui ne peuvent se souvenir de leur passé sont condamnés à le répéter”… »
Cette enquête a été le point de départ d’un feuilleton audio réalisé par la journaliste Jehanne Bergé. Ce podcast en 7 épisodes est à écouter ici.

Pour prolonger ou accompagner la lecture, Pointculture nous propose le claquement des bottes de Mathias Bressan.

-
Contraction de bank et gangster, expression en vogue dans les années 1930, à la suite du krach de 1929.
↩ -
La principale source de ce paragraphe est l’excellent article « Première Page, Cinquième Colonne » d’Alain Colignon dans le Jour de Guerre 8 (1992).
↩ -
Selon les déclarations de sa première femme B.L. à la justice belge en 1945.
↩ -
Eddy De Bruyne, « La collaboration francophone en exil. Septembre 1944-mai 1945 », Cahiers d’histoire du temps présent n°9, 2001, Housse, Eddy De Bruyne éditeur, 1997.
↩ -
La peine de mort a été abolie en Belgique en 1996 par voie de loi pour tous les crimes et son abolition a été inscrite dans la Constitution en… 2005.
↩