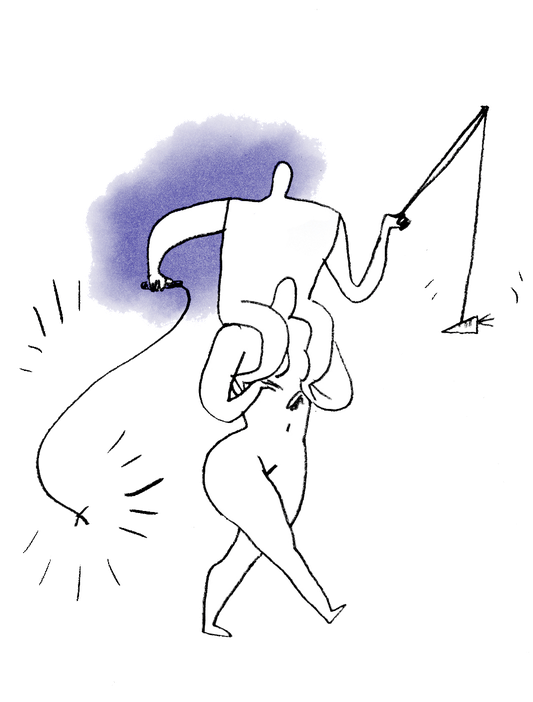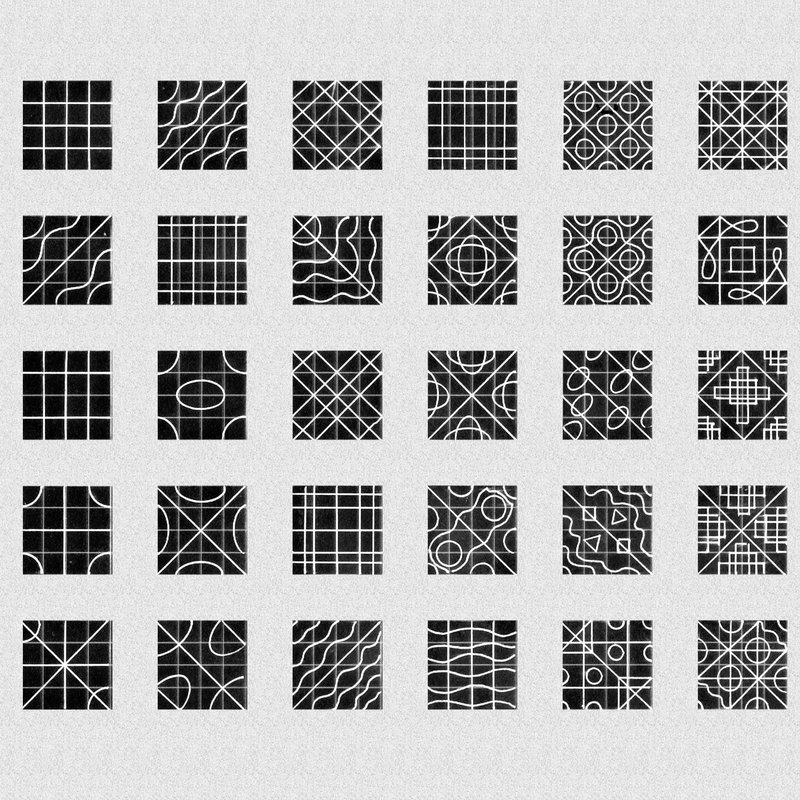La fin de la démocratie
Alain Eraly - Vincent de Coorebyter
Enquête (CC BY-NC-ND) : Philippe Engels & Quentin Noirfalisse
Publié le

Deux « chirurgiens » de l’action collective scrutent au loin l’horizon. Au chevet de notre société chamboulée par la révolution du numérique, le populisme et la terreur. Où allons-nous ? Comment garder confiance en l’avenir ? Travailler sans s’user, vivre sans la peur… Depuis vingt ans, Vincent de Coorebyter et Alain Eraly tempèrent les émotions collectives et rassurent les anxieux en misant sur la stabilité des institutions. Là, ils prennent un air grave : « Le modèle démocratique ne fonctionne plus. »
Médor Un an après les attentats de Bruxelles, comment jugez-vous l’attitude du monde politique et celle de la population après ce « choc » ?
Alain Eraly L’opinion publique saisie par cette nouvelle inquiétude s’est trouvée en manque d’une parole unitaire au nom de notre communauté politique. Le terrorisme au sens large du terme, incluant la déradicalisation, la surveillance, l’organisation des forces de police, impose une charge de coordination que notre pays, en l’état actuel, est incapable d’assumer. Il en va du djihadisme et du terrorisme comme de la politique énergétique : celle-ci renvoie à des compétences émiettées dans l’État fédéral, et notre régime de coalitions complique encore les choses.
Vincent de Coorebyter Le seul moment où on a observé une réaction coordonnée des dirigeants politiques, c’est juste après le 22 mars. A posteriori, cette réponse sécuritaire apparaît excessive. Hormis cela, il n’y a pas eu une réponse politique, coordonnée, nationale face au terrorisme. Or, l’opinion publique attend une attitude lisible face à cet enjeu important. Au niveau fédéral, le contrôle et la répression apparaissent centraux. On constate des essais de stratégies de déradicalisation au niveau communautaire et, à l’échelon local, la volonté la plus visible est le contrôle des domiciliations et des flux de déplacements. Mais il est difficile de trouver une unité de vues. Cela dit, le flou des politiques menées vaut pour beaucoup d’autres questions en Belgique. Il contribue au malaise actuel qui monte au sein de la population.
M. Comment expliquer ce « malaise » ? On perçoit un ensemble de peurs, une déstabilisation par rapport à l’avenir. Mais tout cela est très diffus…
V.D.C. En Belgique comme ailleurs, nos sociétés sont bousculées par la conjonction de trois éléments : les transformations économiques ou sociales découlant du progrès de la science et des techniques, une complexification croissante de tous les enjeux et les interrogations multiples qui en découlent. L’avènement du numérique l’illustre parfaitement. Malgré lui, il conduit à la précarisation de l’emploi, à l’« ubérisation » de la société, à la mutation de certains métiers et au mal-être au travail. Vu l’allongement de la durée de vie, quatre ou cinq générations cohabitent avec des mentalités très différentes. Des jeunes biberonnés aux nouvelles technologies vivent avec des aînés qui ont vécu l’arrivée de l’électroménager ou de la voiture. On assiste à une diversité inédite des convictions idéologiques et religieuses, mais aussi des mœurs et des identités sexuelles. Il n’y a plus de peuple, il y a des populations, confrontées à des flux migratoires énormes. Les identités nationales sont forcément malmenées. D’où un défi gigantesque pour les gouvernants : comment répondre à des situations et à des attentes aussi différentes ? On sent bien qu’on passe d’une société où le travail était central à un autre modèle qui ne montre pas encore son visage. Et puis il y a cet enjeu majeur : pour la première fois, l’espèce humaine est en danger à cause de sa propre activité. Enfin, où va l’humanité quand les mutations technologiques autorisent la transformation du corps humain, la concurrence des robots et la gouvernance par algorithmes ? Tout cela nourrit un arrière-fond d’inquiétude dont on ne prend pas assez la mesure.
A.E. Oui. La population est consciente que l’avenir sera pire que le présent. Il est lourd de menaces et celles-ci alimentent des anxiétés croissantes. La peur des changements climatiques, la peur d’être submergé par des migrants, la peur d’être exploité au travail, la peur du terrorisme, la peur du déclassement. Or, ces angoisses s’accompagnent d’une perte de souveraineté. Beaucoup d’entre nous le constatent avec effarement. La déforestation, la lutte contre les paradis fiscaux, les migrations, l’éthique publique, tout cela dépasse les États. Ce sentiment est au cœur du malaise démocratique : les citoyens n’ont plus de prise sur leur avenir, et ceux auxquels ils donnent leurs suffrages pour les représenter apparaissent impuissants.

Plus aucune régulation mondiale
M. C’est notre démocratie elle-même qui serait en péril ?
V.D.C. La plupart des grands défis de l’heure – on vient de le dire – sont mondiaux. Le problème, c’est que toutes les instances internationales de régulation sont en échec. Elles ont cessé de fonctionner, comme l’Organisation mondiale du commerce ou l’ONU dans les dossiers sensibles, par exemple. Sur un enjeu primordial, le réchauffement climatique, on progresse un peu. En 2015, à Paris, la COP 21 (Conférence sur le climat) a permis un début de coordination politique à l’échelle mondiale. C’était la troisième étape d’un très long cheminement. Il y avait eu Rio, Kyoto puis un long tunnel. Mais même là, on pressent déjà qu’il sera très difficile de faire appliquer les décisions prises. En réalité, le système démocratique tel que nous le connaissons – avec suffrage universel et élection des dirigeants – n’a fait ses preuves que dans le cadre des États-nations. La construction européenne, par exemple, s’est paralysée en s’élargissant. Une question cruciale se pose dès lors : puisqu’il faudrait élargir l’échelle où on prend des décisions et qu’aucune régulation mondiale ne semble possible, faut-il renoncer au champ démocratique ? Sans cesse prendre en compte la multiplicité des situations et des intérêts, les lignes rouges et les tabous des uns et des autres, cela use. Même si cela m’effraie de dire ça, on a parfois l’impression qu’on ferait mieux de restaurer une utopie dangereuse qui est celle du roi-philosophe plutôt que pousser le rêve de la démocratie.
M. C’est la voie ouverte à des régimes totalitaires, non ? Avec limitation des libertés et pouvoir autoritaire.
V.D.C. On pourrait imaginer une sorte de parlement mondial composé de personnes qui n’auraient pas de comptes électoraux à rendre et qui gouverneraient à l’aide d’une sorte de sagesse désincarnée. Cela signifierait des décisions prises sans réelle concertation et qui s’appliqueraient au nom d’une forme d’intelligence suprême. Est-ce que cela marcherait ? Serait-ce souhaitable ? Cela correspond aux fondements mêmes du totalitarisme, en effet…
M. Comment jauger la solidité de l’État belge ? Pas en mesure de lutter contre le terrorisme ou de mener une politique cohérente en matière d’énergie, disiez-vous. Vraiment ?
A.E. Si on compare la prise de décision, aujourd’hui, avec la situation qui prévalait dans les années 1950 ou 1960, le saut en termes de complexité est spectaculaire. Pour se retirer du Congo, il avait suffi que quelques élites se mettent autour de la table – une dizaine peut-être. Aujourd’hui ce serait inimaginable. Nous serions tout simplement incapables d’organiser l’équivalent de l’Exposition universelle de 1958. On le voit avec la gestion du dossier du stade national, un exemple parmi tant d’autres. Construire un stade : à l’échelle d’un pays, c’est quand même un projet d’ordre anecdotique. Eh bien, sauf rétablissement spectaculaire, nous serions bien capables de ne pas être prêts pour l’Euro de foot prévu en 2020. Les pouvoirs d’obstruction, de veto sont monstrueux.
V.D.C. La Belgique ne se dépêtre pas d’un certain nombre de problèmes lancinants. La dette publique ne se réduit pas. Le refinancement de la sécurité sociale n’est toujours pas réglé. Même chose pour toute une série de problèmes plus ciblés. Les nuisances sonores à Zaventem, un poison politique depuis 1999. Le RER autour de Bruxelles qui, au mieux, naîtra 40 ans après qu’on l’a envisagé. La sortie du nucléaire, prévue en 2025 alors que rien n’est fait pour s’y préparer réellement. Le sous-financement chronique de la justice. La lutte bien insuffisante contre la grande délinquance financière. Incontestablement, la Belgique a un problème d’efficacité.
Une guerre civile aux États-Unis
M. Un État inefficace : comment en est-on arrivé là ?
V.D.C. Je ne peux qu’avancer un embryon de réponse, sans avoir la prétention d’expliquer cet état de fait. Sans l’avoir programmé, la Belgique s’est montrée extrêmement respectueuse de ses diversités internes.
L’État fédéral est une construction complexe où personne n’a de raison de se plaindre. Communautés comme Régions, représentants d’intérêts divers, chacun y a trouvé sa place. C’est bien. La démocratie se nourrit de la diversité. Elle est là pour la protéger. En même temps, cette diversité étouffe la démocratie. Quand il faut tenir compte de tout et de tous pour la moindre décision, on engorge, on ralentit, on grippe le système. Un exemple : la qualité de l’enseignement est jugée insuffisante si on en croit plusieurs études internationales, et des réformes drastiques s’imposent donc, mais elles butent sur la multiplicité des réseaux (la Constitution garantit à tous la liberté de créer ou de choisir son école) et sur le « nièt » des syndicats dès qu’on envisage de toucher à l’emploi.
M. Le scandale Publifin et ces mandats publics rémunérés sans charge de travail, à Liège, c’est l’illustration du redoutable discrédit subi par le monde politique, non ?
A.E. Il illustre l’inertie systématique et consternante – voire suspecte – des partis au pouvoir et du gouvernement wallon en matière de gouvernance. Quand on examine les mesures de football panique prises depuis janvier, on voit qu’elles ne touchent fondamentalement ni à la particratie, ni à la politisation, ni au management public. On se contente de réduire les mandats et les rémunérations. Au risque de créer une polémique ou de crisper, on parle d’une trentaine d’emplois fictifs chez Publifin, mais… il y en a des centaines dans l’administration wallonne. En tout cas partiellement fictifs.
M. C’est typiquement belge, ça ?
A.E. La perte de légitimité du politique et le déclin des institutions se retrouvent partout à l’étranger. Le système belge n’est qu’un inconvénient de plus. Regardez les conditions qui ont permis le Brexit, l’arrivée de Donald Trump, la montée du FN en France, le déclin économique et politique de l’Espagne ou de l’Italie.
V.D.C. Ce n’est qu’en période de crise aiguë que la Belgique parvient à être efficace. En 2008, lors de la crise financière, le pouvoir a été concentré durant quelques semaines entre les mains d’un tandem (Yves Leterme/Didier Reynders) qui a eu les coudées franches pour éviter la faillite en cascade de plusieurs banques. On a laissé faire deux hommes. Ce n’est pas le fonctionnement ordinaire de la Belgique. Et ce n’est sans doute pas souhaitable. Mais en attendant, des décisions ont été prises.
M. Ni à l’Est ni à l’Ouest, il n’existe de réel modèle d’État qui fonctionne bien ?
V.D.C. Si : certains pays nordiques et l’Allemagne d’Angela Merkel. La chancelière est la seule personnalité politique à faire à peu près l’unanimité en Europe. Il y a une forme de dignité morale chez cette fille de pasteur protestant éduquée en Allemagne de l’Est et qui prend des décisions courageuses en matière d’accueil des migrants, avec une réelle hauteur de vue (même si cela répond aussi à un besoin de main-d’œuvre). Ses prises de risque dans un contexte de xénophobie latente sont montées en épingle parce qu’elles ont un caractère exceptionnel. Cela fait réfléchir, tout de même… Nos démocraties sont minées par les communicants, les sondages, la volonté de séduire à tout prix et de coller à l’opinion. Or le règne de la communication est aussi celui de la démagogie et, dans certains cas, celui des promesses non tenues et de la tromperie.
M. On déroule le tapis rouge sous les pieds des populistes, en fait ? Trump, Erdogan, De Wever, les pro-Brexit et beaucoup d’autres ?
V.D.C. Jules Ferry disait, en substance, que le despotisme sera toujours plus simple que la démocratie. Il est plus direct, plus réactif. Chez les leaders que vous citez, il y a une logique commune. Ils veulent des règlements rapides et univoques aux grandes questions de l’heure. Depuis qu’il est investi, le président Donald Trump prend des décisions avec un simplisme déconcertant. Il y aurait un problème de migrations et de délinquance à la frontière mexicaine ? Il fait ériger un mur. Il subsiste des menaces terroristes ? Il interdit aux ressortissants de certains pays d’entrer aux États-Unis. Il refuse de respecter les règles démocratiques car il s’estime détenteur d’un mandat populaire. Le populisme, c’est considérer qu’au nom d’un peuple mythifié et homogène, on tranche. On va vite, on travaille brutalement.
M.Doit-on s’inspirer de certaines solutions des populistes ?
A.E. C’est une question difficile. Tout leader populiste construit son charisme en affirmant qu’il est au-dessus de la mêlée, extérieur au système et à ses élites, et capable de les mettre au pas afin de recréer l’unité perdue de la Nation. On ne saurait dire que Trump soit extérieur aux élites et occupé à dépasser les clivages… À mes yeux, ce genre de phénomène charismatique est toujours une régression démocratique, à rebours des valeurs héritées du siècle des Lumières. Aujourd’hui, il s’agit avant tout de restaurer le sentiment que la politique est en mesure d’affronter les grands problèmes de façon efficace et équitable.
V.D.C. Le populisme de Trump s’avérera profondément inefficace et contre-productif. Je ne suis pas sûr qu’il ira au bout de son mandat. Il pourrait même contribuer à une guerre civile dans son pays… La seule chose que l’on peut prendre en compte dans la montée des populistes, c’est qu’ils sont l’expression d’un malaise, d’une souffrance, d’une inquiétude, surtout dans les couches précarisées de la population. Nos dirigeants devraient retrouver cette écoute. Je sais que c’est un premier pas vers la démagogie et qu’on peut donner l’impression de faire le jeu de l’extrême droite en disant ça. Mais je franchis ce pas, car le problème est sérieux.

M. Les citoyens peuvent montrer l’exemple et changer la manière de gouverner ?
A.E. Euh, pas sûr. Ils ont trois types de réactions face à ce monde complexe.
1. Le désintérêt ou l’indifférence par rapport à la chose publique. Cela au profit de l’individualisme consumériste. « Qu’ils se débrouillent… pour maintenir mon niveau de vie. Le reste, je ne veux pas le savoir. » Les citoyens reculent devant la complexité des problèmes et préfèrent s’en désintéresser. 2. La défiance. C’est une attitude saine et logique en démocratie. Livrés à eux-mêmes, nos élus peuvent commettre des actes répréhensibles, comme privilégier leur intérêt personnel (c’est le cas avec l’affaire Publifin ou Fillon), et il est donc logique et naturel de les mettre en cause. 3. La rancœur. Ça, ça m’inquiète davantage. Les hommes ou les femmes politiques se sentent condamnés à faire des promesses dont ils savent à l’avance qu’elles ne pourront pas être tenues, après les élections. Une fois aux commandes, ils se trouvent forcément critiqués, vilipendés par les citoyens et des groupes frustrés dans leurs aspirations et leur désir de reconnaissance. Cette rancœur est devenue carrément culturelle. Quand on essaie de défendre les dirigeants politiques, les gens deviennent vite agressifs. Vous suggérez qu’ils ont une vie difficile, qu’ils sont traînés dans la boue et parfois lynchés médiatiquement, et la réponse fuse : « Tu ne vas pas les défendre en plus ! Ils l’ont choisi. » Ces dirigeants politiques deviennent des boucs émissaires.
M. On peut parler d’une forme de désespérance ? Ou… d’un rejet de plus en plus radical ?
A.E. Oui. Il y a une forme de désespérance et de sentiment de trahison. La désespérance, on peut la comprendre vu les menaces qui pèsent sur l’humanité et qui travaillent les esprits. La trahison, c’est autre chose. L’État-providence fabrique des attentes sociales qui sont déçues. C’est l’imaginaire d’un contrat social rompu.
V.D.C. On juge les dirigeants politiques sur deux critères majeurs : l’efficacité et l’honnêteté. Quand ils cumulent deux mandats (député et bourgmestre, par exemple) et que cela apporte quelque chose à la collectivité, tout va bien. Quand il y a doute sur leur honnêteté et qu’ils paraissent en même temps inefficaces, cela coince. Car on pense alors que les dirigeants politiques sont impuissants parce qu’ils sont malhonnêtes. Là on risque de passer de la défiance à la colère ou à la rupture totale avec le système.

L’ambiguïté des citoyens
M. La démocratie a atteint ses limites, dites-vous. Mais que peut-on inventer d’autre ?
V.D.C. Tout le monde n’est pas dans le rejet. Il y a une vitalité extraordinaire dans une partie de la société. Des citoyens deviennent des acteurs de leur avenir. Par leur vie quotidienne, leur action personnelle, ils proposent des solutions. De nouvelles pratiques en termes de production, de consommation, de solidarité. L’habitat partagé, les circuits courts, etc. Des mouvements de citoyens prônent aussi des modes de démocratie directe (Nuit debout, Tout Autre Chose). Ceux-là se positionnent toutefois en dehors du système. Ils refusent de mettre les mains dans le cambouis politique, ils veulent être une force de proposition ayant au maximum un droit de veto. Ce qui frappe, c’est que la fraction la plus dynamique et la plus inventive de la société concurrence en quelque sorte le monde politique… tout en restant en marge du système.
A.E. Il est évident que, dans une partie de la société, il y a une évolution spontanée des modes de vie. Des citoyens changent leur mode de consommation, vivent ou habitent autrement, abandonnent la voiture, veulent sauver la planète. Ils réinventent sous nos yeux la vie en société. Deux formes d’utopie en découlent. 1. Croire que les solutions viendront tout entières de communautés locales retranchées du système global. 2. Croire qu’il est possible de repenser la politique aux marges du système en faisant l’économie d’une transformation de la démocratie parlementaire et de l’administration. On constate que ces mouvements sont très évanescents. Ils naissent et disparaissent car ils sont incapables d’imposer en leur sein une forme d’autorité stabilisatrice.
V.D.C. La double logique des mouvements citoyens pose problème. Ils sont prêts à sacrifier du temps et de l’énergie à chercher des synthèses improbables. Sans volonté de réinvestir la politique. Ces pratiques alternatives peuvent s’avérer efficaces, mais jusqu’à un certain point car elles n’agissent pas au cœur du système.