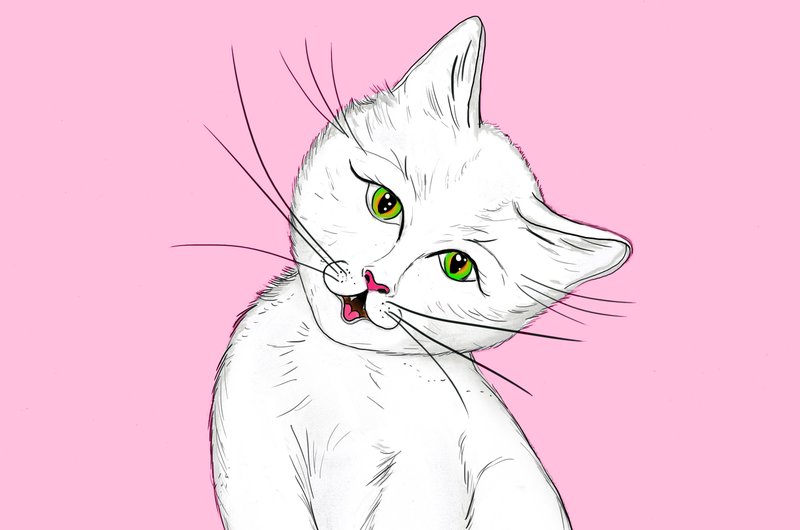Qui se souvient du Woodstock wallon ?
Amougies. 1969
Photos : Jean-Paul Bois-Margnac (1969) & Colin Delfosse (2023)
Texte (CC BY-NC-ND) : Chloé Andries
Publié le

Amougies. 1 200 habitants. Il y a plus de 50 ans, ce petit village du Hainaut a eu son heure de gloire, accueillant ce que les fanas de l’histoire du rock appellent… « le Woodstock belge ». Mais que reste-t-il de la légende dans cette commune aujourd’hui endormie ?
On aurait pu se retrouver au café. Mais l’unique café d’Amougies n’ouvre qu’à 15 h. Il est 11 h. Sur la place du village et alentour, pas vraiment d’autre endroit où aller. Dit plus prosaïquement : c’est mort. Pas un resto, pas même une boulangerie.
Alors, après une tentative ratée à la maison communale – qu’on n’avait pas prévenue et qui n’avait donc pas de pièce chauffée à nous proposer –, nous voilà donc chez lui. Chez Guy.
Guy Vandenhove, 75 ans, vit dans une petite maison de rangée à deux pas de ladite place. Jusqu’à il y a quelques années, il habitait avec sa mère. Mais elle est décédée. Alors aujourd’hui, il n’a plus que Saligot, son canari, pour lui tenir compagnie. « Saligot, parce que quand il prend son bain, l’eau spite de partout. » Guy est président des Jacobs, une association de fumeurs de pipe (le but du jeu, trois fois par an, est d’être celui qui finit sa pipe le dernier, la « nuit de l’homme », dit-il). Avant, il était membre de l’Harmonie. Qui a disparu. Guy ne connaît plus vraiment ses voisins. « Les gens partent en voiture le matin, reviennent le soir, on ferme la porte, on ouvre son ordi, voilà. Hier, j’étais au bistrot, à 18 h, il n’y avait que deux clients », enchaîne-t-il, en sirotant son verre de rosé.
Une cuite
Je lui demande de me raconter la vie « avant ». Celle de 1969. Il me décrit un quotidien de village animé, celui des petits commerces, des supérettes, des épiceries qui vendent de tout, des gens qu’on croise à pied, à vélo, se retrouvent à la messe, ou alors comme lui « à la messe d’en face », au bistrot, ouvert dès 9 h. Je l’écoute et je n’arrive presque pas à m’imaginer que la petite commune d’Amougies, 957 habitants à l’époque, comptait 15 troquets, « sans compter tous les cafés derrière la porte », ces particuliers ou petits commerces qui ouvraient des bouteilles pour les habitués, sans licence, mais c’était toléré. « Le coiffeur chez qui on allait et dont on revenait avec une cuite », évoquera un autre témoin, qui estime à au moins une vingtaine ces bistrots derrière le rideau.
À l’époque, les frères de Guy, Francis et Michel, tenaient une des deux brasseries du village. Guy, lui, était mécanicien à la filature Uco, disparue elle aussi, « alors qu’on était 332 à une époque ». Mais il aidait également ses frangins. Chaque samedi, c’était la « tournée », du porte-à-porte pour livrer les gros bacs en bois, chargés de boissons. « Quasi tout le monde était client. »
Pourquoi demander à Guy de me raconter l’Amougies de 69 ? Pas par amour de la carte postale, mais parce que dans ce minuscule village rural hennuyer qui s’endort comme les autres, situé dans le verdoyant Pays des Collines, à deux minutes en voiture de la Flandre, il s’est passé en 1969 un truc de fou. Et que ce truc de fou, Guy est un des derniers à s’en souvenir.

Pink Floyd et Franck Zappa
La légende a rebaptisé ce moment de folie « le Woodstock belge ». Parce qu’en 1969, du 24 au 28 octobre, Amougies, ses pâtures, ses champs, ses fermes, ses cafés et ses épiceries ont vu déferler une horde de hippies, jusqu’au mont de l’Enclus. Environ 70 000 (jusqu’à 100 000 pour les plus nostalgiques), le temps d’un festival unique de musique pop (on n’osait pas encore le terme rock à l’époque), free jazz et musique contemporaine. À l’affiche, 500 musiciens, 40 groupes. Des formations anglaises et françaises, des têtes d’affiche comme Pink Floyd, Yes, Ten Years After, mais aussi des groupes en devenir, Colosseum, Captain Beefhaert. Ou encore des virtuoses du free jazz, comme le saxophoniste américain Archie Shepp et surtout… Frank Zappa en Monsieur Loyal. Partout, pendant cinq jours, des corps allongés dans les pâtures, des grappes de beatniks errant dans les rues, vestes en fourrure et bandeau sur le front. Des épiceries dévalisées. Mais comment cet événement hors norme a-t-il pu voir le jour ici, dans ce « village où il ne se passe jamais rien », comme le décrit le quotidien Nord Éclair en octobre 69 ?
Retour en octobre 1969, donc. L’été précédent, il y a eu la ferveur de Woodstock (dans l’État de New York) et son demi-million d’âmes. Et surtout, en août, il y a eu l’île de Wight – l’île de Wèèt, dit-on ici à Amougies – et sa centaine de milliers de hippies venus prier Bob Dylan et consorts. Critique de la société de consommation, besoin de liberté, un mouvement est en train d’émerger, et un peu partout des initiatives d’une contre-culture balbutiante fleurissent, faisant converger une jeunesse désireuse de communion autour de nouveaux sons.
C’est Jo Dekmine, patron du Théâtre 140 à Bruxelles, qui est à l’origine de ce tsunami wallon. « Un gars engagé dans la bonne musique, le genre de mec qui programmait déjà Brigitte Fontaine ou Jacques Higelin et faisait venir des groupes anglais de rock et de bossa nova. Il avait déjà accueilli Pink Floyd avant 68 », se remémore Jean-Noël Coghe, journaliste français installé alors à Wattrelos, à la frontière française et l’un des instigateurs du festival d’Amougies. Jo Dekmine vient tout juste de lancer le Pop festival à Deurne, où il programme des jeunes groupes comme Nice, Yes ou Colosseum. Les 6 000 places sont parties si vite qu’il rêve d’exporter l’aventure à Paris.
Tournai dit oui… mais non
Jean-Noël Coghe part en éclaireur dans la capitale française, où il va se mettre en cheville avec un certain Jean Georgakarakos (dit Karakos), « un jeune fou », fan de free jazz, qui vient de monter une maison de disques, BYG, et s’apprête à racheter un petit journal alternatif parisien, Actuel.
« On est en juillet, je lui explique le projet, on part prendre un p’tit déj, et le gars me dit banco ! » Pour octobre, ça va être serré. Mais jouable. Sauf qu’« en France, ce grand pays qui a tout découvert après les autres », se marre Jean-Noël Coghe, c’est nièt. Le gouvernement, refroidi par le chaos de Mai 68, ne compte pas donner son autorisation à ce groupe de jeunes chevelus.
C’est donc vers la Belgique que se tourne l’équipe du festival. Tournai dira d’abord oui, avant que le ministère de la Défense n’interdise l’affaire… le 17 octobre, moins de dix jours avant le démarrage. Ici aussi, les hippies inquiètent. Refus également à Courtrai, Ruien, Antoing. Ça sent mauvais.
Puis, miracle, le 18 octobre, Nord Éclair titre : « Les hippies iront à Amougies ».
Le bourgmestre libéral d’Amougies, André Callebaut, patron éponyme des chocolats, a 40 ans. C’est son premier mandat. Il a envie de tenter le coup, de faire parler de sa commune. Et d’en tirer du bénef. Sa condition : que tout le matos des festivaliers provienne des commerces locaux. Beurre, viande, bière, pain, fils électriques, pommes de terre, soupes en boîte et peignes. Tout. C’est OK. Le commissaire de l’arrondissement de Tournai, Frans Taquet, soutient l’initiative. Mais où planter le chapiteau de 5 500 m² ? Un fermier du coin, Charles Decock, a bien une pâture, assez grande et plane. Et, oui, il veut bien « rendre service ». « Si ça peut aider. »
Gros bout d’herbe
Thérèse Decock, sa fille, me montre, un matin glacial de décembre, en contrebas de sa maison, la fameuse prairie (6 000 m2 quand même). Ensemble, on regarde… un gros bout d’herbe, donc. Mais surtout, elle me raconte cette après-midi un peu folle, où un gars (Karakos) a débarqué à la ferme, en grosse voiture – une vieille Jaguar, selon Jean-Noël Coghe – avec son assistante, pour signer le contrat. « Il fallait inscrire que papa était d’accord pour que le festival se fasse sur sa pâture. Elle avait sa machine à écrire, elle l’a sortie et a tout vite tapé. Le monsieur a ensuite demandé s’il pouvait passer des coups de téléphone, pour confirmer. Et à 17 h, sur Salut les Copains, ils annonçaient que le festival aurait lieu à Amougies. »
Pendant le festival, Thérèse se rappelle l’ambiance fiévreuse. Un truc un peu mystérieux et assez excitant. Ses sœurs s’occupaient du parking – des hectares de champs envahis de voitures, garées pour 20 francs belges (50 centimes), « l’argent c’était pour l’association du 3e âge ». « Les gens demandaient s’ils pouvaient dormir dans nos greniers à foin. Et papa disait oui. Il allait dans les greniers, il discutait. Tous ces jeunes étaient là, dans le foin, ça fumait, on ne se disait même pas que ça aurait pu prendre feu. »
Yves, son mari – il ne l’était pas encore tout à fait, à l’époque – qui avait assisté au concert de Ten Years After sur la pâture avec une bande de copains, se souvient de toute cette foule, affalée à terre, avec des petites couvertures. Et cet épais brouillard de fumée, dans le chapiteau.
« Il n’y avait pas de poubelles, les détritus jonchaient le sol. Mais c’était un peu comme quand on ramassait les patates dans les champs. Il y avait toujours du monde pour aider », ajoute Thérèse. Le couple nous emmène faire un petit tour en voiture pour se faire une idée. Il reste toujours beaucoup de champs, de pâtures. Mais le monde agricole s’est transformé. A perdu ses gens. Ici comme ailleurs, les petites fermes ont disparu, au profit de grosses exploitations. Rien que depuis 1990, le nombre d’exploitations a chuté de 50 % en Wallonie, quand la superficie moyenne des exploitations a plus que doublé. Un peu plus loin, chez Jean-Jacques Busine – lui revenait de l’armée, la boule à zéro, quand il a vu déferler les hippies –, on nous rappelle une époque où des petits fermiers faisaient vivre leur famille entière avec quelques hectares. « Mes grands-parents, avec leurs 22 hectares, avaient une des plus grandes exploitations d’Anserœul (village voisin). » Pour info, la taille moyenne des exploitations dans la commune de Mont-de-l’Enclus est désormais de 39 hectares. « Les petites et moyennes fermes, quand elles sont vendues, ça devient des gîtes, c’est racheté par des promoteurs. Il y a même un Flamand qui a fait un manège pour ses chevaux. »
24 km de saucisses
Guy Vandenhove, lui, se rappelle les caisses de bières que ses frères acheminaient du côté du chapiteau – la Frik Pils, la Vieille des Flandres, la Peter Jan, la Geuze, pour 10 ou 12 francs. Il avait 22 ans à l’époque. « Vers 17 h, on allait avec les brouettes ramasser les bouteilles vides. Il faisait assez froid, alors, nos bacs en bois, bah, les hippies les brûlaient pour se réchauffer. Ces jeunes gens avec leurs cheveux longs, leurs chapeaux un peu spéciaux, leurs écharpes un peu spéciales, c’était une drôle de chose. Ça faisait un peu peur au village. »
Mais pour Guy et ses brasseurs de frères, comme pour tous les commerçants du coin – excepté le vendeur de fleurs artificielles, qui n’a pas su fourguer la moindre fausse pâquerette –, les chevelus « un peu spéciaux » sont avant tout une aubaine commerciale.
Le Soir du 27 octobre 69 évoque « 120 000 petits pains, 90 000 bouteilles de bière sans alcool, près de 100 000 saucisses, des frites comme s’il en pleuvait ! ». Le Courrier de l’Escaut, lui, préfère compter les saucisses dans leur longueur, annonçant une ribambelle totale de 24 kilomètres. Sur la place d’Amougies, le café La Fanfare – devenu le bureau Bpost – accueille les festivaliers. On y dort, comme on peut, pour 20 francs la nuit, et le patron installe une baignoire à l’extérieur, où l’on se lave les dents, tout en écoutant les sermons de Mouna, grand prêtre libertaire de l’époque, toujours à bicyclette, qui harangue les foules pour prôner la paix et fustiger l’arme atomique.
Des navettes font Paris/Porte de la Chapelle – Amougies trois fois par jour, les voitures et bus affluent de partout, de Belgique, de France, d’Angleterre, des pays du Nord.
Et la presse locale, surexcitée, n’a qu’une question en tête : « C’est quoi, des hippies ? »
Le micro-trottoir de Nord Éclair est catégorique : « Il paraît que ce sont des Anglais qui courent tout nus. » Les plus téméraires (Nord Matin) vont au contact : « J’ai rencontré un drôle de Christ. Veste de velours amarante, barbe, foulard au front ; un chardon dans la main. Je lui ai demandé : “Que faites-vous dans la vie ?” »
- « Rien, comme vous d’ailleurs. »
- « Mais moi je travaille ; je suis journaliste, syndiqué et cotisant à la Sécurité sociale… »
- « Vraiment, vous ne faites rien. Ça ne veut rien dire ce que vous faites […] L’important, c’est d’abord de se connaître soi-même. Après, tu te rends compte que tout ce qui nous entoure s’écroule, parce que cela ne correspond à rien. »
Nord-Matin, à qui on ne la fait décidément pas, s’étonne : « Les filles étaient jolies, extravagantes parfois. Pas hippies pour deux sous pour certaines ; un peu “gosses de riches”. »
La légende locale raconte qu’on aurait vu de « belles » voitures se garer, des messieurs en costard en sortir, se déshabiller et se déguiser en hippies, pour aller rejoindre le chapiteau.
Guy, lui, entre deux ramassages de bouteilles, n’avait pas le temps de se poser des tas de questions. « Mais on prenait notre quart d’heure pour écouter. Je me souviens de cette scène de bien dix mètres de long. C’était la première fois que je voyais ça. Et la musique, c’était, bah très “spécial”, on ne connaissait pas du tout. Nous, on n’avait rien d’autre qu’un petit poste de radio tout simple, on écoutait Adamo, Mireille Mathieu, Johnny, Sheila. »

Le rock ingurgité
Il faut aussi se remettre dans cette période d’ébullition, faite d’interdictions et d’éclosions éphémères et non concertées. « Tout ça, c’est né spontanément. Ça correspondait à un besoin intérieur des gens de se regrouper, se rappelle Jean-Noël Coghe. Les groupes ne passaient pas à la télé, il y avait un côté magique de devoir aller sur place pour découvrir des choses. Il n’y avait pas encore de principe de tournées, où l’on suit des groupes. Ce n’était pas créé avec des logiques commerciales bien rodées. Mais très vite, le rock a été avalé, ingurgité, on en a fait quelque chose de respectable, car ça permettait de faire des recettes, de gagner de l’argent. » Aujourd’hui, est-ce qu’un Amougies serait possible ? « Certainement pas. »
À l’époque, même si Woodstock était déjà passé par là, l’événement n’était pas encore entré dans la légende. Surtout pas en Europe. Pour entendre ces nouveaux sons bouillonnants d’Angleterre, il faut écouter la radio pirate Caroline ou Radio Luxembourg. Et puis, avoir les moyens de se payer des vinyles.
Après ses cinq jours de fièvre sans heurts, Amougies est en tout cas retournée à son statut de village sans histoires. Karakos avait annoncé remettre le couvert, et pourquoi pas ici ? Mais le bilan est catastrophique pour l’organisateur, qui ressort rincé du festival avec 30 millions de francs de dettes (4,6 millions d’euros). Il ne parviendra pas à relancer la machine, malgré quelques tentatives au Mans ou à Biot (Sud de la France)… « Il mettra 15 ans à rembourser ses dettes d’Amougies », raconte Jean-Noël Coghe. Info impossible à vérifier, mais ce qui est sûr, c’est que, malgré les quelques captations, aucun film ne pourra être diffusé largement, pour une obscure raison de conflit avec Pink Floyd, en lien avec les droits d’auteur. Pas de diffusion, pas de légende…
Amougies retombera doucement dans l’oubli. Le cercle d’histoire locale a effectué un travail de fourmi dans les archives de la presse, certains se sont mobilisés le temps d’une exposition anniversaire ou de tentatives ratées de revival, mais, de toute façon, la culture, ici, ça ne vit pas. Ça vivote. Ledit cercle d’histoire, moribond, a perdu son local – repris par la commune pour une restructuration de la bibliothèque. Le centre de lecture peine à attirer autour de ses activités. Le dernier cinéclub n’a attiré que cinq personnes. À Mont-de-l’Enclus, à la maison des randonneurs, le mari de Thérèse Decock, Yves Schepens, cherche la recette miracle pour faire venir des locaux dans ses expositions.
Aujourd’hui, Amougies la joue tranquille. Mais une nouvelle forme de tranquillité. Pas celle de 1969, où la messe était dite comme il faut chaque dimanche (et même plus), où la commune comptait deux écoles (fermées en 2005), où l’industrie faisait vivre une bonne partie du village, dans les usines textiles (Uco, fermée en 1990) et Guisset (fermé en 1984), ou dans la scierie ou la fabrique de meubles Cousaert, une institution régionale et dont il ne reste à Amougies qu’un showroom un rien désuet, « Sélection Meubles », et son slogan publicitaire : « Un jour ou l’autre, vous y viendrez ».
Voisins flamands et vigilants
Ceux qui viennent ici, désormais, ce sont surtout des Flamands. Totalement absents en 69, ils représentent au moins 45 % de la population de Mont-de-l’Enclus, selon le bourgmestre. Voire plus. Attirés par un paysage préservé, ils s’expatrient juste de l’autre côté du mont (la frontière flamande traverse le mont de l’Enclus), profitant d’un marché immobilier moins saturé et moins cher, qui a su davantage résister à la fièvre constructrice. Résultat, les prix ont explosé cette dernière décennie, hissant la commune de Mont-de-l’Enclus au 2e rang des communes les plus chères du Hainaut, en 2020, avec une hausse de 32,5 % des prix en une année. La commune s’embourgeoise, et plus on s’approche du mont et de ses belles vues panoramiques, plus les prix explosent. En 2019, le bourgmestre (toujours) libéral a même dû interdire les panneaux « Te Koop » qui fleurissaient partout, obligeant les agences immobilières à écrire leurs pancartes aussi en français.
Sur le mont, jadis truffé de dancings, où l’on venait de loin pour sortir le week-end, on s’est réorienté vers un tourisme familial, propret et pépère. On vient se balader, admirer la vue, manger un petit plat, dans une brasserie bien tenue, puis on repart. Le bourgmestre Jean-Pierre Bourdeaud’Huy (MR) assume son choix de gestion d’une commune « tranquille, qui préserve le cadre de vie, refuse les zonings et les cheminées polluantes ». Sur les recettes annuelles de la commune, la moitié proviennent des taxes additionnelles sur l’impôt des personnes physiques et le précompte immobilier. « Ici, le taux de chômage est quasi nul », explique-t-il, même si « moins de 5 % des habitants vivent et travaillent sur la commune. »
Mais surtout, ce qui revient dans toutes les conversations de cette cité devenue dortoir, ce sont… les grilles. Celles qui poussent autour des propriétés, un peu partout. Et qui nous rappellent cette drôle d’impression qui nous avait traversée, la première fois qu’on était venue ici. En arrivant à Amougies, juste avant de traverser le petit pont qui enjambe le cours d’eau local (la Rhosnes), il y a un panneau. Rouge. Inratable. Sur ce panneau, une silhouette noire, bonnet noir, enjambe une fenêtre – un cambrioleur, évidemment. Et en lettres capitales, sur trois lignes, on peut lire ceci : « LES VOISINS VEILLENT ». C’est sûr, les hippies, les kilomètres de saucisses et les cuites à la Fanfare ne reviendront plus à Amougies.
RELAIS PRESSE
Interview de Chloé Andries + extraits d’archives sonores illustrant Amougies en 69, dans l’émission "Un jour dans l’Histoire".

Interview de Chloé Andries, autrice de ce récit, au micro de Nostalgie. A réentendre ici

-
Depuis la fusion des communes en 1977, Amougies, Anserœul, Orroir et Russeignies sont regroupées pour former Mont->de-l’Enclus, 3 805 habitants au total.
↩ -
Karakos, c’est aussi le gars qui a produit la lambada en 1989, juste pour info.
↩ -
Depuis 2019, la commune a signé un PLP (plan local de prévention), partenariat police-commune-citoyens destiné à veiller à la sécurité de la commune. Un dispositif surtout présent en Flandre (80 % des PLP en 2019), mais qui s’étend.
↩