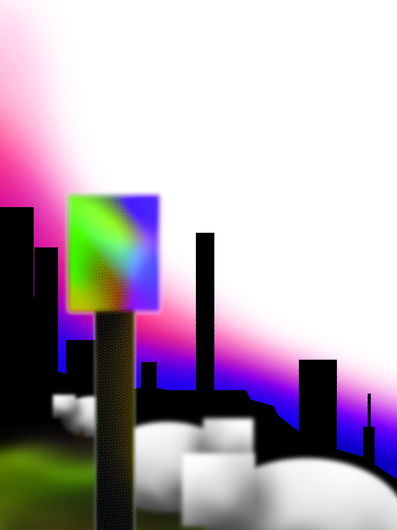Une vie rustique, une mort tragique
Traduction : Thomas Lecloux
Photos : Frederik Buyckx
Textes : Kasper Goethals (De Standaard)
Publié le

Le journaliste Chris De Stoop
À Saint-Léger, un village agricole aux abords de Mouscron, deux mondes qui s’ignorent sont entrés en collision. Le journaliste-écrivain flamand Chris De Stoop signe un livre magnifique sur le meurtre de son oncle Daniel, agriculteur, par des jeunes marginalisés. De Standaard est allé à sa rencontre.
« C’est ici qu’il repose, enserré entre le réservoir d’eau et d’autres tombes de pauvres. » Nous sommes au cimetière de Saint-Léger, sur la commune d’Estaimpuis, près de Mouscron. L’auteur Chris De Stoop m’a emmené sur la tombe de son oncle Daniel Maroy. Au milieu d’une demi-douzaine de croix de bois à la mémoire de pauvres hères morts sans le sou, entre les orties et autres plantes sauvages qui s’immiscent parmi les sépultures, Maroy est le seul à avoir une pierre tombale de marbre. Sous la date de décès, une simple phrase qui éveille, à dessein, des questions : « Une vie rustique, une mort tragique. » Chris De Stoop a fait placer la pierre l’année dernière : « Je suis content qu’il repose ici, au pied des murs médiévaux de la ferme du Temple, où sa tante a travaillé toute une vie de fermière. Mais je voulais inviter les visiteurs à s’arrêter sur son sort. D’où cette phrase. La blessure peut guérir, mais la cicatrice reste bien là. »
Un samedi soir de mars, il y a six printemps, Daniel Maroy, 84 ans, avait été cambriolé, battu et assassiné par une bande de jeunes blancs-becs. Comme chaque samedi, il était allé faire quelques courses chez Colruyt, à un kilomètre et demi de sa vieille ferme en carré. Un steak – blanc bleu belge –, un casier de Rodenbach, une poignée de chicons. Sur le chemin du retour, prenant appui sur son vieux vélo, il avait fait halte à la boucherie d’Yvette, qu’il avait en vain demandée en mariage 25 ans auparavant. Il s’y arrêtait toujours un instant. Enfin, il était péniblement rentré chez lui, avait franchi le portail de sa ferme et l’avait refermé avec un bête bout de corde, puis était entré par le côté sans reverrouiller la porte.
Ivre de gloire
C’était une « proie facile », dira-t-on plus tard. Depuis que des huissiers avaient saisi l’essentiel de ses champs, dans les années 90, il ne faisait plus confiance aux banques et payait tout en liquide. Les caissières l’avaient d’ailleurs mis en garde : « Pourquoi fais-tu ça, Daniel, agiter tout cet argent ? » Un jeune stagiaire du magasin avait ensuite colporté l’information auprès de ses copains, dans le village voisin. C’étaient de petits délinquants, dealers d’herbe renvoyés de l’école après plus de cent jours d’absence. La plupart venaient de familles en lambeaux, vivant dans des quartiers à problèmes. C’était de l’argent facile, se disaient-ils. Qui sait combien de billets étaient planqués dans la ferme ?
Ce soir-là, Maroy avait été cambriolé à deux reprises. La première fois, quelques jeunes l’avaient frappé à l’aide d’une planche jusqu’à ce qu’il perde connaissance, et lui avaient volé 13 000 euros. La seconde fois, deux autres membres de la bande étaient revenus. Eux aussi voulaient leur part du butin. Maroy gisait au sol, inconscient, mais ils l’avaient tout de même frappé, encore et encore, à la tête, avec le métal d’une fourche. « Je vais le tuer », avait clamé l’un d’eux avant l’expédition, ivre de gloire, d’alcool et d’adrénaline. Ils ont filmé le tabassage avec leur téléphone, puis arraché le poêle à charbon du mur et l’ont balancé sur les jambes du vieil homme pour l’empêcher de fuir. Tout cela pour 6 000 euros et quelques bijoux de plus.
POUR UN iPHONE
Plus tard, ils s’en étaient vantés devant leurs amis au café. « Branche le téléphone sur les haut-parleurs de la voiture, ont-ils dit. Pour bien entendre les coups. » Ce bruit, c’était comme un piquet de clôture qu’on enfonce dans le sol, écrit Chris De Stoop dans son livre Het Boek Daniel, récemment paru aux éditions De Bezige Bij. En trois jours, ils ont dilapidé tout l’argent, le fruit d’une vie entière de travail agricole. Il leur fallait le nouvel iPhone 5S, puis ils ont acheté des mobylettes et une vieille Golf.
Pendant encore une semaine, ils sont restés seigneurs et maîtres de la vieille ferme. De Stoop possède des indices selon lesquels ils y seraient revenus chaque jour, « au moins quatre fois ». Ce n’est qu’au bout d’une semaine qu’ils ont bouté le feu à leur victime et à sa propriété, pour faire disparaître toute trace. Seules les quatre vaches dans l’étable ont été sauvées des flammes. Une d’elles figure sur un cliché pris par un photographe de presse alerté par les pompiers. L’animal y apparaît hagard, noué à sa corde, luisant de sueur devant le brasier. Quelques jours plus tard, toutes les vaches ont été piquées par suite de l’intoxication à la fumée.
Le meurtre et l’incendie n’avaient été rapportés que dans la presse locale. Mais six ans plus tard, un visage est enfin apposé sur le nom de Daniel Maroy. Dans son nouveau livre, Chris De Stoop retourne tous les cailloux du village. Il a suivi l’affaire pendant des années, jusqu’à ce qu’elle soit enfin jugée par la cour d’assises l’an dernier. Comme personne ne s’était constitué partie civile, De Stoop a lui-même plaidé devant le jury populaire. « Je voulais que justice soit faite pour mon oncle. Les jeunes devaient être punis. »
Ils l’ont été. Au bout de deux semaines de procès, les cinq accusés ont été condamnés à des peines allant jusqu’à quinze ans de prison. « Un jugement dur, mais ce n’était que la moitié de ce que le procureur réclamait. J’en ai été satisfait. Il y avait des circonstances atténuantes. »
Parias
Chris De Stoop, ancien reporter pour Knack, s’est fait un nom en 1992 en sortant un premier livre, Ze zijn zo lief, meneer [Elles sont si gentilles, monsieur], consacré au trafic international de femmes. Ses quatre premiers ouvrages ont tous été suivis de commissions d’enquête ou d’auditions parlementaires, et ont donné lieu à d’importants débats sociétaux. Depuis – il en est à son quatorzième opus –, le scandale politique le fatigue. « Ça détourne l’attention du livre, donc j’essaie de l’éviter », dit-il. Mais De Stoop reste un auteur de non-fiction journalistique en recherche permanente des déshérités qui incarnent notre époque. Ce qui rend Het boek Daniel unique en son genre, c’est la rencontre entre deux mondes marginalisés qui ne se croisent que rarement. Tout comme son plus grand succès, Dit is mijn hof [Ceci est ma ferme], ce livre est une ode à la vie paysanne anéantie, mais aussi une recherche objective sur la dislocation sociale qui peut déboucher sur la délinquance juvénile. « Généralement, on voit cela dans les villes, comme l’été dernier à La Haye, Blankenberge et Bruxelles, mais cette bande-ci traînait à deux kilomètres de la ferme de Daniel. »
Qu’est-ce qui a conduit ces jeunes à une telle violence ?
Chris De Stoop : « Un des garçons avait 21 ans, les autres 18, mais ils étaient encore très immatures. Presque tous venaient de familles déchirées. Certains avaient des parents absents ou agressifs. Ils ne réussissaient pas à l’école et avaient perdu confiance en l’avenir. À part un, dont le père est un entrepreneur connu de la région, ils venaient des cités les plus défavorisées d’Estaimpuis et de Roubaix – la ville la plus pauvre de France. À 13 ans, certains fumaient cinq grammes d’herbe par jour. Pour financer cette addiction, ils avaient appris très jeunes à cambrioler, mais ils n’avaient jamais commis d’actes d’une telle horreur auparavant. Le jugement dit clairement que le motif était purement matériel. Ils voulaient s’acheter des vêtements et des téléphones chers et une possibilité s’est présentée. Selon moi, ces faits s’inscrivent dans une culture de l’addiction à des stimuli constants et de la satisfaction immédiate. Par ailleurs, ces jeunes ne savaient rien de la vie paysanne. Ils n’avaient pas une once d’empathie à l’égard de leur victime. Ils l’appelaient “le dégueulasse” et l’ont frappé avec des outils qu’ils n’avaient jamais tenus en main auparavant. C’est du fait de cet éloignement et de cette excitation que ces jeunes ne respectaient pas mon oncle. Dans le jugement, il est écrit qu’ils le voyaient comme un sous-homme – une déclaration extrêmement dure. »

Pourquoi teniez-vous à leur parler en prison ?
CDS : « Parce que je pars systématiquement du principe que toute histoire a deux versants. Je trouve qu’il faut examiner le terreau de cette violence, mais en précisant toujours que ce n’est ni une explication ni une excuse à leurs actes. Dans toutes ces familles, on trouve aussi des frères et sœurs qui ont suivi une bonne trajectoire, qui ont étudié et trouvé du travail. Ce n’est qu’une petite minorité qui se laisse happer par la violence. Ce sont toujours des jeunes qui portent en eux une certaine vulnérabilité, qui ne semblent pas armés psychologiquement et se retrouvent coincés dans une spirale négative. Ici, dans la région de Mouscron, une ville ouvrière pleine d’ardeur, on rencontre plus de profils à risque que par exemple chez moi, dans les polders du pays de Waes, parce que l’inégalité sociale y est plus creusée. Notre société doit prêter attention à ces gens dépourvus de perspectives, car l’inégalité ne va faire que croître sous l’effet de la crise du coronavirus. On observe déjà plus de tensions et d’incidents. »
Vous mettez l’accent sur la psychologie et la sociologie, mais le débat public porte de plus en plus souvent sur la culture, la religion et l’origine. Ces aspects ne jouent-ils pas un rôle ?
CDS : « Deux des cinq condamnés avaient des origines allochtones musulmanes, mais seulement du côté paternel et trois générations en amont. Je ne le dissimule pas : je les ai appelés Rachid et Ahmed dans mon livre, et j’évoque aussi au passage le ramadan et un boucher halal. Je ne pense pas que cela ait joué un rôle cependant, donc je suis content que cet aspect n’ait pas été abordé lors du procès. Selon moi, il s’agit de causes plus profondes. En cherchant l’explication dans un modèle de culpabilité individuelle et en appelant à répondre par la répression, comme le fait, par exemple, le sociologue Mark Elchardus, je pense qu’on risque de virer rapidement dans la mauvaise direction. Mais je ne suis pas défaitiste. Mes livres se fondent – naïvement ou non – sur une écriture engagée et un certain optimisme. Mais l’esprit de l’époque a changé. Il y a deux ans, sur un plateau de la VRT, on m’a présenté comme “un homme véritablement bon”. J’ai trouvé cela dérangeant, mais aussi révélateur. Je préfère être un homme bon que l’inverse. Plutôt croire à un monde meilleur que de verser dans le cynisme. »
Un monde silencieux
Sous-homme. Le mot a quelque chose de sinistre, vu du petit cimetière désolé de Saint-Léger. Les cafés du coin, Au Repos des Alliés et La Tranquillité, où la fille de l’aubergiste avait autrefois organisé la résistance contre les nazis, rappellent la dernière époque où un tel vocabulaire s’employait. De Stoop nous guide entre les sépultures de plus en plus anciennes, autour de la magnifique église médiévale bâtie de pierres extraites des riches carrières de Tournai. Les grands-parents, les oncles et les tantes de Daniel reposent ici, tout comme sa mère et son frère.
« Il s’est occupé toute sa vie de son frère malade, Michel, comme il l’avait promis à sa mère. Ce n’est qu’à la mort de celui-ci, en 1992, qu’il a demandé Yvette la bouchère en mariage. L’affaire était gênante, car Yvette l’a éconduit et il a continué de se rendre à la boucherie. Aujourd’hui, on y verrait peut-être des assiduités intempestives, mais, dans un petit village, c’était toléré. Quand l’amour lui a tourné le dos, il s’est isolé. À la fin, il ne parlait plus qu’à cinq personnes, mais elles ont dit de lui qu’il était certes difficile de gagner sa confiance, mais encore plus de la perdre. »
Le long de l’enceinte du cimetière, après une rangée de sépultures de guerre identiques de soldats britanniques, se trouve la tombe du grand-père de Daniel, qui avait fui la Flandre pour venir s’installer ici à la fin du XIXe siècle, pendant la crise agricole. « C’est ainsi que cette branche de ma grande famille de paysans a atterri en Wallonie, bien avant l’existence de la frontière linguistique, explique De Stoop. Ma mère était la cousine de Daniel. Elle parlait avec lyrisme, voire avec jalousie, de sa vie ici à la ferme. »
Une chaleur de plomb s’abat sur les champs. C’est le jour de septembre le plus chaud jamais enregistré. Les arbres épars sont desséchés. Les plants de maïs et de betteraves sont les derniers encore en terre. Nous roulons jusqu’au croisement où se trouvait la ferme de Daniel. Il n’en reste plus rien. Les ruines incendiées ont été abattues et le terrain a été vendu à un couple de Mouscron qui y a établi un manège. Seules les pierres de l’étable restent amoncelées à côté d’un enclos de dressage.

De Stoop connaît bien ce monde silencieux. Il s’est consacré entièrement à ce livre pendant un an et demi et a parlé à des dizaines de personnes de la région. De surcroît, il ressent une empathie naturelle à l’égard de cette vie paysanne qui a été détruite sans aucun égard au fil des cinquante dernières années. En 1971, il avait écouté à la radio les échos de la manifestation d’agriculteurs à laquelle son frère et son père participaient, parmi 100 000 autres. Ils protestaient contre le plan Mansholt de l’Europe, qui entendait rendre les entreprises agricoles plus « rationnelles » et plus rentables en misant sur l’agro-industrialisation. Un paysan avait été abattu. « Les agriculteurs ont dû s’endetter pour s’agrandir. Les petits ont coulé et ont été avalés. Le bilan a été catastrophique pour le cadre de vie, la culture et les relations sociales des paysans. Je l’écris dans mon livre. Il existe des milliers de Daniel. Sur le temps qu’il a exploité la ferme, plus de choses ont changé qu’en mille ans auparavant. J’ai connu les années 60 : dans les campagnes comme celle-ci, le travail se faisait encore entièrement à la main et on voyait les mêmes instruments de travail que dans les tableaux de Brueghel. Heureusement, d’innombrables agriculteurs ont résisté et le modèle américain n’a jamais pu tout à fait être copié ici, mais nous avons tout de même profané le berceau de notre culture. »
Daniel est-il une victime du système, de lui-même ou d’une bande ?
CDS : « Certaines réactions m’ont fortement dérangé, comme celles du bourgmestre du village et du psychiatre au procès, qui ont dit qu’il avait lui-même choisi sa vie de reclus et s’était lui-même extrait de la société. Implicitement, ils l’ont ainsi tenu pour coresponsable. Comme s’il avait provoqué son assassinat. J’ai trouvé ces propos incroyablement insensibles. Chacun a le droit, individuellement, de mener la vie qu’il estime être la meilleure. Cela ne dispense pas la société de son devoir de prendre le meilleur soin possible de tous. Et Daniel n’avait certes plus beaucoup de contacts sociaux sur le plan horizontal, mais il cultivait un attachement vertical : celui qui le liait à ses parents et à la ferme de ses ancêtres. C’était ce qu’il y avait de plus important dans sa vie. Il entretenait un lien avec la terre qu’aucun de nous n’est plus capable d’imaginer.

Qui, parmi nos jeunes, peut encore s’imaginer une vie qui se confond entièrement avec une petite exploitation agricole perdue ? Qui peut encore s’imaginer ce qu’est une relation très intense avec des vaches ? Je peux vous le garantir, cette relation peut être d’une intensité énorme. Cet attachement vertical est selon moi presque aussi important que les relations horizontales, mais nous l’avons en grande partie perdu. »
Vous paraissez tantôt social-démocrate, tantôt au contraire conservateur dans votre plaidoyer.
CDS : « Tel est mon lot, en tant qu’écrivain engagé mais indépendant. Quand j’ai écrit Ze zijn zo lief, meneer [Elles sont si gentilles, monsieur], Johan Vande Lanotte (sp.a) l’a utilisé pour lancer sa carrière au Parlement. J’ai ensuite publié Haal de was maar binnen [Vite, rentrez le linge !], une dénonciation de la politique de rapatriement brutale des étrangers menée lorsque ce même Vande Lanotte était ministre de l’Intérieur. Là, j’ai été conspué par les socialistes. Et après mon livre Dit is mijn hof [Ceci est ma ferme], qui prenait en ligne de mire les compensations environnementales, j’ai été insulté par les écologistes. La déchéance des campagnes et la désertification des villages – Saint-Léger comptait autrefois 1 300 habitants et 200 agriculteurs, contre 700 habitants et cinq agriculteurs de nos jours ; et les enfants qui partent étudier à Louvain-la-Neuve et à Mons ne reviennent pas – ont indubitablement joué un rôle dans l’écœurement qui explique en partie le succès de la droite populiste. Mais je pense que les nationalistes flamands et les verts peuvent s’accorder sur le fait que le paysage détermine en grande partie l’identité. Et qu’il faut donc lutter contre cette destruction. Cette thématique dépasse les clivages gauche/droite. C’est cette aliénation, chez les jeunes comme chez les vieux, et dans les milieux urbains comme ruraux, qui conduit à des drames comme celui de Daniel. »
Le philosophe conservateur Roger Scruton disait que les traditions sont « des réponses à des questions que nous avons oubliées ».
CDS : « Les traditions revêtent une importance considérable, j’en suis convaincu. Elles s’appuient sur bien plus que quelques usages folkloriques. Ce sont des valeurs et une manière de vivre que l’on ne peut jeter par-dessus bord d’une année à l’autre sans en subir le contrecoup. À les renier trop brusquement, on déclenche des processus de déracinement qui génèrent un profond ressentiment. Les politiciens peuvent l’utiliser et le présenter comme un combat, afin de récupérer le malaise à des fins politiques. Il faut donc considérer ces questions avec nuance, même s’il est compliqué de faire abstraction de toute la charge émotionnelle que nous laissent nos origines, et des traditions qui y sont associées. »
« Le sang et le sol », disaient les nazis.
CDS : « Dans les années 30, ce sentiment de déracinement a effectivement été exploité sans vergogne. C’est là que réside tout le danger. De nos jours, une frustration semblable nourrit à nouveau un tel ressentiment. Et certains veulent à nouveau l’exploiter. Raison de plus pour moi d’écrire ces livres et d’illustrer ces processus. Je considère qu’il est de mon rôle d’exposer des problématiques qui influent sur notre vie à tous mais reçoivent bien trop peu d’attention. Pour une majorité de Belges, la vie agricole n’est éloignée que d’une, deux ou trois générations. Pourtant, les usages qui allaient de pair avec cette vie ont été complètement perdus. Beaucoup ressentent aujourd’hui un manque. »
Existe-t-il des solutions ?
CDS : « Je n’en avance jamais dans mes livres. La tâche de l’écrivain est de soulever des questions et de les prendre à bras-le-corps, mais pas d’y apporter les solutions. Cela dit, à titre personnel, je mettrais l’accent sur des termes à forte connotation associative, comme “ancrage” et “réhumanisation”. Ces concepts peuvent sonner creux, mais ce sont là des processus vitaux qui peuvent être traduits en programmes d’investissement très concrets. Par exemple dans la campagne où nous nous trouvons, qui recèle encore de belles parcelles à sauver. La région qui s’étend entre ici et Tournai vaut encore largement la peine qu’on se batte pour elle. Mais il faut alors investir autant dans une campagne viable pour le XXIe siècle qu’on a investi pour le choix précédent, c’est-à-dire l’agriculture industrielle. Il faudra conserver une certaine échelle de production pour nourrir ces milliards de personnes, mais le monde appelle à cor et à cri un retour à l’échelon local.
L’ironie veut que ce soit dans une ferme sociale que j’aie retrouvé le stagiaire de chez Colruyt qui avait averti la bande à propos de l’argent de Daniel. Son père s’était suicidé et il était là avec son frère et sa sœur. Les fermes peuvent être plus que des machines économiques. Le tourisme à la ferme, les fermes sociales, l’agriculture écologique et les ateliers de familiarisation des enfants à la terre, par exemple, restaurent le lien avec nos racines, notre terre et notre nourriture, et apaisent l’aliénation et le déracinement qui sont, parmi d’autres facteurs, à la base de nombreux problèmes sociaux. Quand on traverse l’Europe aujourd’hui, on ne voit que le triste échec de la politique agricole. Je voudrais donc demander à la Commission européenne de soutenir désormais l’agriculture locale avec au moins autant de moyens que l’agro-industrie au siècle dernier. »

Pour prolonger ou accompagner la lecture, Pointculture nous propose Sacripant de Karim Gharbi