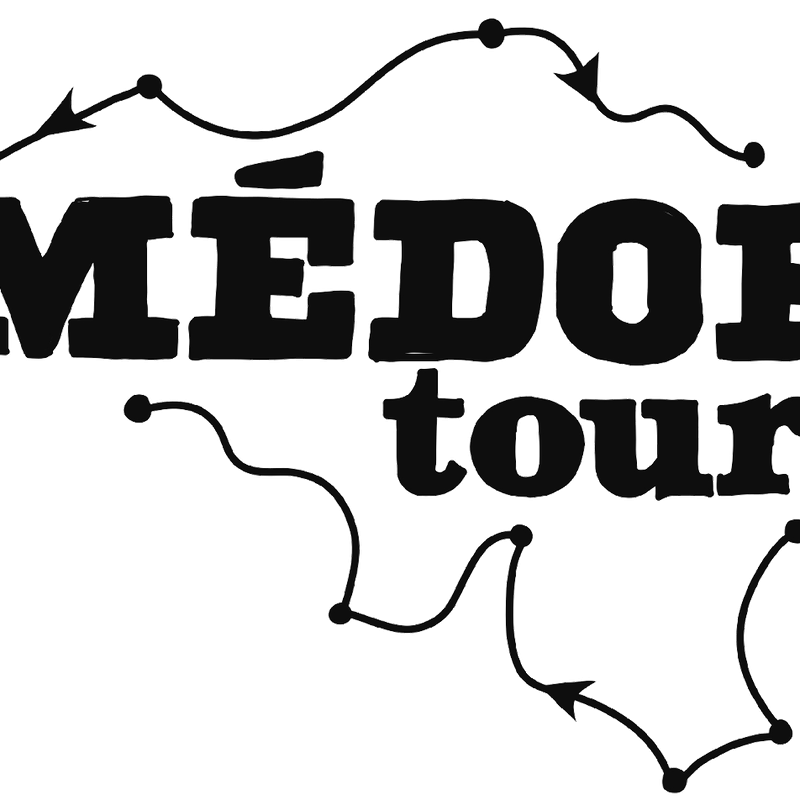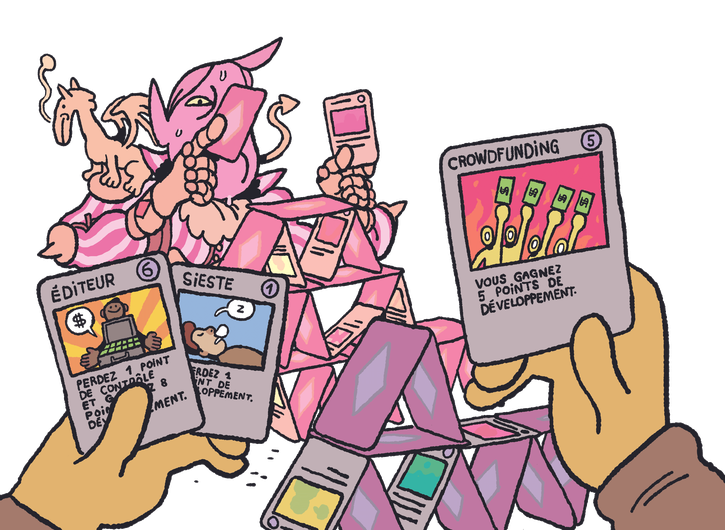Gais chimistes

Dans la communauté gay, certains s’envoient en l’air très haut, très longtemps, sous l’emprise d’une panoplie étendue de psychotropes. Le chemsex a essaimé avec le succès des applications de rencontre géolocalisées, comme Grindr. Pratique communautaire assumée autant qu’enjeu de santé publique, il défie les codes des usages de drogues.
« Vous avez déjà baisé sous cocaïne, Nick ? » Répondant elle-même à sa propre question dans une scène culte de Basic Instinct, Sharon Stone décrétait, dans une bouffée de cigarette : « C’est bien. » Laconique, la réponse avait l’avantage de la clarté. Elle est aujourd’hui partagée par une partie de la communauté gay, qui s’adonne avec enthousiasme à de sulfureuses associations chimico-sexuelles — dites chemsex. Même si l’ampleur du phénomène est difficile à cerner, il semble se développer, particulièrement dans les capitales européennes.
« Ma première fois, c’était à Berlin, il y a deux ans », raconte Jean-Philippe. « J’avais rencontré un garçon dans une soirée. On était tous les deux assez perchés. Après dix heures à danser et batifoler, on a décidé de prolonger les festivités dans ma chambre d’hôtel. Il m’a donné un peu de speed pour lutter contre la fatigue, et un quart de pilule de Viagra. Ensuite, il m’a proposé de prendre du GHB, ce que je n’avais jamais essayé. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. L’effet est progressif. On n’a pas le sentiment d’être drogué, mais tout devient beaucoup plus intense. Le sexe devient passionné. On est enivré par la peau, l’odeur, la chaleur de l’autre. Les baisers sont fougueux, les caresses sont électriques. Quand je le pénétrais, j’avais un sentiment de fusion extraordinaire. On a baisé pendant dix heures d’affilée, quasi non-stop, en reprenant régulièrement du G et du speed. De temps en temps, on s’endormait pendant dix minutes, puis on recommençait. J’avais l’impression que le gars était un prix Nobel de chimie tellement le cocktail qu’il m’avait concocté était efficace. Je repense souvent à ce dimanche à Berlin. »
Bien sûr, le mélange de sexe et de drogue est vieux comme le monde. Mais avec le chemsex, il atteint une dimension nouvelle. On ne parle pas de fumer un petit joint avant de filer sous la couette, mais de marathons sexuels, très souvent à plusieurs, sous l’emprise de produits chimiques variés (cocaïne, GHB, kétamine, crystal meth et autres dérivés amphétaminiques), dont certains s’achètent en toute tranquillité sur Internet, à la faveur du flou entourant la légalité des compositions. À ces mélanges s’ajoute la « prep », les pilules préventives qui empêchent la contamination au HIV. Sans oublier le Viagra, rendu nécessaire tant par la durée des orgies que par la consommation de drogues elle-même, peu propice à l’érection.
Consommation communautaire
« Les niveaux de consommation de produits ont toujours été plus importants chez les gays que dans la population générale », observe Stephen Karon, travailleur social et chercheur dans le secteur de la santé communautaire. La culture festive de la communauté gay n’explique pas à elle seule ce rapport particulier au chimisme ; l’épidémie de sida y a également contribué, en banalisant la prise de nombreux médicaments, qu’il s’agisse de la trithérapie ou de la prep. La maladie a aussi favorisé l’émergence d’un culte du corps, y compris avec l’aide de stéroïdes. Aux images insoutenables des corps affaiblis par le sida, dans les années 1980 et 1990, a succédé « la représentation du mâle brut, musclé, sportif, en bonne santé », devenue « le moyen d’échapper à cet amalgame ultra-violent : sida égale pédé », résume un article médical français consacré aux déterminants du chemsex.
La sexualité gay elle-même a toujours été libre et transgressive, poursuit Stephen. Le chemsex s’inscrit dans une histoire culturelle, et ne constituerait pas une tendance nouvelle, bien que le phénomène commence à attirer l’attention du secteur médical et des autorités publiques. « Il ne faut pas dramatiser. Certaines personnes se perdent, mais ce n’est pas le cas de la majorité. On oublie les trajectoires individuelles où les gens ont consommé, puis en sortent sans problème ». Problématiser le chemsex reviendrait à « renforcer le stigmate » dont souffre la communauté gay. La pratique est d’autant plus difficile à catégoriser que la plupart des chemsexeurs ne sont pas marginalisés : les trois quarts sont diplômés du supérieur et ont un emploi.
Parlons-en
Faut-il pour autant taire les risques psychosociaux engendrés par le chemsex ? Pas à en croire François Leclercq, un ancien chemsexeur qui a fondé un groupe de discussion sur le sujet. « Tant que tu veux te défoncer et baiser, tu trouveras toujours des gens, mais une fois chez toi, tu te poses des questions. Tu as l’impression que tu es seul à te morfondre le lundi soir. » Chaque lundi, le groupe bruxellois Let’s talk about chemsex offre une écoute, un espace de partage. « Cela rassure les gens de voir qu’ils ne sont pas seuls. Il y en a qui se disent du coup que ce n’est pas si grave, ils viennent pour se dédouaner. Chez d’autres, cela va déclencher un processus. »
Au sein même du groupe de parole, les mots sont choisis pour éviter toute stigmatisation, toute culpabilisation. « Dès qu’on parle d’addiction, ça ne va pas », note François.

« Beaucoup pensent qu’ils gèrent. Ils disent : “On est déjà assez marginalisés, ne venez pas nous faire la leçon.” » Le vocabulaire même du chemsex reflète la volonté d’éviter d’en faire un problème : par exemple, on ne se pique pas, on se « slamme ».
Mais le choix des mots ne modifie pas la composition des produits. Même sous le petit nom de « tina », la méthamphétamine reste une drogue particulièrement addictive. Et certains mélanges sont dangereux, voire mortels, comme celui du GHB avec l’alcool. « Il y a plusieurs accidents par week-end, et parfois des décès », note François, qui en a recensé quatre en dix ans en Belgique. Au-delà des accidents, la pratique peut engendrer des problèmes psychologiques et relationnels. La dépendance, bien sûr, mais aussi la difficulté d’éprouver du plaisir sexuel sans adjuvant chimique, ou encore la désocialisation. « Pour moi, c’était devenu un boulot à temps plein : planifier, organiser, trouver les bonnes personnes et la drogue. Ça remplissait toute ma vie », dit François, qui a aujourd’hui tiré un trait sur son addiction.
Chemsex pour tous ?
Addictif, le chemsex ? Évidemment. Pourrait-il en être autrement avec l’association de deux sources de plaisir intense ? Si au départ, les usagers recourent aux produits « pour se désinhiber » ou « parce qu’ils n’assument pas leurs fantasmes », certains en viennent à consommer « pour pousser les limites, essayer des trucs SM, hard », explique encore François. Dans une ambiance qui frise parfois le film porno : « Tout le monde est en harnais et mini-short avec de grandes chaussettes de sport. »
Quoique bien ancré dans l’imaginaire sexuel gay, le chemsex est-il voué à rester cantonné à cette communauté ? « Il y a des chances qu’on voie un phénomène qui aille au-delà », analyse Stephen Karon. L’arrivée de Tinder, calqué précisément sur l’appli gay Grindr, a mis à la portée des hétéros le plan cul géolocalisé. La pression de la performance, la tentation pornographique et l’accès facilité aux substances sur Internet sont d’autres déterminants communs aux homos et hétéros. De là à penser que la question de Sharon Stone deviendra bientôt parfaitement banale chez ces derniers, il y a loin de la croupe aux lèvres.