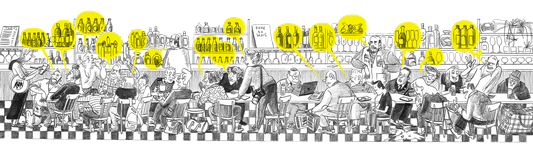Le Musée royal de l’Afrique centrale qui a rouvert ce 9 décembre 2018, était fermé depuis 2013. Idem pour l’exposition permanente. Entre la diaspora africaine, les scientifiques et les muséologues, l’explosion est permanente. Elle aussi.
Le vieil éléphant empaillé est imperturbable. Il est pourtant recouvert de bâches en plastique et entouré d’ouvriers qui s’agitent. À Tervuren, le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) fait peau neuve. Le bâtiment centenaire, de style néoclassique, est fermé depuis 2013, pour un sacré rafraîchissement. Depuis cette date, les collections ont rejoint le gigantesque entrepôt où des millions d’échantillons d’animaux, 100 000 poissons, des masques, des tambours, des instruments de musique, du bois, 17 000 serpents et 300 000 araignées, dont l’essentiel a été arraché au Congo à l’époque coloniale, sont rangés en attendant la réouverture. Pour Déborah Silverman, professeure d’histoire européenne à l’Université de Californie, et spécialiste du musée de Tervuren, cette collection, d’une ampleur colossale, est une « forêt pétrifiée du colonialisme constituée par l’extraction massive d’animaux, d’artefacts, de produits, pendant les décennies léopoldiennes. On a dépouillé des ressources culturelles et naturelles à une échelle inimaginable ».
Ce musée et cette collection sont intimement liés à l’histoire coloniale de la Belgique, et plus particulièrement à l’entreprise personnelle de Léopold II, qui dirigea seul (sans jamais y avoir mis les pieds) l’État indépendant du Congo de 1885 à 1908. En commandant l’érection de ce « musée du Congo » – à la suite de l’Exposition universelle de 1897 –, le souverain voulait mettre en avant son aventure commerciale, dont l’extraction des ressources était la motivation première, qui eut pour conséquence la soumission brutale des Congolais.
Changer l’exposition permanente
« Le musée était clairement un vestige de l’époque coloniale qui végétait depuis des années », explique Toma Muteba Luntumbue, artiste et professeur à La Cambre, qui, pour la première fois lors d’une exposition temporaire – Exit Congo Museum –, fit entrer l’art contemporain dans l’enceinte de Tervuren, au début des années 2000. C’est à cette époque que s’est imposée l’idée qu’il ne fallait pas seulement ripoliner la façade mais aussi s’attaquer au gros œuvre : l’exposition permanente. Celle-ci était figée depuis 1959. « Le musée avait l’image du dernier musée colonial au monde, reconnaît Bruno Verbergt, directeur opérationnel des services orientés vers le public. Et c’était encore vrai pour son exposition permanente. Dès les années 80-90, cela devenait de plus en plus gênant de présenter ces objets de la même façon. Il était temps de changer. »
Changer l’exposition permanente. Les employés du musée s’y attellent dès les années 2000. Le travail est long, complexe, hésitant. Au départ, personne ne parle de « décoloniser » le musée. On évoque un dépoussiérage, au mieux une modernisation de l’exposition. Dans les premières ébauches de scénographie, on ne consacre même pas une salle à l’histoire coloniale qui se voit reléguée au rang de discipline « transversale ». Mais en 2013, une évaluation effectuée par des muséologues du monde entier – interpelle les dirigeants du musée : « Vous ne pourrez pas y échapper, il faudra bien concevoir une salle dont le sujet sera l’histoire coloniale. »
C’est à la même époque que le Comraf (pour Comité MRAC-Associations africaines), un organe consultatif qui regroupe depuis 2003 des membres d’associations d’afro-descendants et des employés du musée, suggère que la direction consulte, pour son exposition permanente, six experts issus de la diaspora africaine. Ces derniers sont sélectionnés en 2014 et viennent en majorité du monde de l’art ou de l’université. Le dialogue va vite s’avérer complexe.
Anne Wetsi Mpoma fait partie du groupe. Elle est spécialiste de l’histoire de l’art. Il ne lui aura pas fallu longtemps pour remiser son enthousiasme : « Je pensais que nous allions élaborer des choses ensemble mais j’ai vite déchanté ; le musée n’attendait que des validations de notre part. Il a fallu négocier fermement pour apporter du contenu. » « Nous sommes arrivées en bout de course, ajoute Ayoko Mensah, programmatrice au département Afrique à Bozar. Cela faisait 10 ans que les travaux de rénovation avaient commencé, alors même que le musée ne proposait pas vraiment d’approche décoloniale. »
Les scientifiques dans leur bulle
Pourtant, c’est à cette époque – en 2014 – que la direction du MRAC commence à parler officiellement de « décoloniser » l’institution. Un terme fort qui suscite bien des réserves en interne, mais que Bruno Verbergt assume : « Pendant des années, le monde occidental a créé un discours, une vision sur le monde basée sur de fausses observations, en affirmant par exemple que les Noirs étaient moins évolués que les Blancs. Celles-ci ont alimenté une idéologie qui a soutenu la colonisation, qui a façonné le discours colonial et donc aussi celui du musée. Décoloniser, c’est dévoiler ce mécanisme. »
Le propos est volontaire. Mais, pour certains membres du groupe des Six, il n’est qu’un paravent. La construction mémorielle reste, au fond, toujours entre les mains des experts du musée. C’est ce que dénonce Toma Muteba Luntumbue : « Le directeur, c’est un peu le ministre des Colonies. Au sein de son ministère, le personnel du musée croit détenir le monopole du discours sur l’Afrique. » Dès 2014, c’est un fossé d’incompréhensions qui a séparé les six experts de certains employés du musée. On peut l’expliquer par l’organisation même de l’institution et ses batailles intestines sur lesquelles sont venus se greffer les six consultants externes. Le MRAC, bien avant d’être un musée, est un institut scientifique. On y compte 249 employés divisés en deux catégories. D’un côté, les spécialistes de la muséologie, responsables de la présentation, du lien avec le public, et de l’autre, les scientifiques. Ces derniers constituent une cohorte de 97 personnes. Ils sont eux-mêmes divisés en spécialistes des sciences humaines – histoire, anthropologie – et des sciences « dures » – biologie, géologie. Ce sont les scientifiques qui gèrent les collections.
Conflits de territoire
Entre scientifiques et muséologues, la tension est vieille comme le MRAC. Bruno Verbergt l’explique clairement : « De manière schématique, on pourrait dire que le pôle muséologique estime que les objets sélectionnés doivent suivre le narratif et que le pôle scientifique demande que le narratif s’adapte aux objets qu’ils auront choisis. Faire une exposition dans un institut scientifique, c’est essayer de résoudre ces tensions. »
Billy Kalonji, président du dernier Comraf et membre du groupe des Six, donne des éléments de compréhension : « D’un côté, on trouve des gens ouverts qui éprouvent de l’intérêt pour nos propositions ; de l’autre, il y a un monde scientifique très fermé, des spécialistes de la géologie, des biologistes, auquel nous n’avons pas accès et qui vivent dans une bulle. » Gratia Pungu, une autre membre du groupe, renchérit : « Nous faisions face à une série de délégitimations. Tantôt nous n’étions pas assez africains, tantôt nous n’étions pas assez scientifiques. »
Dès 2011 pourtant, la direction du MRAC embauche Terenja Van Dijk, une spécialiste hollandaise du montage d’expositions, pour tenter d’insuffler de la cohérence dans l’élaboration chaotique de l’exposition permanente. Quatre ans plus tard, elle démissionne. Elle se heurte à d’interminables discussions internes. « Il y a beaucoup de scientifiques, aux points de vue différents, qui se battent pour leur territoire, explique-t-elle. Certains d’entre eux pensent que le musée est une plateforme pour montrer leur regard scentifique sur l’Afrique. Ils estiment généralement que tout cela n’a rien à voir avec le regard colonial. Sauf que le bâtiment est colonial et l’immense majorité des objets de la collection sont issus de l’histoire coloniale, on peut difficilement mettre ça sous la table. »
La salle sur l’histoire coloniale, dont le contenu n’est toujours pas arrêté définitivement, symbolise ces crispations. C’est une personne du « clan muséologique », mais historienne de formation, qui est en charge de sa conception, en relation étroite avec la direction. Au départ, pourtant, une scientifique menait la barque. Son nom : Patricia Van Schuylenbergh. Elle s’est aujourd’hui retranchée dans le service « histoire et politique » qu’elle dirige après avoir jeté l’éponge en tant que commissaire scientifique de la zone. L’historienne a une vision assez tranchée de sa fonction : « Je souhaite permettre au visiteur de se faire une opinion personnelle. Le musée n’a pas à avoir de parti pris. Si une position plus engagée est adoptée, eh bien, il ne s’agit plus d’une opinion scientifique. »
Au début des travaux, Patricia Van Schuylenbergh avait « fait une proposition scientifique, la muséologie a pris ce qui l’intéressait, ce qui ne reflétait pas mes choix personnels », dit-elle. Le conflit est alors bien réel entre des scientifiques et une partie de la direction. Le personnel du musée est aujourd’hui en ébullition. Un scientifique exprime son inquiétude : « Beaucoup d’entre nous ont l’impression de n’avoir pas été écoutés. Il semble que l’on s’oriente vers une exposition véhiculant une vision culpabilisante de la Belgique et auto-flagellante. Alors qu’il faudrait travailler sur l’image de l’Afrique aujourd’hui. »
Pour ce scientifique, la direction de l’établissement a trop concédé à des « historiens orientés idéologiquement » et à la diaspora : « Je m’étonne qu’on donne autant d’attention à des personnes qui n’ont pas une vision très actualisée de l’Afrique. Après tout, le musée de Tervuren n’est pas le musée de la diaspora. »

Représenter tout un continent
Les six experts de la diaspora, consultés par le musée, n’ont pourtant pas l’impression d’avoir été les bienvenus.
Lorsque les propositions concrètes pour la nouvelle expo leur parviennent, le groupe des Six montre sa déception. Leurs remarques s’apparentent, aux yeux d’employés du musée, à un travail de déconstruction méthodique un peu dur à avaler. Sans même parler des différences de rythme entre des professionnels bien au fait des dédales du MRAC et des extérieurs pour qui la consultance n’est qu’une activité d’appoint. Les attentes quant au groupe des Six sont contradictoires. Le groupe des Six pense qu’ils sont appelés à « cocréer » la nouvelle exposition, alors que Bruno Verbergt explique que leur rôle est d’exprimer une « expertise de sensibilité ».
La salle d’histoire coloniale, et le flou qui règne à son propos, illustre bien ces incompréhensions et les limites de la consultation. Son contenu, toujours secret, reste la prérogative du musée. En août 2017, le groupe d’experts de la diaspora aurait été informé des « textes-cadres » de la salle. Deux membres du groupe devaient les relire. Mais aujourd’hui, cette concertation est au point mort. D’abord parce qu’il « n’y a pas d’historiens » dans le groupe, nous dit Bruno Verbergt, ensuite, « parce que personne ne parle néerlandais et que les textes sont en néerlandais ». Exit la diaspora.
Pourtant, le contenu de cette salle est l’objet de toutes les attentions. « Dans les premières versions qui nous étaient présentées, Léopold II était quasiment absent, raconte Gratia Pungu. Et aujourd’hui encore, nous ne savons pas comment il sera présenté. »
L’enjeu est pourtant bien plus vaste que l’histoire coloniale. Le MRAC se considère comme un musée moderne qui met l’Afrique contemporaine au cœur de ses préoccupations. C’est l’un des points de friction les plus importants. Pour Matthias De Groof, chercheur à l’Université d’Anvers et auteur d’un documentaire en préparation sur la rénovation du musée de Tervuren, « le point de vue colonial reste présent malgré les bonnes volontés individuelles. Au sein du musée, on n’a pas abandonné cette idée de représenter l’Afrique via diverses disciplines scientifiques, selon la même approche qu’au XIXe siècle. Mais on ne peut pas, d’ici, avoir la légitimité pour représenter un continent ».
Controverses à tous les étages
Ce choc frontal de visions antagonistes a généré des controverses pour chacune des neuf zones d’exposition prévues. La façon de montrer les minéraux, leur extraction, les animaux, les parcs nationaux furent autant de motifs d’incompréhension. C’est ce que raconte Ayokof Mensah : « Dans la salle d’histoire naturelle, la faune, la flore, les paysages avaient tendance à être présentés hors de toute présence humaine, comme si l’on voulait présenter une vision “idéale” d’une Afrique qui n’aurait pas bougé. »
La scénographie de la savane boisée du Miombo et du parc national du Serengeti, via des diaporamas et des scènes de vie animalières « grandeur nature », a fait l’objet de vives disputes. « On dirait que cette présentation est destinée au public-safari », disait alors Gratia Pungu.
Dans ce contexte de méfiance, les idées des commissaires de la zone « journey of life » ont agi comme un repoussoir sur certains membres du groupe. Dans cette salle, l’équipe du musée propose de découvrir les habitants d’Afrique centrale à travers les grandes étapes de leur vie – la naissance, le mariage, la mort. « Pourquoi encore présenter les gens de manière si anthropologique au XXIe siècle ?, s’interroge Anne Wetsi Mpoma. Les Africains ne sont pas des objets d’étude, mais bien des êtres humains et à ce titre ils ne devraient pas être mis en vitrine ou exposés comme des objets de curiosité. » Dans cette salle, comme dans d’autres, le musée tente de présenter l’Afrique d’aujourd’hui avec des objets d’hier. Le paradoxe, pour le MRAC, se résume simplement : comment ancrer son travail dans le monde contemporain en s’appuyant sur une collection dont l’essentiel date de la période coloniale ?
Malgré ces différences de vues et les critiques relatives à la légitimité du groupe (« Il faudrait une représentativité plus grande de la diaspora. Il aurait fallu consulter plus tôt et plus largement », dit Patricia Van Schuylenbergh), certaines propositions du groupe des Six, ou de certains de ses membres, façonneront la future exposition permanente. « Une des salles d’exposition sera consacrée à la diaspora, détaille Billy Kalonji, c’était une de nos demandes. Une partie de l’exposition sera consacrée à la façon dont on a représenté et infériorisé les Noirs. C’est important car l’enjeu reste d’actualité. »
Pour plusieurs membres du groupe des Six (pourtant divisés sur plusieurs questions), le musée a « raté une occasion de faire bouger les lignes ». « Le risque est grand que la direction ne sache arbitrer et que l’on se replie sur des positions qui ne gênent pas, que l’on ne tranche rien », conclut Gratia Pungu. Mais, pour certains employés du MRAC, même si le travail en commun n’est pas facile, « il est nécessaire, comme le dit Isabelle Van Loo. Lorsqu’on ouvrira au public, nous ne pourrons pas rester neutres, il faut proposer des voix multiples ».
Bruno Verbergt confirme que le MRAC devra « adopter une position critique, au sens propre de ce mot : marquer la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C’est le rôle du musée d’informer et d’éduquer, pas de condamner », dit-il. Quelle sera l’ampleur de la critique ? L’enjeu est de taille, comme le rappelle Déborah Silverman : « La reconnaissance d’un passé honteux (comme la violence impériale) est capitale pour la réconciliation et la possibilité de construire une nouvelle histoire partagée. » Verdict à la réouverture des portes du musée, prévue pour le dernier trimestre 2018.