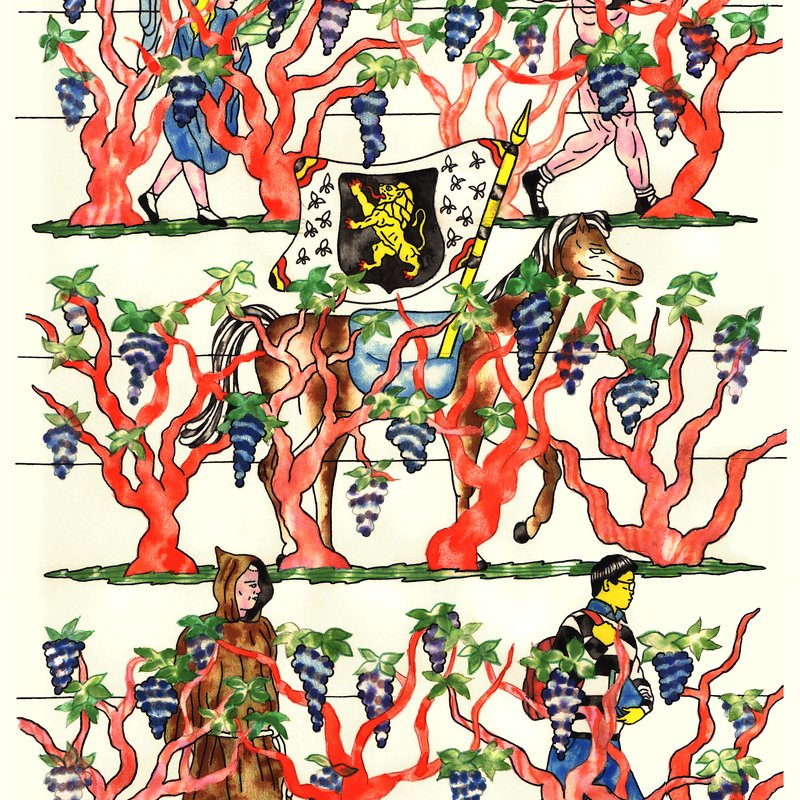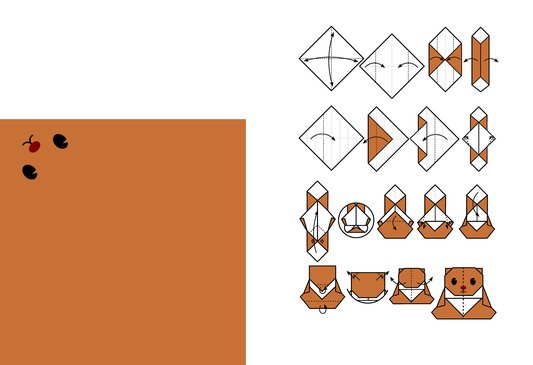« La campagne, c’est dans la tête »
Serge Schmitz
Si l’on exclut des territoires comme Monaco, le Vatican, Jersey ou Gibraltar, la Belgique est le deuxième pays le plus densément peuplé d’Europe, après les Pays-Bas.
Les 383,3 habitants par kilomètre carré interrogent en permanence le rapport entre les zones résidentielles, qui s’étendent, et l’espace rural. Reste-t-il encore de la place pour la campagne en Belgique ? Et la campagne, en 2025, c’est quoi finalement ? Un mythe qui survit dans nos têtes ? Un espace regardé de loin (ou de haut) par les médias ? Médor a (longtemps) cherché quelqu’un qui s’intéresse de près (et de pas trop haut) à ces enjeux. Ce ne fut pas évident.
« Et vous m’avez trouvé moi. Il faut dire que je suis presque le dernier exemplaire de géographe ruraliste en Belgique. » Lui, c’est Serge Schmitz, géographe né à Micheroux, à l’entrée du plateau de Herve. À l’ULiège, dans les années 90, il fait son mémoire sur les cimetières en ville avant de se plonger dans des recherches à cheval sur la géographie rurale et la géographie culturelle. Depuis, il observe la reconfiguration des campagnes à l’aune des grands bouleversements du siècle dernier.

La campagne, ça existe encore en Belgique ?
L’OCDE dit qu’il y a espace rural quand la densité de population est inférieure à 150 habitants par kilomètre carré. C’est totalement arbitraire. Si on regarde ce critère, on peut se dire qu’il y a de moins en moins d’espaces en Belgique qu’on peut vraiment considérer comme ruraux, ou de sociétés rurales. Donc certains disent que ça n’existe plus. Pourtant, quand on regarde la proportion de l’espace qui est occupé par l’agriculture et la forêt, cela reste quand même la majorité de la superficie wallonne. Mais les agriculteurs ne représentent plus qu’une infime partie de la population, moins de 1 % et ça diminue chaque année.
Faut-il encore nommer la campagne ainsi et l’étudier, si elle tend à disparaître ?
Pour moi, on commence à être à la campagne à partir du moment où la notion d’espace, de distance existe et se ressent. Donc quand on doit réfléchir pour se déplacer. La ville serait l’endroit où l’on a tout sous la main à moins de dix minutes, et la campagne, c’est l’endroit où on doit sortir sa voiture, son agenda pour avoir accès à une série de services. En plus, à partir du moment où des gens disent « je vais à la campagne, j’habite à la campagne », c’est qu’il y a encore une réalité derrière, qui est avant tout une représentation, mais qui se base sur des faits concrets. Définir la campagne par l’agriculture n’est plus opportun, vu la chute du nombre d’agriculteurs mais aussi la tendance à avoir de l’agriculture urbaine.
Le vert n’est donc plus l’apanage de la campagne ?
L’occupation du sol peut continuer à être un des indicateurs. Mais est-on à la campagne parce qu’il y a un espace vert ? Et à quoi sert-il ? À de la production ou de la récréation par exemple ? On vient de faire des recherches sur les prairies à chevaux. En Wallonie, on découvre qu’on a plus de prairies à chevaux que de champs de pommes de terre. En Flandre aussi (voir notre « Moment flamand » paru dans le Médor 4). Elles y représentent un tiers des prairies. Notre espace traditionnellement agricole et productif devient, par endroits, un espace plutôt de récréation, mais qui conserve une valeur économique aussi, car les gens payent pour le loisir à cheval, ça crée de l’emploi. Mais on n’est plus dans l’agriculture comme occupation des sols telle qu’on l’entendait avant. Cette campagne-là devient une campagne de loisirs, notamment en périphérie des villes comme Liège, Bruxelles, Anvers. Pour beaucoup de personnes, on est à la campagne dès qu’il y a une majorité d’espaces verts ou d’espaces agricoles. On peut habiter à Waterloo et dire qu’on habite à la campagne. La campagne, elle existe avant tout dans la tête des gens.
Quelle image entretient-on de la campagne ?
Une image archaïque. On a fait une étude en 2017 sur le tourisme à la ferme et quand on interroge des gens sur ce à quoi ressemble une ferme aujourd’hui, on se croirait dans un livre de Martine : les deux vaches, la mare avec le canard. Lors d’une grande enquête sur l’agritourisme, ça nous amusait de voir qu’il y avait souvent deux entrées dans les exploitations qui le pratiquaient. Une première à l’arrière, avec la boue, les machines… et une autre à l’avant, où les agriculteurs s’arrangeaient pour y garder un pot de fleurs, une vieille brouette, pour coller aux attentes. Car si on veut faire du tourisme à la ferme, personne n’a envie de se retrouver dans une ferme industrielle.
Je reste scotché par votre donnée sur les prairies à chevaux. Je pensais les grandes surfaces agricoles intensives de Hesbaye ou du Hainaut plus importantes.
Les campagnes belges sont quand même très diverses et il ne faut pas généraliser les observations faites à un endroit. En Wallonie, nous avons les plateaux limoneux consacrés aux grandes cultures, dans le Hainaut et la région hesbignonne. Moins dans le Brabant parce que le sol est un peu moins fertile et que la périurbanisation y est très importante. Dès qu’on passe le sillon Sambre-et-Meuse, on arrive dans d’autres types de roches et d’autres types d’agriculture.
La périurbanisation gagne aussi le Condroz, puis on arrive en Ardenne où s’opposent les forêts lorsque les pentes sont importantes, et les plateaux agricoles, où il subsiste encore de l’agriculture, mais extensive (très grandes terres, peu de main-d’œuvre et moins d’intrants que l’intensive, NDLR), donc beaucoup d’élevage. Selon les campagnes, on ne retrouve pas les mêmes paysages ni les mêmes modes de vie, notamment selon que la distance avec les villes est importante ou pas.
La Wallonie est fortement « périurbanisée ». Ça veut dire quoi ?
C’est le fait que des habitants de la ville migrent vers les campagnes pour bénéficier ne fût-ce que d’un jardin. Quand les ménages urbains ont des enfants et veulent un peu plus d’indépendance, sortir de leurs appartements, ils sont quasiment obligés de quitter la ville pour les espaces avoisinants. Selon leur niveau de revenus, ils doivent s’écarter de plus en plus de la ville pour chercher des terrains un petit peu moins chers.
Pour préparer cet entretien, vous m’avez envoyé un article d’un géographe britannique, Keith Halfacree, qui a travaillé sur un concept proche de la périurbanisation, celui de la contre-urbanisation. En quoi cela s’applique-t-il à la Belgique ?
La contre-urbanisation, c’est le fait de renverser un flux migratoire historique qui a fait bouger les gens des campagnes vers les villes. Après une génération ou plusieurs décennies en ville, les citoyens retournent vers la campagne parce qu’ils ont la possibilité d’y aller, grâce à la mobilité. Halfacree décrit quatorze types de populations rurales « contre-urbaines » selon les mobilités utilisées (avec les navetteurs quotidiens, les secondes résidences, ceux qui travaillent près de leur domicile, NDLR). Quand j’ai fait ma thèse, en 1999, sur la région de Vielsalm et les relations entre les habitants et leur environnement, j’ai mis en évidence la multitude des modes d’habitat et des façons de vivre à la campagne. Je me rappelle avoir interviewé un vieux taximan, et il me signalait que, dans les années 60, il partait le dimanche soir à Liège, et restait la semaine travailler, car il n’était pas possible d’envisager de faire les 70 kilomètres à cause de la route. Une réflexion pareille serait inimaginable aujourd’hui où beaucoup sont prêts à faire 150 kilomètres par jour pour aller travailler.
Avant la contre-urbanisation, il a dû y avoir l’urbanisation, qui a vidé les campagnes, donc ?
L’industrialisation a créé un appel de main-d’œuvre important au niveau des bassins miniers et sidérurgiques qui fait qu’on a appauvri, en quelque sorte, les campagnes. Mais le solde naturel (la différence entre le nombre de naissances et de décès sur un territoire donné, NDLR) restait très élevé dans les campagnes, et elles sont restées longtemps stables au niveau démographique. Ce solde a commencé à baisser dans la seconde moitié du XXe siècle, mais la désertification arrive seulement dans les années 60. J’ai collecté des récits de vie d’Ardennais qui rappellent qu’il n’y avait à l’époque plus que deux, trois fermiers vieillissants dans le village, que les maisons étaient vides.
Il y a donc eu un vrai décalage entre industrialisation et désertification des campagnes ?
Oui, c’est l’arrivée du tracteur, après la Seconde Guerre mondiale, qui a changé toute la donne et fait disparaître les petites entreprises agricoles familiales qui se contentaient de produire surtout pour la famille et vendre le surplus. À l’époque, le paysan avait souvent une autre activité, il n’était pas rare d’être à la fois agriculteur et carrier, ou bûcheron. L’usage de la campagne était alors multifonctionnel. Le tracteur, la mécanisation, les banques ont encouragé les fermiers à investir, à faire des emprunts pour se moderniser, et seulement ceux qui ont pris ce risque sont restés. Les fermes en autarcie ont disparu petit à petit.

Après la désertification, la campagne va se reconfigurer jusqu’à sa forme actuelle. Que s’est-il passé ?
À la fin des années 60-70, l’apparition du tourisme, l’accroissement de la mobilité et la capacité à prendre des vacances ont changé la donne « rurale ». De plus, la société en général va encourager les gens à avoir accès à la petite propriété terrienne, à vouloir cette maison en dehors de la ville. Ce modèle fait alors tourner l’économie : il favorise le secteur du bâtiment dans un pays où on a longtemps dit : « Quand le bâtiment va, tout va. » Ça permet aussi de vendre des terrains, de faire des plus-values, et de faire tourner les usines de voitures, dans un pays qui en produisait jadis beaucoup. Et cela garantit une certaine stabilité sociale, parce que, si on a fait un emprunt pour acheter une maison, on n’a pas intérêt à se faire renvoyer de son travail au risque de perdre cette maison.
La brique dans le ventre et à la campagne, ça arrangeait tout le monde…
Oui. Quand on voit qu’on a une réduction d’impôt si on devient propriétaire et qu’on investit dans la brique, c’est presque une proposition politique malhonnête parce qu’en fin de compte, qui gagne ? Ce sont les banques qui récupèrent l’intérêt de l’emprunt. Et, si vous ne pouvez rembourser votre maison, vous la perdrez. Donc le message, si on pousse une lecture un peu marxiste, c’est « soyez bien sages ».
Autant, voire plus que le tracteur, c’est aussi la voiture qui a donné sa forme actuelle à la campagne wallonne.
Oui, l’accroissement de la mobilité a permis le tourisme, qui rencontrait aussi un besoin de diversification. Il y a eu depuis longtemps du tourisme à la ferme, d’ailleurs. Si vous lisez les Mémoires de Georges Simenon, vous voyez qu’il quitte Liège pour aller à la ferme, pas très loin à Mehagne (commune de Chênée, NDLR). Quand le monde rural a dû chercher à se diversifier, suite à la mécanisation des exploitations agricoles, on a d’abord vu les hôtels, les grandes résidences puis les villages de vacances qui ont été vite démodés, et les campings. C’est le développement de l’autoroute (dans les années 70 et puis 80, NDLR) qui a convaincu des individus, mais aussi des entreprises de partir s’installer pour de bon à la campagne. Aujourd’hui, on assiste à une cohabitation d’hébergements très variés, avec même des logements insolites. Le développement d’activités, notamment industrielles, a permis une espèce de renversement qui a engendré une campagne multifacette.
En réaction à l’américanisation de nos modes de vie et de notre gestion des espaces agricoles, un retour à la ruralité s’amorce aussi dans les années 70. Comment s’opère-t-il ?
On constate un regain d’intérêt pour la ruralité à la faveur de la fusion des communes. Cette fusion voulait rassembler les villages et communes un peu plus rurales autour d’un bourg-centre où on pourrait avoir toute une série d’équipements. Il y a eu des réactions très fortes, notamment du côté d’Attert (où cinq communes ont fusionné en souhaitant rester essentiellement rurales, NDLR) ou d’Olne, sur le plateau de Herve, pour revendiquer et préserver leur caractère rural. Elles ont adopté un développement rural différent et intégré où il y aurait de l’agriculture, mais aussi du tourisme, de l’industrie et une série de services pour permettre aux habitants de vivre.
C’était à la fin des années 70. La Belgique a fait figure de pionnière ?
Nous avons été les précurseurs de ce qu’on appelait la rénovation rurale, notamment à travers les plans communaux de développement rural, qui ont encore cours aujourd’hui. Leur but est de travailler avec les citoyens pour essayer de répondre à leurs problèmes, leur offrir des équipements. Les moyens sont limités, comme toujours, mais ça permet de ne pas se sentir abandonné par les autorités.
Pourtant, aujourd’hui, une partie des habitants des villages se sentent abandonnés. Ou mal pris en compte. En France, des sociologues appellent les médias et les milieux académiques à reconsidérer la façon dont ils envisagent la ruralité et à cesser de regarder ces espaces de haut. C’est quelque chose que vous constatez dans votre pratique ?
C’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup d’empathie par rapport aux habitants natifs des zones rurales. On constate que dans les villages et les hameaux, ce sont souvent les personnes « importées » (de la ville, NDLR) qui à un moment donné reprennent le leadership et vont développer telle activité ou telle thématique. À un moment, j’étais jury de l’appel « Vis mon village » de la Fondation Roi Baudouin qui donnait des enveloppes de 5 000 euros à des groupes d’habitants pour améliorer leur cadre de vie et la solidarité. J’avais constaté que c’étaient souvent les citoyens importés ou les centres culturels qui remportaient ces enveloppes et moins les demandes un peu moins bien formulées, un peu moins dans les clous de citoyens perçus comme un peu « naïfs ». Donc ces ex-urbains vont dire : le folklore, il faut l’entretenir, le marché de produits locaux, il faut le faire. C’est fort bien, mais ça veut dire qu’il y a aussi des publics qui sont un peu silenciés.
Qui ?
Les personnes âgées. Les jeunes. On leur donne rarement la parole et j’ai parfois des étudiants qui sont contents, lors de mes cours, qu’on leur parle du monde rural différemment de ce qu’ils entendent d’habitude. Il y a quand même des avantages à habiter la campagne, mais aussi des difficultés, en termes de mobilité sociale, de mobilité tout court, et d’ambition. Pour les jeunes filles, il y a encore le problème de l’interconnaissance. Une jeune fille à la campagne affronte encore des soucis d’un autre temps. Si elle sort avec un peu trop de garçons, elle aura vite mauvaise réputation. Des études ont montré que les jeunes femmes préfèrent vite venir habiter la ville à cause de cette pression sociale.
Qu’en est-il, dans une campagne si diverse, de l’état du lien entre les personnes ?
Différents types de convivialité cohabitent. Des communautés de citoyens commencent à se réapproprier des parcelles potagères, créent des coopératives, sont membres d’asbl et ils y retrouvent ou y recréent un esprit villageois. Leurs valeurs sont similaires à celle des populations mixtes des villes. D’un autre côté, on a des gens qui ne se parlent pas, qui ne profitent pas de l’environnement vert autour d’eux parce qu’ils s’arrêtent à leur jardin. J’ai demandé plusieurs fois, lors d’entretiens à des personnes venues s’installer à la « campagne » : « Qu’est-ce qui a changé dans votre paysage ? » Souvent, les gens regardaient par la fenêtre de leur cuisine et décrivaient la vue qu’ils avaient depuis leur maison.
Mais il y a aussi chez les ruraux natifs le fait de ne pas avoir besoin d’appartenir à un club. Ça existe encore, les soirées où l’on rend visite aux voisins, on joue aux cartes en buvant du café. Ça a l’air d’une image archétypale, mais ça existe toujours. Cette convivialité, qui engendre aussi de la solidarité, est cachée.
Elle est aussi plus marginale, non ?
La mobilité a amené des changements de sociabilité forts. Avant, on avait, en gros, la messe et le foot comme activités villageoises, mais, désormais, la voiture permet de tout choisir. Donc on peut se poser la question : est-ce que je laisse mon enfant à l’école du village où il n’y a plus que deux classes pour toutes les primaires, ou est-ce que j’opte pour l’école du bourg, ou encore pour de la pédagogie alternative, mais qui se trouve plutôt en ville ? C’est très important, d’ailleurs, quand on parle des communes rurales, de distinguer la vie qu’on peut avoir dans le bourg par rapport aux villages, où il y aura forcément moins d’équipements.
Quand vous dites que vous tentez de parler différemment de la campagne, comment vous y prenez-vous ?
Pour ma thèse, je demandais à certains informateurs de sélectionner des personnes de toutes origines : des « migrants », des niveaux de vie différents, des natifs. Il faut à tout prix éviter ce qu’on appelle le système de l’échantillonnage en boule de neige. Cette méthode veut qu’on interroge deux ou trois personnes et qu’on leur demande d’indiquer deux ou trois autres personnes qu’on pourrait interroger. Mais, à un moment donné, on reste coincé dans le même réseau et on crée un biais scientifique.
Comment en sortir ?
Une fois nous avions reçu un gros projet de la politique fédérale belge pour travailler sur une approche plus durable des espaces publics. Nous nous sommes penchés sur l’aménagement d’une plage à Noiseux (commune de Somme-Leuze), notamment. Il a fallu d’abord repérer tous les utilisateurs de la plage. Les pêcheurs, la station d’épuration d’eau à côté, les loueurs de kayaks, les gens du camping qui ne parlent que le néerlandais, etc. Dans les ateliers participatifs, le problème, c’est qu’on touche trop souvent les gens éduqués, qui ont du temps. On a développé une approche qui s’appelle « aménagement empathique » et qui vise d’abord des gens qui ne savent pas qu’ils peuvent prendre la parole. Avec l’université, on conseille des groupes de citoyens, des promoteurs immobiliers, quand ils sont transparents sur leurs projets, et parfois des entités publiques. Mais seulement si ces dernières acceptent qu’on n’arrive pas forcément au résultat qu’elles attendent.