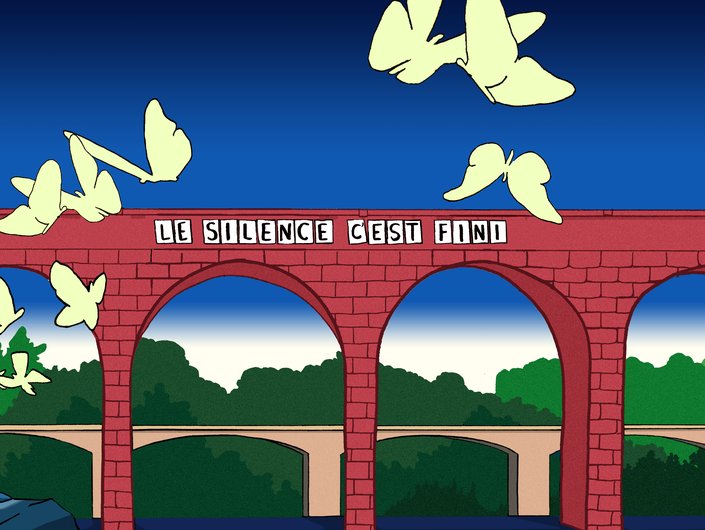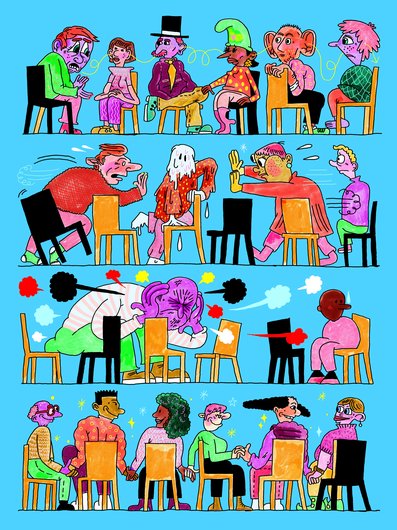Tout se joue après 16 h
L’éducation de l’ombre
Illustrations (CC BY-NC-ND) : Pauline Lecerf
Texte (CC BY-NC-ND) : Céline Gautier & Chloé Andries
Publié le

Depuis le mois de mars, nous menons une enquête participative intitulée « Flûte, j’ai poney ». Les activités extrascolaires de nos enfants ruinent-elles nos vies ?
« Oui », nous ont répondu de nombreux parents. Mais elles ruinent surtout celles de ceux qui n’y ont pas accès. En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’offre d’activités après l’école n’a jamais été aussi grande, ni aussi recherchée. Chaque famille se fraye son propre chemin, mais tout se passe comme s’il ne s’agissait pas d’une question de société. Alors que cette « éducation de l’ombre » renforce les inégalités.
Sous cette législature, les liens entre l’école et l’extrascolaire sont au menu de deux grandes réformes politiques : il est donc temps d’ouvrir le débat public sur ce que nous voulons pour les enfants.
Voici quelques conclusions, en 12 boulettes, pour nourrir la réflexion. Le reste est à lire sur : www.medor.coop/poney.
1. Merci à toutes les personnes qui ont participé à notre enquête. Y compris celles qui nous ont traitées de nazes. Par exemple, Marie.
Marie nous écrit : « Je trouve vos questions totalement à côté de la plaque. Ne peut-on pas offrir à ses enfants des activités épanouissantes sans en calculer le coût, l’énergie donnée et le temps passé ? » Elle se demande pourquoi envisager cet investissement comme quelque chose qui nous gâche la vie. « Sinon, on peut aussi ne pas faire d’enfant, excellente solution pour ne pas avoir à se lever le week-end. » Et toc.
Aujourd’hui, le sujet est totalement sous-documenté. Personne ne sait réellement combien les parents, en Belgique, dépensent pour que leurs enfants fassent du sport ou de la musique. On prend conscience de l’importance de cette charge uniquement quand on n’arrive pas à la porter. Or, si ces activités sont une « évidence » pour les parents, elles contribuent à aggraver les inégalités futures. Doit-on accepter comme allant de soi que les uns (les plus aisés, investis, informés, etc.) se forgent un bagage social, culturel, physique… pendant que les autres restent à la maison ?
2. La course à l’extrascolaire est une réalité. Et parfois, c’est encore pire que « prendre des places pour Tomorrowland ».
- Parmi les parents, il y a ceux qui sont au taquet. Cindy : « Notre enfant a tout juste 2 mois et on discute déjà des activités qu’il pourrait faire. Quel sport ? Les scouts ? »
- Des prêts à craquer. Géraldine : « Moi je vais au travail “me reposer”. Et je profite des embouteillages pour pleurer en paix. » Florence : « C’est pire que prendre des places pour Tomorrowland. »
- Des tiraillés : « JE VEUX PAS LES OBLIGER, MAIS J’AI PEUR QU’ILS DEVIENNENT DES MOULES ANTISOCIALES S’ILS NE FONT PAS AU MOINS UNE ACTIVITÉ. ET MOI JE PERDS MON MERCREDI APRÈS MIDI CHILL DE CONGÉ AVEC MES GOSSES DANS MA BAGNOLE. »
- Et même un filou. Alex : « J’ai une fois utilisé mes compétences de webdéveloppeur pour décrocher un stage d’équitation dont l’inscription se faisait en ligne (préremplir le formulaire, car en une minute tout est parti sinon !). »
- Ou enfin ceux qui font un rejet. Florence : « La difficulté à obtenir un stage joue le rôle d’un repoussoir pour moi. Toujours chercher le meilleur pour son enfant, c’est épuisant et malsain aussi. » Floco : « Je hais les autres parents. Non, mais sérieux, l’ambiance est souvent “mon enfant, mon génie, mon trésor”. »
Dans l’ouvrage collectif Politiser l’enfance, le philosophe Arnaud Teillet explique comment on en est arrivé là. Depuis les années 1970 et jusqu’à un potentiel effondrement du système, nous vivons dans un modèle néolibéral, basé sur l’adaptation permanente de l’individu.
La responsabilité collective s’est effacée, au détriment de la responsabilité individuelle. Les parents ont pour mission de maximiser le potentiel de leurs enfants, qui sont « de plus en plus perçu·es comme des portefeuilles de compétences à enrichir et élargir indéfiniment ».
En résulte une « course à l’extrascolaire » qui pèse lourd sur les familles. Dans notre panel, 40 % des répondant·es disent que les adultes de leur ménage consacrent entre 2 et 5 heures par semaine aux activités des enfants (transport, attente sur place, etc.). 15 % parlent de plus de 5 heures/ semaine. Il y en a même qui font jusqu’à 4 heures de trajet par jour pour un stage d’escrime médiévale.
Attention, on est au courant : notre échantillon n’est pas représentatif de la population générale. Sur les 228 répondant·es à notre questionnaire, 75 % sont universitaires et 81 % sont des femmes. Moins de 5 % disent avoir du mal à joindre les deux bouts. À titre de comparaison, en Belgique, 18 % de la population court un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (Statbel). Notre panel est donc clairement « favorisé ». Culturellement, socialement ou financièrement (ou les trois). Dans presque toutes ces familles, on fait des activités extrascolaires.
3. Pour prendre l’ascenseur social, nos enfants font du trapèze volant. Sommes-nous de grands inconscients ?
Selon le Baromètre des parents de la Ligue des familles (2024), 90 % des parents les plus aisés (plus de 5 000 euros net/mois) inscrivent leurs enfants à des activités, contre seulement 68 % chez les plus précaires (moins de 2 200 euros net/mois). « Dans 23 % des familles, aucun enfant ne participe à des activités extrascolaires (sport, musique, mouvement de jeunesse…). »
Dans ce qui se joue « après 16 h », il existe peu de chiffres. Mais quand ils sont là, ils font mal. En Fédération Wallonie-Bruxelles, « 90 % des enfants pratiquent un sport quand leurs deux parents sont cadres ou exercent une profession libérale. Et ils ne sont plus que 52 % dans la catégorie où le père est ouvrier et la mère “inactive” ». Ces données sont issues d’une étude menée par l’ADEPS (administration générale du sport), en 2020.
Oui, les inégalités se creusent après l’école. Ce n’est pas qu’un constat. C’est aussi une stratégie. Selon Hugues Draelants, sociologue à l’UCLouvain, spécialiste du rôle de l’école et des familles dans la fabrication des inégalités sociales, l’école ne permet plus aujourd’hui de se distinguer suffisamment. Le nombre de personnes qui accèdent à l’université ne cesse d’augmenter. Inscrire son enfant à l’éveil musical, chez les louveteaux ou à la boxe est donc devenu « un moyen pour les familles de se démarquer, de se distinguer socialement ». Mais, insiste le sociologue, ce n’est bien souvent ni une stratégie réfléchie ni un calcul. Tout cela est fait de façon « inconsciente ». Nous voulons juste aider nos enfants à s’épanouir.
« Punaise, j’avais jamais fait le calcul », nous signale Chris, qui a comptabilisé 3 000 euros de dépense annuelle en activités pour ses trois enfants. En moyenne, les parents de notre panel dépensent près de 1 100 euros par enfant et par an (650 euros pour l’inscription aux activités régulières et 464 euros pour les stages). Ce montant n’inclut ni le coût des trajets, ni celui des équipements, ni évidemment le manque à gagner chez ceux (et celles !) qui réduisent leur activité professionnelle pour « gérer les navettes » des enfants (bien plus souvent les femmes, qui représentent donc 81 % de notre panel). Ces dépenses n’incluent pas non plus les séances de logopédie, de psychomotricité relationnelle ou toute autre activité liée à des besoins spécifiques de l’enfant.
Ne jamais questionner les familles aisées sur les efforts accomplis pour leur progéniture tend à sous-estimer collectivement cet investissement et son impact. La sociologue française Agnès van Zanten, interrogée par Le Monde, disait observer le même aveuglement parental dans le soutien scolaire (choix des filières ou écoles, aide à la réussite, etc.) : « Les parents, et surtout les mères, ont tendance à occulter le travail qu’elles font pour faire sortir le meilleur de leur progéniture. Quand on les interroge sur ce point, elles expliquent la réussite par le seul talent de l’enfant. »
Cette valorisation du mérite fait oublier que le niveau socioéconomique des parents est le plus gros facteur de réussite scolaire et professionnelle. L’ignorer et faire en sorte que nos enfants ne s’en rendent pas compte contribuent à ce que, demain, ils endossent cette idée selon laquelle « les pauvres pourraient quand même, eux aussi, un peu se secouer ».
4. Apprendre, c’est amusant. Maman a placé un alphabet aimanté sur le frigo, te lit un livre sur les volcans et te conduit à l’éveil musical, mon chéri.
La distinction sociale (eh, nous aussi, on a lu Bourdieu) passe également par un comportement typique des classes moyennes et supérieures, qu’Hugues Draelants appelle la « pédagogisation des loisirs ». Ces parents favorisés « ont intégré l’idée que toute activité était source d’apprentissage, et qu’on pouvait apprendre par plaisir ». Fini le « temps perdu », les jeux débiles, la liberté, la passivité. « Le mot clé, c’est l’enrichissement. » Et ça commence tôt !
Apprendre est un plaisir. Mais apprendre quoi ? Auparavant, les élites plébiscitaient une culture classique et distinctive, faite de piano, de théâtre et de grande littérature. Aujourd’hui, elles s’autorisent à aimer le slam autant que l’opéra, à lire des mangas en écoutant du jazz, à mettre leurs enfants tour à tour au foot, au hockey, au skate ou à la harpe. L’éducation des enfants ne consiste plus à remplir leur tête de savoirs et de culture « de classe » mais à développer chez eux des compétences sociales et des attitudes porteuses, qui les aideront à s’adapter à des situations complexes.
Nous avons interrogé les parents sur les bénéfices escomptés des activités. Les réponses évoquent l’envie d’avoir des enfants équilibrés, en bonne santé physique et mentale, qui jouent loin des écrans, à l’air libre, font du sport, de la musique, apprennent les langues, le code informatique (parfois), se font des amis, découvrent la vie en groupe, l’art et la culture, se forgent une personnalité. Les valeurs plébiscitées : le respect de la différence, le goût de l’effort, de la persévérance et de l’humilité, l’adaptabilité, la passion, la connaissance de soi. Ça parle de compétences, d’apprentissages, de développement cognitif mais aussi de résonance, de poésie et de liberté.
Ces valeurs, appréciées dans la vie privée, sont aussi porteuses sur un CV. Et recherchées par… le monde de l’entreprise. Ces compétences (ou « soft skills ») sont celles, ajoute Arnaud Teillet, qui assureront à l’enfant sa future « employabilité » et son adaptation « aux bouleversements économiques en cours et à venir ».
D’autant qu’une discipline s’est invitée dans le monde de l’enfance ces dernières décennies : les neurosciences. Michel Vandenbroeck, professeur retraité à l’UGent, et auteur d’Être parent dans notre monde néolibéral, reconnaît l’apport des neurosciences (qui ont contribué à décrire les différents stades de développement de l’enfant). Mais il dénonce la façon dont elles ont été dévoyées et utilisées dans une vision « déterministe » de l’enfant, comme s’il existait un manuel à suivre pour développer son cerveau. L’enfant est désormais vu comme un adulte en devenir, un potentiel sans fin qu’il reviendrait aux parents de maximiser.
5. C’est l’heure de la piscine. Quelques longueurs sur l’école et le répertoire d’Annie Cordy.
La complémentarité, voire la rupture, avec le système scolaire fait couler du pixel, chez nos répondant·es : l’école serait trop « chaises-moutons-photocopies » avec un esprit étriqué, fait de compétition et de conformisme. Les enfants ne peuvent pas assez bouger, être dans la nature, découvrir la richesse de la culture (et pas uniquement le « répertoire d’Annie Cordy »). Les ruraux évoquent un peu plus souvent le manque d’éducation artistique à l’école, et les urbains, la disparition des cours de natation (pourtant obligatoires). « Mon aîné est en 2e secondaire, il n’a pas mis les pieds une seule fois à la piscine avec l’école. »
40 % de nos répondant·es ont d’ailleurs inscrit leur enfant à des cours de natation en dehors de l’école. Pas forcément par plaisir mais par « nécessité ». C’est aussi l’activité citée pour laquelle les tarifs pratiqués sont les plus élevés (plus cher que le poney ou le hockey). Et où, logiquement, se creusent les inégalités.
« Les familles les plus informées font des choix hyper-individualisés », explique Hugues Draelants. C’est-à-dire que chaque famille compose, parmi une offre foisonnante, une trajectoire individuelle qui correspond à ce qu’elle souhaite pour son enfant.
Denis Detinne, directeur de Promosport, un des acteurs phares de l’extrascolaire à Bruxelles et en Brabant wallon (reconnu par Office de la naissance et de l’enfance, ONE), note que les stages « piscine » ne désemplissent pas. Et ajoute : « Nous, on existe parce que l’État ne fait pas son travail suffisamment bien. Clairement. »
6. Codage en Python, géocachette, baby-yoga ? 3, 2, 1 c’est parti.
L’école ne peut pas cocher toutes les cases, occuper nos enfants pendant les vacances et leur apprendre le karaté. Le privé a donc sauté sur l’opportunité avec une multiplication de petites asbl ou de mégastructures, dont les références pédagogiques peuvent être très solides ou carrément inexistantes. Assisterait-on à une marchandisation de l’extrascolaire ? « Oui, à crever », répond Geoffroy Carly, des Cemea (un mouvement d’éducation nouvelle proposant des centres d’activités pour jeunes). « Dans les offres purement privées, des structures arrivent avec un produit économique qui doit être rentable, et, donc, des offres qui répondent davantage aux demandes des parents qu’à celles des enfants. » Une organisatrice d’activités nous le confirme : « Tu organises une “plaine de vacances”, personne ne s’inscrit. Tu appelles ça “stage”, ça marche tout de suite. » Même si ça coûte plus cher.
Les « bons plans », ceux qui plaisent aux parents, aux enfants et aux portefeuilles, sont pris d’assaut.
Une organisation d’enfer, un diplôme supérieur et deux ordinateurs connectés ne suffisent d’ailleurs pas toujours à avoir une place. Surtout pour les stages pour tout-petits ou pour les activités de qualité gratuites ou presque, comme les cours dispensés par les académies de musique ou des beaux-arts. Ce problème des « places disponibles » est surtout valable dans les grandes villes. Mais dans les zones rurales, les parents ont intérêt à avoir une voiture… et pas mal de temps à passer sur la route, vu l’étalement géographique des activités.
Des parents d’enfants aux besoins spécifiques (déficience auditive, spectre autistique, troubles « dys », etc.) nous ont dit à quel point la recherche d’activités inclusives et de qualité était plus complexe encore.
Dans ce contexte s’ajoute une préoccupation plus pragmatique : les horaires d’école. Ils sont « devenus absurdes », estime Michel Vandenbroeck. Absurdes parce qu’ils ont été pensés sur le modèle de la société rurale des années 1950. L’organisation du travail a changé mais l’école, elle, ne s’est pas adaptée. « Un enfant a deux fois et demie plus de vacances que ses parents. » On fait comment ?
Pour l’auteur, les pouvoirs publics se sont progressivement déchargés de leurs responsabilités, qui ont été individualisées, transférées sur les parents. Des parents à qui il revient de résoudre une équation sociétale dont ils n’ont pas la solution, à coups de travail à mi-temps ou d’appels aux grands-parents. Pour lui, c’est clair, il faut « repartir de l’enfant » et « réinventer l’école », qui deviendrait un vrai lieu de vie, en lien avec les acteurs de l’extrascolaire et du quartier.
7. Le mot à ne jamais prononcer à l’école après 15 h 30 : « garderie ».
Ou, pire, « gardiennage », comme nous l’écrit une mère dépitée. Dans le milieu, on hurle sur tous les toits que s’occuper des enfants le matin, le midi et après 15 h 30 est une mission pédagogique qui n’a rien à voir avec la surveillance d’un parking ou d’un zoo. Pourtant, le SPF Finances, lui-même, dans les déclarations d’impôts, appelle « frais de garde » les sommes déductibles liées à ces périodes, et non « accueil extrascolaire » (comme il faudrait dire). C’est dire le peu de cas qui est fait de ce travail.
Ces personnes (90 % des femmes) à qui nous confions nos enfants sont des conditions de travail indignes. Elles sont sous-payées, sous-formées et jonglent avec des horaires ultramorcelés… Une étude datée de 2024 du mouvement féministe Soralia et de la plateforme Extrascool indique que un(e) accueillant(e) sur deux perçoit un salaire en dessous du seuil de pauvreté. Environ 16 % n’ont ni contrat CDI ou CDD classiques mais sont engagé(e)s sous un contrat de type ALE, remplacement, Article 60 ou bénévolat. Annick Cognaux et Cindy Jadot (ONE) rappellent que les « garderies » sont totalement sous-financées, « à hauteur de 0,71 euro par enfant et par jour » (en 2023).
Ce n’est donc pas étonnant qu’à peu près tout le monde s’accorde pour dire qu’en vrai, les « garderies » (pardon), c’est parfois la cata. Une de nos répondantes résume le problème en une image : « des coloriages Disney dans un local qui sent le pipi ».
8. Georges-Louis Bouchez propose que les cours de tennis se fassent à l’école.
Le MR est désormais la première force politique au parlement de la FWB, au pouvoir avec Les Engagés. Dans son programme, se trouvait noir sur blanc un bouleversement majeur pour nos enfants : ouvrir l’école de 8 h 30 à 17 h et y intégrer plus d’activités sportives, culturelles et numériques. Y a-t-il la moindre chance que ce projet se fasse ? Une chose, déjà, met tout le monde d’accord et figure dans le Pacte d’excellence : après avoir revu les rythmes scolaires annuels (les dates des vacances), il faut revoir les rythmes journaliers (l’organisation des journées d’école).
Des génies des rythmes biologiques ont en effet remarqué que les enfants étaient un peu ralentis en début d’après-midi. Ils suggèrent de ne pas caler d’apprentissages cognitifs à ce moment-là. Par contre, de la musique ou du sport, on peut. Tous les partis pourraient donc avancer dans cette réforme, profitable aux enfants.
Là où ça risque de boxer, c’est sur l’allongement de la journée. L’école jusqu’à 17 h et un rapatriement des activités dans les établissements, comme le suggèrent les libéraux ? L’idée offrirait des opportunités à tous les enfants, faciliterait la vie des parents, « rentabiliserait » les heures de garderie et limiterait les trajets. Nous avons reçu de très nombreux témoignages en ce sens, comme celui de Manu : « Si l’école était meilleure, avec un jardin vert, du savon dans les toilettes et des activités complémentaires, ma vie serait plus facile. »
Mais, à l’inverse du MR, d’autres partis, comme le PS, suggèrent de revoir les rythmes journaliers sans allonger la journée. Et de penser l’extrascolaire comme une troisième galaxie de l’enfant, en dehors de l’école et de la famille. Tout un secteur, privé ou subventionné, se retrouve derrière cette vision (voir notre boulette n°11).
La ministre de l’Enseignement, Valérie Glatigny (MR), a bien compris que la proposition de son parti n’était qu’un scénario parmi d’autres, dont il va maintenant falloir débattre avec toutes les forces en présence. Elle rappelle, d’ailleurs, que « la réforme des rythmes annuels a pris 30 ans ». Celle des rythmes journaliers ne sera sans doute pas pliée en une législature. La ministre a aussi tenu à rassurer les parents : chacun restera libre d’inscrire son enfant à la musique ou au poney, si le cœur (et le portefeuille) lui en dit.
9. Vas-y, viens, mon école propose de la capoeira.
En attendant une telle réforme, des parents, des directions, des profs se bougent pour essayer de « dynamiser l’offre » d’activités au sein de l’école. Des initiatives, il y en a dans tous les sens et de toutes les philosophies. Dans l’école des filles de Sylvie (prénom modifié), à Schaerbeek, une asbl propose des cours tous les jours, pendant le temps de midi et après 15 h 20. Hyper-pratique. Si tu as les moyens. Piano ? 470 euros par an. Capoeira ? 185 euros. Hyper-prisé. « Mes filles me disent : maman, on est toutes seules à la garderie pendant que nos copines font tous les jours de chouettes activités. »
Ailleurs, on tente de développer des liens avec des structures du quartier. Dans certaines communes, les académies de musique proposent désormais des activités directement dans les écoles, gratuites pour les enfants.
Quatre établissements bruxellois du réseau libre (certains au public aisé, d’autres très précaires) ont, quant à eux, décidé de mutualiser leurs moyens et de travailler avec l’asbl Éclosion, qui s’occupe de tout l’extrascolaire : jeux libres, tournois de foot, ping-pong, hockey, balle-chasseur, bricolage, projets avec des homes, etc. Formations enseignants-animateurs communes, réunions régulières entre différents métiers : l’asbl essaye de fidéliser ses équipes, mais pour faire tout ça « on est devenus des chasseurs de subsides », signale Matteo Detemmerman, un des responsables. Ici, ce ne sont pas les parents qui inscrivent, mais les enfants directement. Samy Otmani, responsable des activités, nous explique : « Dans les écoles plus aisées, les parents aimeraient parfois des ateliers de langue ou de codage. Mais les enfants, eux, quelle que soit l’école, ce qu’ils veulent, c’est jouer avec leurs copains et créer des papillons à paillettes. »
10. Mini-pause répit.
Le coup du papillon à paillettes (voir ci-dessus) n’étonnera pas Geoffroy Carly (Cemea), qui plaide pour un « droit au répit » : « Il y aurait une forme de refus relativement catégorique de notre société que l’oisiveté puisse exister, avec l’idée que tous les temps ne pourraient être que des temps rentabilisés. Alors qu’on sait très bien que le fait de s’emmerder est une nécessité ! » Pour Cemea, ce temps libre ne signifie pas une absence de cadre. Il s’agit de proposer un espace et un encadrement humain de qualité, pour laisser ensuite l’enfant décider de ce qu’il souhaite faire, en dehors de tout apprentissage formel et obligatoire.
11. Les dents cassées sur le troisième pilier.
Faut-il multiplier les activités, comme autant d’opportunités d’ouverture et d’apprentissage, ou à l’inverse favoriser le répit des enfants ? Est-il mieux de centraliser l’extrascolaire au départ de l’école ou, au contraire, d’encourager l’existence de lieux extérieurs, avec d’autres modes d’organisation ? Ces questions fondamentales agitent le secteur de l’enseignement et de l’enfance depuis des années. Mais les divergences de vues sont grandes.
En Belgique, le secteur éducatif parle de trois « piliers », trois temps importants pour l’enfant : « 1. la famille 2. l’école 3. l’extrascolaire. »
Ce troisième pilier, qui s’est construit hors école, en complémentarité et parfois en réaction à celle-ci, n’est pas convaincu qu’il soit bon de tout rapatrier au sein ou au départ des établissements scolaires. « L’enfant arriverait plus tôt à l’école, repartirait plus tard. Il verrait toujours les mêmes compagnons et perdrait donc des opportunités de mixité sociale, de découvrir d’autres environnements, d’autres milieux de vie », craignent Annick Cognaux et Cindy Jadot, responsables de l’Accueil temps libre (ATL) au sein de l’ONE. « C’est un appauvrissement du cadre de vie de l’enfant. » Pour Solayman Laqdim, délégué général aux Droits de l’enfant, « l’école voit l’enfant comme un élève à qui transmettre du savoir, alors que l’extrascolaire l’envisage autrement. Il ne faut pas que l’école phagocyte ce troisième lieu de vie ». Il rêve plutôt de garder les spécificités de chaque lieu, et de les faire dialoguer.
Toutes ces maisons de jeunes où les gamins peuvent se retrouver et se forger une identité, dans leur quartier, toutes ces académies, qui proposent des formations artistiques de qualité à toutes et tous, ces asbl qui cherchent à offrir des activités plus inclusives… Comment les intégrer à une réflexion globale, dans laquelle l’école deviendrait leur partenaire réel ?
Du côté du ministère de l’Enfance, le dossier « liens avec l’école » est sur la table. Mais cela fait déjà deux législatures que la Fédération Wallonie-Bruxelles se casse les dents sur cette « réforme de l’ATL », dont la « finalisation » est inscrite dans la nouvelle déclaration de politique communautaire MR-Engagés.
Il va donc falloir avancer. Séverine Acerbis, spécialiste de la petite enfance, a travaillé au cabinet de la ministre Linard (Ecolo) sous la précédente législature et a suivi, à ce titre, les débats autour de cette réforme. Pour elle, il y a surtout des arguments pragmatiques pour rapprocher l’école et l’extrascolaire : la Fédération Wallonie-Bruxelles est fauchée. Penser qu’on va pouvoir financer l’extrascolaire pour en faire un pôle aussi bien doté que l’école est illusoire. Mieux vaut concentrer les moyens pour offrir une école aux horaires et au programme élargis, comme cela se fait dans d’autres pays. Avec des liens forts entre tous les acteurs ancrés localement. Mais une chose est sûre, « tout le monde doit bouger ses lignes. L’école aussi ! »
12. Des flûtes et des poneys.
Toutes les personnes rencontrées dans le cadre de cette enquête nous l’ont dit : la musique, le sport, les mouvements de jeunesse ou le jeu libre dans un cadre de qualité sont une rampe de lancement pour l’épanouissement, le lien social et la santé physique des enfants. Mais si ces activités demandent une énergie démesurée, si cela impose aux enfants des déplacements dignes d’une infirmière à domicile, si un tiers des familles en sont totalement privées, alors il est peut-être temps de se demander : que peut-on faire ?
Notre réponse s’inspire des vôtres : en attendant un miracle politique, faire déjà avec les énergies disponibles. Organiser la solidarité entre parents, créer des ponts (ou des rangs accompagnés) entre l’école, l’académie et les clubs de sports, ouvrir les portes des classes sur le monde extérieur, comme tentent de le faire les Brede Scholen flamandes qui tissent des liens entre les écoles, les communes, les centres sportifs ou les maisons de repos. Nous avons reçu un nombre incroyable de témoignages d’initiatives locales, en Wallonie ou à Bruxelles, émanant de parents, de directions d’écoles, d’organisations qui tentent de construire des réseaux plus riches et plus solidaires autour des enfants.
Pour cela, l’éducation de l’ombre qu’est l’extrascolaire doit être mise en lumière. Débattue, chiffrée et appréciée à sa juste valeur. Vous avez été nombreux à jouer le jeu. Merci aux joueurs de flûte, aux monteurs de poneys et à leurs (grands-)parents.
Médor fête son 37e numéro en organisant des rencontres, ateliers, débats, apéros à Barricade (Liège) du 4 au 18 décembre. Découvrez le programme sur medor.coop/sorties et rejoignez-nous, les événements sont gratuits !
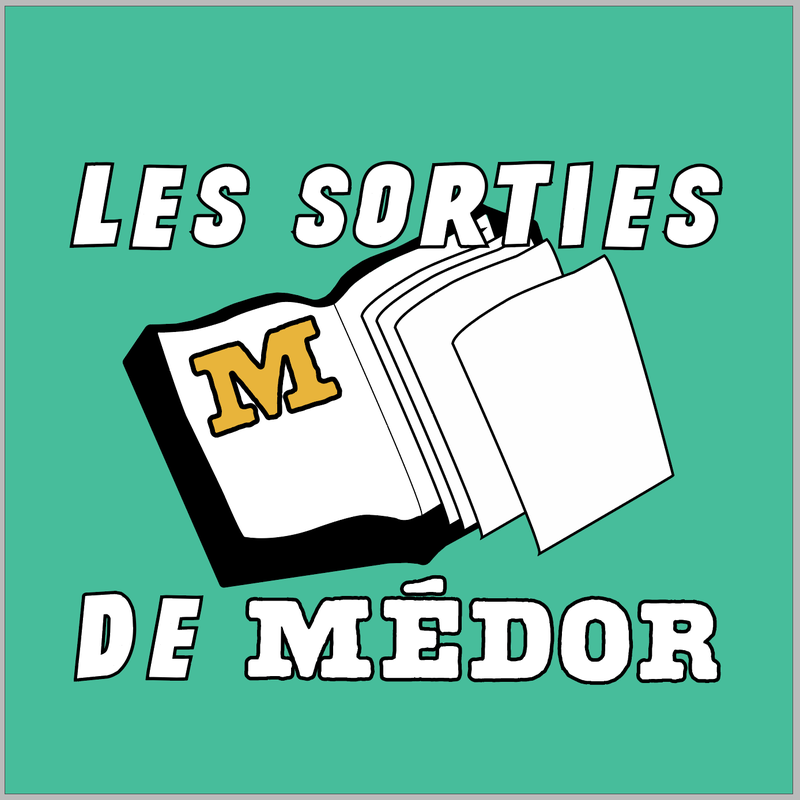
Avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles
-
La Ligue des Familles vient de lancer une enquête spécifique sur l’extrascolaire.
↩