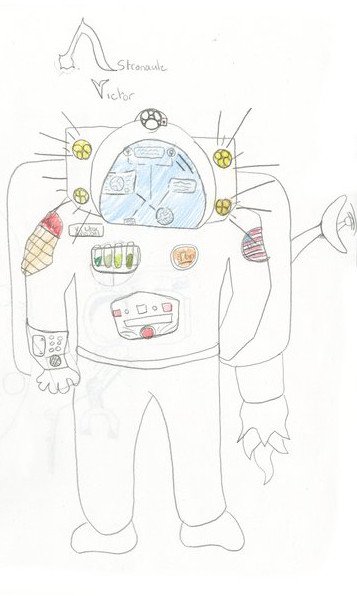Les fautes que je n’ai pas fait
Dan Van Raemdonck

Il est grammairien mais milite pour qu’on fasse moins de grammaire à l’école – et mieux. Qu’on réforme massivement notre orthographe et, surtout, qu’on en finisse avec l’accord du participe passé avec « avoir ». Dans son sillage, les linguistes belges sont partis en croisade. Et tant pis si les membres de l’Académie française en tombent de leur siège.
Attention, ceci est grave. Cet article applique de nouvelles règles d’accord du participe passé que Dan Van Raemdonck et d’autres linguistes souhaitent voir adoptées :
– P.P. employé seul : s’accorde comme un adjectif.
– P.P. employé avec « être » : s’accorde avec le sujet, même s’il s’agit d’un verbe pronominal : « Les pelles qu’ils se sont roulés » (et non « roulées »).
– P.P. employé avec « avoir » : invariable : « La frite que j’ai englouti » (et non « engloutie »).
À vous de voir si ça perturbe votre lecture, un peu, beaucoup ou à mort. Si vous ne remarquez rien, c’est que vous vivez déjà dans le monde d’après. Les règles de la « nouvelle » orthographe (qui date de 1990…) sont également appliquées.
Pour parler de langue française, il nous donne rendez-vous en Flandre, sur la terrasse d’un café de Gand – une ville où il s’expatrie quelques semaines chaque année, avec mari et chien. Dan Van Raemdonck, qui n’a de flamand que le nom, est professeur de linguistique française à l’ULB et à la VUB et président du Conseil des langues et des politiques linguistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Depuis son mémoire sur les blagues de Toto et autres histoires drôles, ce très sérieux philologue n’a de cesse de plaider pour qu’on se focalise moins sur les fautes d’orthographe et plus sur l’évolution joyeuse du français. Avec la bande des Linguistes atterré·e·s, il a signé, en mai 2023, « Le français va très bien, merci » (Gallimard), un tract qui combat dix idées fausses, comme celle selon laquelle notre langue serait massacrée par les jeunes, les provinciaux, les pauvres ou les Belges. En 2018, déjà, deux professeurs, qui ont collaboré avec Dan Van Raemdonck, signaient la pièce La Convivialité, un plaidoyer pour une réforme orthographique d’ampleur, qui connait toujours un immense succès. Ils ont présenté ensuite une proposition de réforme d’accord du participe passé, qui a valu ce titre en une du quotidien français Libération : « Orthographe : la guerre que les Belges ont déclarée ». Cette guerre n’en est pas une. C’est un long combat politique, scientifique et démocratique porté par des amoureux de la langue. Rencontre avec un linguiste exigeant.
Vous présidez un conseil qui remet des avis de « politique linguistique » à la ministre de la Culture. Que proposez-vous au gouvernement de la FWB ?
Depuis des années, notre Conseil souhaite une réforme d’ampleur de l’orthographe, une réforme du discours grammatical – la manière dont on décrit la langue et dont on en parle, notamment à l’école – et une réforme des règles, comme celles de l’accord du participe passé. Actuellement, l’orthographe française est tellement compliquée, les règles sont souvent tellement mal rédigées, avec un tel manque de sens et de cohérence des discours grammaticaux, qu’on ne peut pas facilement s’approprier la langue.
La « politique linguistique » touche à des enjeux importants. Vous venez, par exemple, de terminer un guide sur la visibilité des femmes dans la langue
En effet, la politique linguistique recouvre aussi, notamment, les décisions prises par le monde politique pour réduire les problèmes d’ordre socioéconomique ou d’exclusion liés à la non-maitrise du français.
S’agit-il d’une langue particulièrement compliquée ?
Pas du tout. Je dis souvent par boutade que « si la langue était compliquée, les cons ne parleraient pas. Et pourtant, ils ne s’en privent pas ». Ce qui est compliqué, c’est notamment l’orthographe. Cela devrait pourtant n’être qu’une convention, qu’on devrait donc pouvoir modifier et rationaliser.
À l’international, la Belgique est plus ouverte que les autres pays francophones à des réformes linguistiques ?
Oui, les Belges sont très remuants. Les Suisses ont peu de moyens, les Québécois sont hyper-prudents parce que chaque acte linguistique est vu, dans leur environnement politique, comme un acte identitaire face aux anglophones. Ils ne bougeront que si les Français bougent. Et les Français ont souvent été hyper-conservateurs, invoquant une absence de demande sociale de changement.
Comment ça s’explique ?
En France, la République s’est unifiée sur la langue, après la Révolution française (1789). Il n’y avait pas grand monde qui parlait français sur le territoire, à part à Paris et en Ile-de-France. Les autres régions parlaient leur dialecte. La France a alors mené une politique générale d’éradication des dialectes et d’enseignement du français à marche forcée, par le biais de l’orthographe. Et c’est pour ça que pour beaucoup de gens, en France, l’orthographe, c’est LA langue, et la langue, c’est l’identité culturelle. Or, rappelons-le, l’orthographe n’est pas la langue : ce n’est qu’une technique de retranscription conventionnelle.
Cet attachement à une langue unique et à son orthographe, on n’observe ça dans aucun autre pays ?
De manière aussi psychopathologique, je dirais non.
On écrit « nénuphar », avec un « ph » qui n’est pas étymologique, plutôt que « nénufar »
La « norme », en principe, c’est la pratique majoritaire, l’usage qu’on observe le plus, statistiquement. En grammaire française, ce n’est pas ça. C’est une observation de l’usage faite il y a trois siècles et qu’on a figé. Or, on devrait pouvoir la faire évoluer. Le conservateur dira : il n’y a que des fautes. Celui qui est dans une démarche scientifique dira : il y a des faits, des usages qui ne correspondent pas à la norme qu’on a établi, donc il faut peut-être actualiser la norme.
Les conservateurs français ont une sacrée porte-parole : l’Académie française. Votre Conseil n’est pas du tout son équivalent en Belgique ?
Non ! On a une Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, mais qui n’est pas du tout aussi contraignante et stupidement autoritaire, et qui est composée, pour partie, de linguistes ou de philologues, c’est-à-dire de professionnels de la langue. L’Académie française, elle, n’a pas de linguiste depuis le début du XXe siècle. Mais c’est une institution d’Ancien Régime, qui garde une aura. On a, en France, une République, une langue, une orthographe et une Académie, qui en est la censeure. Tout va ensemble.
Est-ce qu’il y a des décisions de l’Académie qui nous touchent directement ?
Oui. Prenez les mots composés. Avant, on mettait simplement un s au pluriel, ce qui est tout à fait logique. Mais, au XIXe siècle, les membres de l’Académie ont commencé à compliquer les choses, même au singulier. « Un casse-noisettes », ça casse des noisettes (donc avec s à « noisette » au singulier) alors qu’« un tire-ligne » tire une ligne à la fois (donc sans s à « ligne »). On est parti dans des interprétations qui font qu’on ne sait jamais s’il faut un s ou pas. C’est entré dans les manuels scolaires, avec des listes à apprendre…
On se réfère donc, même en Belgique, aux avis de l’Académie française, malgré son absence de crédibilité scientifique ?
Oui, et c’est une erreur. Elle n’a pas du tout les compétences. L’exemple ultime est celui du mot « Covid ». Tout le monde, à part au Québec, disait « le » Covid, parce que c’est « le virus » ou le « coronavirus ». Et tout à coup, l’Académie a dit : « Non, non, non, il faut dire “la” Covid. » Leur raisonnement est tout à fait crétin : le d de « Covid » renvoie à « disease » en anglais, donc à « maladie », qui est un nom féminin. Sauf que « disease » en anglais est neutre. Et si vous raisonnez comme cela, « weekend » devrait aussi être « la » weekend, puisque « end », c’est « fin ». Ça montre bien comment cette institution jouit d’une crédibilité proche de zéro auprès des spécialistes.
Elle a malgré tout fini par approuver la féminisation des noms de métiers…
Mais il a fallu la pousser dans le dos pendant 40 ans pour qu’elle bouge ! Elle dit : oui, maintenant, nous sommes « pour ». Mais tout ce qu’elle a dit « contre », pendant 40 ans, était lamentable, indigne d’intellectuel·le·s.
De même, elle a un peu sapé les avancées proposées par la réforme de l’orthographe votée en 1990. Même Médor ne l’applique pas (sauf dans ce texte) !
L’Académie a été tout à fait hypocrite : les académiciens avaient signé cette réforme mais ils n’en voulaient pas. Abandonner l’accent circonflexe sur le i et sur le u (par exemple dans « cout » ou « diner »), c’est tellement affectif pour les Français ! On nous a dit qu’il fallait mettre un accent sur « voûte », sinon on ne voyait pas que la voute avait un toit. Moi, ma maison a un toit et je ne mets pas d’accent circonflexe sur le i de « maison ». Ce sont des arguments non scientifiques, qui montrent bien qu’on est dans l’affect. On ne peut pas dénier les questions d’affect ; chacun peut en avoir. Mais on vit en collectivité et la collectivité doit pouvoir se comprendre et s’approprier ses outils.
Dans quelle instance peut-on débattre de ces questions, qui concernent toute la francophonie – y compris les pays du Sud ?
Le Conseil belge est en faveur de la création d’un Collège des francophones, une institution transnationale qui réunirait des spécialistes des langues, des praticiens, des professeurs de français de toutes les zones de la francophonie, qui pourraient faire tous ensemble des propositions aux États pour faire évoluer la langue et mieux accompagner les changements. Nous avons lancé une recommandation en ce sens.
Un droit fondamental
Votre recommandation sur le participe passé tient en trois règles. C’est une révolution pour l’enseignement ?
Oui. Dans le Bon Usage, il y a 42 règles d’accord du participe passé. Acceptons de déplacer notre point de vue : vous les avez appris ? Surement pas toutes. On écrit « La pomme que j’ai mangée » mais « J’ai mangé la pomme ». Qu’est-ce qui est important : de faire toute l’analyse de la phrase pour savoir que « la pomme » est le complément direct du verbe et voir s’il précède ou non ? Non, ce qui compte, c’est que quelqu’un a mangé une pomme, c’est de produire ou de comprendre le compte rendu qui est fait de cet évènement. Je remarque par ailleurs qu’on passe des dizaines et des dizaines d’heures à apprendre comment s’accorde le participe passé, alors que l’on ne sait guère ce qu’est un participe passé (on ne l’enseigne que trop peu souvent) et qu’on sait à peine à quoi il sert : quel est le sens d’un tel apprentissage ?
Cette proposition a-t-elle une chance d’être adoptée ?
Là où l’on peut avancer plus facilement, c’est sur l’accord avec « avoir ». Cela aurait déjà un effet massif. Les recommandations de notre Conseil datent de 2013. Le Conseil international de la langue française a fait ensuite des recommandations équivalentes. Pour l’accord du participe passé, les Belges sont précurseurs en francophonie. Et précurseurs entêtés et tenaces.
Vous commencez à mettre la pression sur les politiques ?
Oui, on a déjà interpelé la ministre de la Culture lors de législatures précédentes et on va le refaire à cette rentrée. On peut aussi interpeler la ministre de l’Enseignement et les parlementaires. Il faut au moins relancer le débat pour la prochaine législature, montrer la nécessité d’une réforme et le gain qui s’en dégagera.
En attendant un accord international, que peuvent faire nos ministres ?
Elles pourraient déjà instituer une tolérance dans les écoles, les examens ou les concours, sur l’invariabilité du participe passé employé avec « avoir ». Dire : si certains n’accordent pas, ce n’est pas grave. On ne considère pas cela comme une faute. Cette invariabilité est déjà dans les usages et s’explique d’ailleurs parfaitement dans le cadre de l’évolution du système de la langue. Mais tant que cette tolérance n’est pas instituée et qu’il y a une variété du français socioprofessionnellement valorisée qui impose la règle traditionnelle, je ne vais pas pouvoir dire : n’accordez plus quand vous rédigez votre CV. Même si, à titre personnel, je trouve normal que les gens arrêtent d’accorder le participe passé avec « avoir ».
On a donc besoin qu’il y ait des choix politiques qui valident les réformes…
Oui. Et politiquement, c’est assez compliqué. Parce qu’il y a une force symbolique, des enjeux de pouvoir. Ce sont ceux qui ont le pouvoir institutionnel ou intellectuel qui ont la capacité de changer les choses. Or, quand vous avez un pouvoir qui vous distingue des autres, comme la maitrise de l’orthographe, vous n’avez pas forcément envie de vous en séparer. Personnellement, je maitrise assez bien l’orthographe. Mais ma colonne vertébrale, c’est la non-discrimination et les droits fondamentaux. Je veux tout faire pour que tout le monde partage ce pouvoir. Et ça passe par accepter de changer les règles, non pas pour niveler par le bas, mais pour gagner en cohérence.
Chez nous, la nécessité d’une réforme fait consensus chez les linguistes ?
Oui, en Belgique, vous n’entendrez aucun linguiste qui s’y oppose. En gros, les « professionnels de la profession » sont d’accord pour dire qu’il faut faire quelque chose. Mais il y a un problème de courage politique. Parce que la langue, c’est beaucoup d’affect – plus en France qu’en Belgique, mais quand même, il y a une forme d’importation de cet « amour de la langue ».
L’élan vient quand même d’ici… C’est étonnant ?
Non. Ce qui fait qu’on se pose peut-être plus facilement des questions, c’est qu’on a toujours été en marge de la France. On s’est toujours fait railler, moquer par les Français qui pensent qu’on ne parle pas bien le français, qu’on ne le parle pas depuis longtemps – alors qu’on parle français en Belgique depuis plus longtemps qu’à Nice ou à Marseille. Cela a généré une « insécurité linguistique », ce dont parle très bien la sociolinguiste Maria Candea. Ce sentiment d’insécurité est, chez nous, une seconde nature. On a eu l’impression qu’on n’était pas bons, vu qu’ils se moquaient de nous. Ça a généré quoi ? Grevisse, Goosse, Hanse, Doppagne, Warnant : tous les plus grands normativistes du français sont belges. On a dû leur montrer qu’on maitrisait. Puis, quand on en a eu assez de s’excuser, à un moment, on s’est dit : il faut dépasser ce stade-là. Ce n’est pas nous qui sommes forcément en faute. Chaque locuteur est copropriétaire de sa langue. L’Académie française n’a ni le droit, ni le pouvoir, ni la compétence d’imposer ses choix à tous les francophones.
Vous avez été président de la Ligue des droits humains. Dans votre combat, il y a cette idée que la langue appartient à tous, comme un droit fondamental ?
Oui, pour moi, la langue est vraiment le lieu d’un enjeu de pouvoir. Celui ou celle qui maitrise la langue ne se laisse pas avoir, maitrise la manière dont il présente les choses ou dont les choses lui sont présentées. Il est donc capable de participer à la mise en scène de la société.
Il faut convaincre les politiques mais aussi les profs de remettre en question leur vision de la langue et de son acquisition ?
Oui. Le XIXe siècle, où l’on a commencé à enseigner le français, est un siècle d’obéissance. On a appris le français en demandant d’intégrer et de respecter aveuglément des règles. En revanche, au XXIe siècle – et déjà au XXe –, les objectifs de l’enseignement ont changé. On veut des élèves autonomes, dotés d’esprit critique. Mais on continue à leur donner des outils qui ne fonctionnent qu’avec l’obéissance. Ce n’est pas en disant « Tais-toi et obéis » qu’on va y arriver. Pour moi, la grammaire, c’est une vraie question sociale.
Vous travaillez dans les écoles, depuis vingt ans, à une recherche sur la réforme du discours grammatical. On enseigne trop et mal la grammaire, selon vous. Que font les anglophones, par exemple ?
À l’école, ils apprennent à s’exprimer et ils ne font pratiquement pas de grammaire. Les Finnois, dont on vante le modèle et les résultats, n’en font pas du tout en primaire. Nous, on a vraiment tout retourné pour mettre l’orthographe comme priorité. Je rencontre des linguistes étrangers très étonnés : quoi, vous faites de la grammaire en primaire ? Ben oui, on est obligés. Et pourquoi vous êtes obligés ? Parce qu’on doit apprendre l’orthographe.
Qu’est-ce qu’on fait de travers ?
Comme on est braqués sur l’orthographe, on ne s’intéresse qu’à la phrase. On se focalise sur la « nature » (verbe, nom, adjectif, etc.) et la « fonction » (sujet, complément direct du verbe, etc.) des mots. Parce que les règles d’accord dépendent de la place des mots dans la phrase ou du rapport des mots entre eux.
On fait de la dissection de phrases plutôt que de s’intéresser au sens du discours…
Oui. Les élèves belges francophones – mais aussi français – se plantent aux enquêtes PISA, qui sont des tests standardisés pour les élèves de 15 ans des pays membres de l’OCDE. On leur fait lire des textes pour évaluer leur niveau de compréhension. Or, chez nous, les textes sont envisagés seulement à partir de la deuxième secondaire. Ces élèves de 15 ans, dont plus de 40 % ont déjà un retard d’au moins une année, n’ont, pour une grande partie d’entre eux, jamais analysé le sens d’un texte. C’est normal qu’ils se plantent.
Vous proposez quoi ?
Assurons-nous d’abord que les élèves comprennent bien les textes, et étudions seulement ensuite avec eux comment ces textes sont composés, d’abord de phrases et puis seulement de mots.
La FWB a fait un nouveau référentiel de français, pour le tronc commun (jusqu’à 15 ans), qui dit ce qu’il faut enseigner et quand. Vous avez été consulté ?
Oui, sur la fin, pour la grammaire. La vision de ce nouveau texte va dans le bon sens : il faut commencer par la régularité et non par l’exception et ne pas se baser sur l’étiquetage mais sur la construction du sens. Cela étant, il y a encore du travail pour faire intégrer cela par les enseignantes et les enseignants ainsi que par les élèves. Je me déclare disponible pour assister mes collègues dans ce processus.
Une propre culotte
Votre truc, ce n’est pas de traquer les fautes sans arrêt. Quand on entend les enfants dire « Je vais mettre une propre culotte », ma « préférée couleur », il ne faut pas paniquer ?
Les linguistes ne considèrent pas qu’il y a des fautes mais qu’il y a des faits. Ils observent. Une « propre culotte », chez nous, ça fait longtemps qu’on dit ça. Une autre chose qu’on entend beaucoup dans nos écoles, c’est : « Je peux la gomme ? » Évidemment, cela ne fait pas partie de la variété de français socioprofessionnellement valorisée, que l’école a la responsabilité d’enseigner. Mais c’est du français ! Il n’y a pas de langue unique. Il y a de nombreuses variétés, qu’on utilise en fonction des contextes. Ce n’est pas un complot contre la langue.
Les jeunes abiment la langue : c’est une idée répandue par les « déclinistes », contre laquelle les Linguistes atterré·e·s réagissent…
Oui. Nous démontons ce discours sur le « nivèlement par le bas », le déclin, qui dit que la culture est foutue, que le niveau baisse, qu’on se casse la gueule. Non, il n’y a pas d’effondrement. Il y a une vraie vitalité.
Les langues évoluent, avec des mouvements de simplification et d’enrichissement. En fait, tout va bien ?
Oui. Un décliniste sur Facebook écrivait : « Les nuances se perdent, on n’écrit plus au passé simple, on perd du vocabulaire, on perd la capacité à exprimer les choses, la pensée s’appauvrit et les gens vont devenir stupides. » Ça a l’air évident. Sauf que la langue ne fonctionne pas comme ça. Si on perd l’usage du passé simple, ce n’est pas par paresse, c’est le système de la conjugaison qui a évolué depuis plus d’un siècle, comme il l’avait déjà fait en latin.
Il y a aussi des problèmes d’opposition de sons.
Tout à fait. En France, encore plus qu’en Belgique, on ne distingue plus toujours le é et le è. La chanteuse Angèle fait d’ailleurs rimer « accepté » et « plait ». On perd donc l’opposition entre le è de « je chantais » et le é de « je chantai ». Et on cherche dans le système d’autres manières de dire les choses distinctement, par exemple en utilisant le passé composé « j’ai chanté » pour exprimer le caractère de passé ponctuel à la place de « je chantai ».
On ne perd donc pas de nuances, on change juste l’usage ?
Oui, c’est bien ça. Et cela fait évoluer le système : ça ne le détruit pas. Ce qui me fait mourir de rire, c’est qu’on incrimine « les jeunes », mais ça fait une éternité qu’on n’utilise plus le passé simple ! Les premiers qui ont arrêté de dire « nous chantâmes », ce sont les parents des « vieux » qui râlent aujourd’hui sur les jeunes. D’ailleurs, les changements de syntaxe ou de morphologie, ça prend un temps de gueux. Ça se fait rarement sur une génération. Contrairement au vocabulaire. Et là, pour le coup, les jeunes sont très créatifs – beaucoup plus que l’Académie française.
Les discours nostalgiques évoquent souvent la génération des « grands-parents » qui savaient écrire sans faute…
Ma grand-mère à moi était Juive polonaise et elle ne savait pas écrire. La vôtre savait écrire sans faute parce qu’elle n’avait appris que cela : à écrire et à compter. Elle faisait de la calligraphie, mais elle ne comprenait pas pour autant ce qui se passait. Si on essaie de réduire l’intelligence des gens à leur connaissance de l’orthographe, fatalement, on va dire qu’il y a une baisse de niveau. Mais ils savent plein d’autres choses – et même sur la langue !
Les déclinistes poussent des cris d’alarme passionnels face à l’état du français. Les Linguistes atterré·e·s leur répondent par un discours plus optimiste et objectif. La langue cristallise de sacrées tensions idéologiques.
Oui, dans le monde de la pédagogie et de la langue, je sens de plus en plus une opposition « droite/gauche », « conservation » versus « émancipation », « liberté » et « créativité ». Ceux qui sont du côté de la conservation prônent l’unicité de la langue ; les autres revendiquent sa diversité, sa richesse. Avec ceci de particulier que les Atterré·e·s avancent avec études scientifiques – et non fantasmes – à l’appui.
Suite à la parution de ce grand entretien, Dan Van Raemdonck fut invité sur radio campus. Interview à réentendre ici

-
Voir notre interview d’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, « Les profs du fond de la classe », dans Médor n°15.
↩