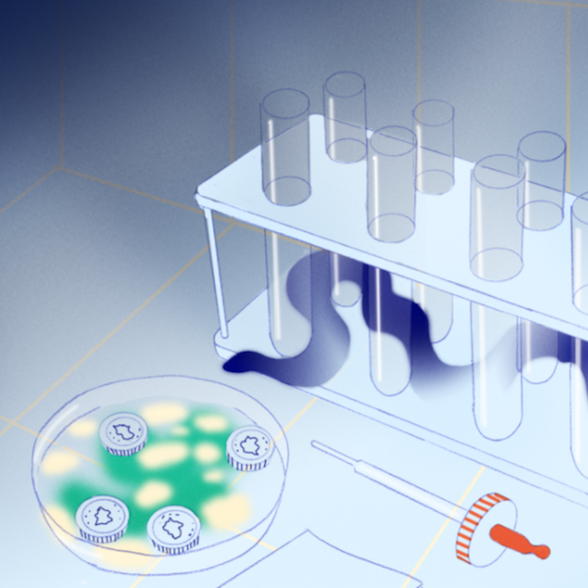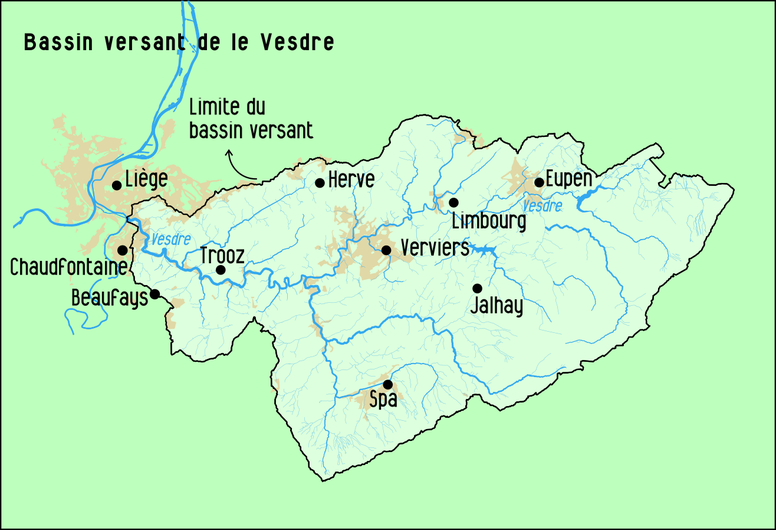La peine de vivre
Depuis une quinzaine d’années, le traitement par immunothérapie soigne certains cancers. Des personnes jadis condamnées guérissent. Mais au soulagement et à la joie se mêlent l’angoisse, la dépression. Une souffrance paradoxale quand tout le monde, autour de vous, se réjouit. C’est bien la peine de vivre.

Elle n’aime pas trop ce terme. Survivant. Non. Ça, elle n’aime pas trop. Pourquoi ? Elle sait pas. Peut-être parce que, s’il faut survivre, alors c’est plus une vie. Peut-être. Ou alors parce que cela signifie une sous-vie. Ou parce que la survie, c’est pas encore sûr. Cette foutue date. 20 octobre. Un PET-scan pour vérifier que tout va bien. Qu’il n’y a plus rien. Vraiment rien. Bon, on verra bien. Plus elle approche, plus la tension monte. Un peu. Elle doute encore. On ne va pas se mentir. Derrière elle, les avions atterrissent avec régularité. On les aperçoit de son appartement au troisième étage. Lumineux. Avec ses murs blancs. Elle et son mari ont déménagé pendant la maladie. Elle n’avait plus de souffle. Grande maison et enfants partis. Fallait installer de l’oxygène en haut, oxygène en bas. C’était l’occasion. Ils ont vendu. Acheté. Un bel appartement avec une entrée directe, dès la sortie d’ascenseur. C’est classe. Dans un coin, des jouets pour les petits enfants. Eux viennent le jeudi. À table, du café. C’est difficile de ressasser ces derniers mois. Les paroles percolent. Lentement. Guérie ? Non ça, elle ne le dira pas. Sophie ne sait pas comment elle va. Et c’est terrible de ne pas savoir. Alors elle attend le 20 octobre.
Automne
Trois ans auparavant. Octobre 2018. Un jour, Sophie se rend à la bibliothèque. En chemin, elle a oublié quelque chose. Fait demi-tour. La rue monte un peu. Arrivée chez elle, impossible de repartir. Le souffle coupé. Ce n’est pas normal. Puis il y a ces douleurs costales basses, comme elle dit. C’est précis. Sophie est kiné. Elle a 62 ans. Elle fait un premier examen radiologique. On distingue mal. Alors, il lui faut un examen PET-scan. Le même jour. Un empressement qui effraie. Elle voit un neurologue.
Elle a oublié comment le couperet est tombé. Henri était là. Il est dans le médical. Elle avait l’impression que le spécialiste ne parlait qu’à lui. Le toubib dit qu’il faudrait voir un oncologue. Quelque chose comme ça. Le terme glisse dans la conversation. Rien de solennel. Presque une prescription. Plus tard elle saura. Adénocarcinome pulmonaire à grandes cellules. Un cancer des poumons. Bordel.
Le retour dans la voiture. Lui se souvient de mots de réconfort. Faut tout tenter. Elle se souvient du silence. Le diagnostic est catastrophique… Quand Henri a vu la première fois la radio, il s’est dit : ça va encore. Seulement quelques taches sombres dans un îlot de pointillés fluorescents. Il a confondu. Les points fluorescents, c’étaient les cellules cancéreuses. Ça mitait de partout.
Le cancer en est au stade quatre. Une vertèbre est touchée.
Il y a quelques années, on aurait invité Sophie à fermer boutique. Régler l’héritage. La maison. Les dernières volontés, si elle avait le courage d’en parler. Il y a quelques années, l’oncologue devait être honnête. Il prononçait des phrases comme « il n’y a plus d’espoir », « on ne peut rien faire ». Ces paroles résonnent encore dans la tête de la première génération des « survivants ». Ça laisse des traces d’avoir eu la mort comme voisine. De l’avoir regardée dans les yeux. Mais ça, c’était avant l’immunothérapie.
L’immunothérapie donne de grands espoirs. Elle renforce les défenses naturelles du corps. Au niveau biologique, le processus est très complexe. Expliquons-le simplement. Si vous voulez zapper l’aspect technique, passez le texte sur fond vert.
Quel traitement envisager pour Sophie, en octobre 2018, au moment du diagnostic ? Vu l’avancée de la maladie, la chirurgie n’est plus envisageable. Il lui reste trois types de thérapie pour combattre le cancer. Un traitement par médicaments, l’immunothérapie, ou la chimio puis l’immuno’. Le crâne sans un poil. Elle était prête à dire qu’elle n’en voulait pas, de ces traitements. Faut garder une certaine élégance. On s’accroche à ce qu’on peut. Mais ce sera l’immuno’.. Nous entrons dans la phase du traitement.
En 1985, le professeur américain Fitzhugh Mullan a comparé ces étapes du soin du cancer aux quatre saisons de l’année. La phase du diagnostic est la première saison. La deuxième saison est le temps du traitement. La troisième est une phase de suivi, la quatrième saison correspond à la guérison complète. Mais Mullan n’a pas défini quelle était la première saison, celle du diagnostic. Est-ce l’été, le printemps, l’automne ou l’hiver ? Anne Rogiers est psychiatre au CHU Brugmann. Elle accompagne beaucoup de patients atteints et guéris de cancers. Elle a mené sa thèse sur ce sujet. Pour elle, la première saison est celle de l’automne.
Les feuilles sont tombées. Arrivent les premières neiges du traitement.
Hiver
Sophie a écrit à ses patients qui ont mal au dos, mal au pied, mal à la tête. « J’arrête la kiné. » Le lendemain, c’était fini. Henri part au boulot comme d’habitude vers 8 heures. Il reviendra vers 18 ou 19 heures. Et elle, elle n’est pas préparée. À cette pension qui déboule sans prévenir. Elle n’est pas préparée à ce chemin sans projet.
Avant sa première injection, en janvier 2019, elle est hospitalisée. Des douleurs insupportables causées par un tassement vertébral. Elle crève de mal. Henri le voit bien. Il appelle leur fils qui est à l’étranger. Ce serait bien qu’il revienne au moment des vacances de Noël. Il la voit partir.
Elle sort de l’hôpital avec un corset pour soutenir la colonne et une assistance en oxygène.
Elle commence l’immunothérapie. Elle réagit bien. Vraiment bien. Les points fluorescents commencent à se réduire. Lui n’en revient pas. « C’est un truc immense, avec peu d’effets secondaires. »
Sophie a eu cette chance de réagir dès le premier traitement.
Valérie Dupuis n’a pas connu le même chemin.
En 2011, on lui annonce un mélanome métastasé. Elle a 26 ans, est en couple depuis un an et demi avec Benjamin. Elle lui dit : « Tu peux partir, je comprendrai. » Il reste. Elle est opérée. Bombardée d’ondes, la tumeur reste aussi. D’essais en traitements innovants, Valérie enchaîne les échecs. Les scans sont chaque fois un peu moins bons. Elle écrit une lettre à donner à son décès. À 28 ans, elle pose cette question au professeur Neyns. « Est-ce que je fêterai mes 30 ans ? » Elle se rappelle très bien la réponse, mot pour mot : « Vous êtes dans une situation délicate et je ne peux pas vous garantir que vous verrez vos 30 ans. »
Valérie prononce à nouveau ces mots neuf années plus tard, au mois près. Depuis, elle s’est mariée. A eu deux enfants. Et est guérie. Parce qu’un jour, son corps a réagi et entamé le combat.
Elle fait partie des premières bénéficiaires de l’immunothérapie. Si Valérie arrive en renfort dans le récit, à côté de Sophie, c’est parce que son histoire permet d’avoir du recul. Et ce recul, elle en a même fait son nouveau métier.
Aujourd’hui, cette infirmière de formation accompagne les personnes cancéreuses.
Il est temps de changer de saison.
Printemps
Le traitement réagit. Sophie va bien. Elle va mieux. Une perfusion de vingt minutes toutes les trois semaines. Parmi les inconnues, il y a la durée du traitement. Que peut-elle espérer ? Quel est son horizon ? Les médecins sont prudents. C’est « le temps qu’il faudra », « difficile à dire ». Des journées sans perspective, cela déséquilibre. Cela va durer près de deux ans.
Petit à petit, Sophie regagne une vie. Ses petits-enfants, le bénévolat à la bibliothèque. Elle aime bien les polars. Mais le livre qui la marque, c’est ce premier roman de Mélissa Da Costa, Tout le bien du ciel. L’histoire d’un Alzheimer précoce à qui on donne encore deux ans de vie. Il quitte sa famille pour ne pas être un poids. En 2020, le coronavirus arrive à point pour Sophie. Ça lui a fait du bien d’être enfin comme tout le monde. Seule, isolée, chez elle. Enfermée à ne rien foutre.
Au détour d’une visite, sa dermato lui dit qu’elle est à côté de ses pompes. Qu’elle ne va pas bien alors qu’elle va mieux. Qu’elle devrait aller voir la psychiatre Anne Rogiers, du CHU Brugmann (Bruxelles). Sophie n’est pas une exception. Les études de la docteure Rogiers montrent que la moitié des survivants d’un cancer font état de signes d’anxiété, de dépression, de fatigue. Ces soucis psychologiques et physiques peuvent être aggravés par des déboires financiers. Et toujours dans ces mêmes études, la professeure constate que, loin de s’atténuer avec le temps et la guérison, la situation empire au bout d’un an.
Valérie Dupuis a connu cette lente rémission de 2012 à 2014. Elle a connu cette période tête baissée, où le corps et le cœur sont tendus vers la guérison. Puis cette période où on redresse la tête. Et les choses ont changé. « L’après n’est pas la suite de l’avant, dit-elle. Vouloir recoller ce quotidien perdu ne marche pas. Nous sommes différents. » Elle y a trouvé de la force.
Elle raconte l’entourage qu’il faut ménager alors qu’on en crève. Les amis toxiques qui trouvent que « maintenant c’est bon ». Elle souligne la présence de son compagnon bien à sa place, efficace, les pieds sur terre. À l’époque, Valérie a vécu une période floue, peu épanouissante. Elle a réinventé ses valeurs, a repris contact avec son corps, l’a écouté, a accepté son nouveau rythme. Et elle a enchaîné les siestes jusqu’en 2017. C’est comme ça.
Sophie, elle, encaisse encore la fatigue, l’anxiété. Évidemment. Elle cherche encore ses mots. C’est normal. Elle connaît ces instants où elle devrait être contente, ferait mieux d’en profiter. Et n’en profite pas. La docteure Rogiers le sait : l’incertitude du traitement a un impact psychologique énorme. Henri, lui, aurait bien voulu avoir quelqu’un à qui parler. L’entourage encaisse, c’est sûr… Aujourd’hui, il voudrait tourner la page. C’était à la fois difficile de voir sa compagne vivre dans une telle inquiétude et difficile pour lui de vivre sans projet. Il est du genre hyperactif taiseux. Il s’impatiente de cette vie laissée sur le bas-côté.
Durant le « printemps », des patients sortent le sourire aux lèvres du cabinet Neyns, puis s’effondrent dans le bureau de la professeure Rogiers. Entre ces deux portes se trouve le paradoxe du survivant, encombré par sa propre existence. Les patients culpabilisent de guérir et de ne pas baigner dans la joie. On leur parle de rattraper le temps perdu, de profiter tant qu’on peut. Mais ils n’y parviennent pas. Vivre n’est pas si aisé.
Début janvier 2021, on a proposé à Sophie de stopper l’immunothérapie. Elle n’avait pas osé le demander, mais elle n’a pas hésité une seconde. Reste l’attente. Son fameux PET-scan du 20 octobre est le scan « test ». Le traitement est arrêté depuis six mois. L’inquiétude est presque théorique. Selon la littérature médicale, on est guéri après deux ans sans rechute. Mais Sophie ne vit pas dans la littérature médicale. Et les orages ne sont pas rares en été.
Été
L’annonce d’un cancer est brutale. C’est un moment violent, fondateur, point de départ pour signaler qu’une phase particulière de notre vie débute. Mais si on annonce le point de départ, comment signale-t-on le point de sortie, la fin du cancer ? Y a-t-il une désannonce ? Un moment aussi violent où l’on raconte que si tout a commencé un jour, tout est aujourd’hui fini ? Pas vraiment. Si le désespoir tombe comme une épée de Damoclès, l’espoir arrive graduellement. À pas feutrés.
Quand Henri dit le mot « guérison », il ajoute « entre guillemets ». Sophie, elle n’ose pas le prononcer. « Mais personne n’ose. Moi je ne veux pas. Je ne sais plus (silence). Parfois… (elle ne finit pas sa phrase). C’est difficile de dire qu’on est guéri. »
Après sept ans, Valérie connaît toujours des angoisses. Mais la peur l’a quittée. Elle visite encore le docteur Neyns une fois par an. Une routine. « Avant, les IRM me rassuraient. Maintenant ça me fait ch… de caser les gosses pour y aller. »
Même si l’immunothérapie a fait ses preuves sur une quinzaine d’années, comment savoir si la guérison sera définitive ? Après l’été, n’est-ce pas l’automne ? La docteure Rogiers acquiesce. « Le fait que les saisons reviennent est symbolique quant au risque et à l’anxiété du patient que le cancer peut se réveiller. » Les survivants ont vu la mort en face. Leur trauma post-survie est de plus en plus documenté et la professeure Rogiers travaille à un protocole pour une prise en charge adéquate de ces souffrances. Avec un service sur mesure. Pas un grand barnum médical. « Il ne faut pas des soins psychiatriques spécialisés ou médicamenteux pour en sortir. Il faut reconnaître la difficulté et la traiter. »
Ces lignes ont été écrites le 20 octobre. Au moment de les coucher, Sophie est peut-être allongée sous l’appareil qui traque la moindre cellule cancéreuse.
Quelques jours plus tard, il est juste temps de prendre de ses nouvelles, avant de boucler cet article. Un appel. Elle décroche.
— Madame Sophie ?
— Oui ?
— Comment allez-vous ?
— Le PET-scan est excellent. Pas un seul foyer suspect de récidive.
— Formidable ! Alors vous êtes guérie ?
— Je ne dirais pas guérie. On n’est jamais à l’abri. Mais je vais bien.
Décembre 2021. L’été est là.
Illustration musicale proposée par Point Culture
Cet article a reçu le Prix 2022 du Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles. "Le jury a salué le sens du récit, la qualité de l’écriture, simple et efficace, l’important travail de vulgarisation, le caractère humain et bienveillant de l’article, l’optimisme qui s’en dégage et la validation par un scientifique pour aller plus loin."