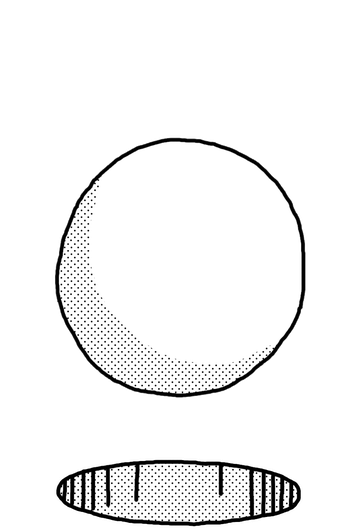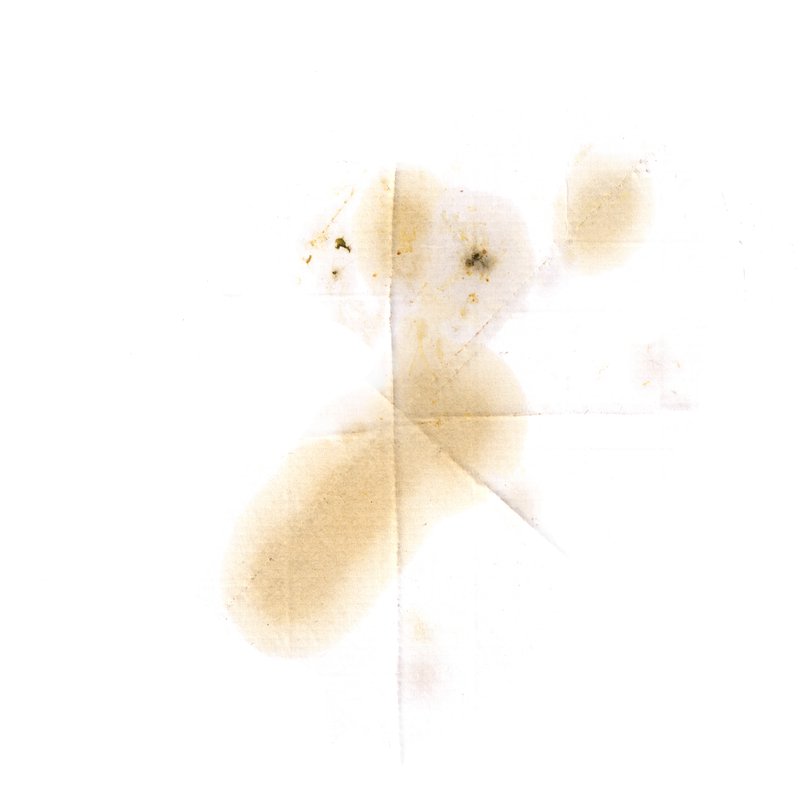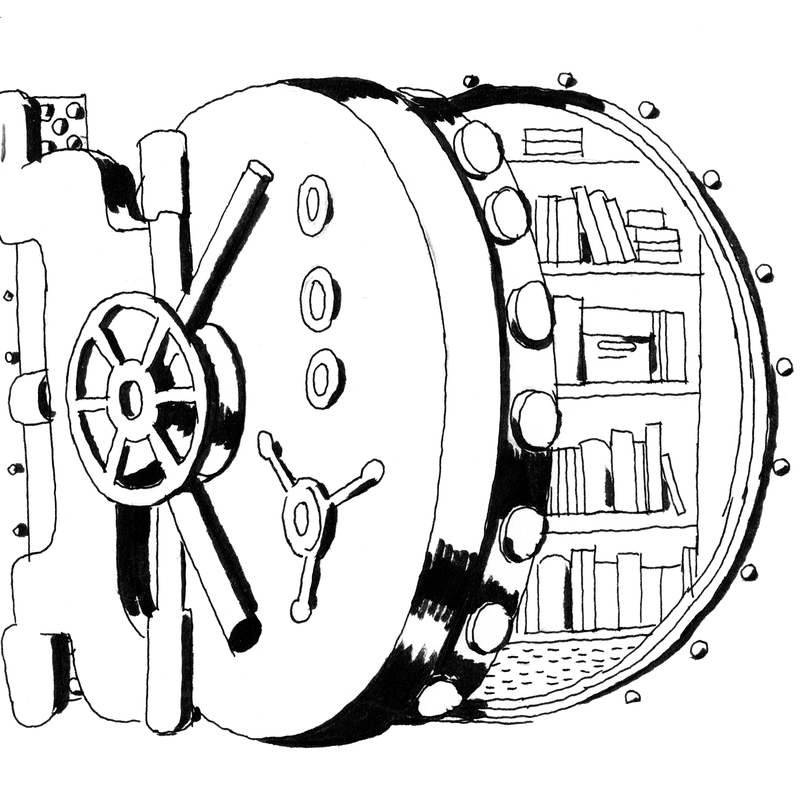Le bio à la masse
Enquête (CC BY-NC-ND) : Steven Vanden Bussche (Apache) & François Heinrich & Olivier Bailly & Céline Gautier & Chloé Andries & Sandrine Warsztacki
Publié le
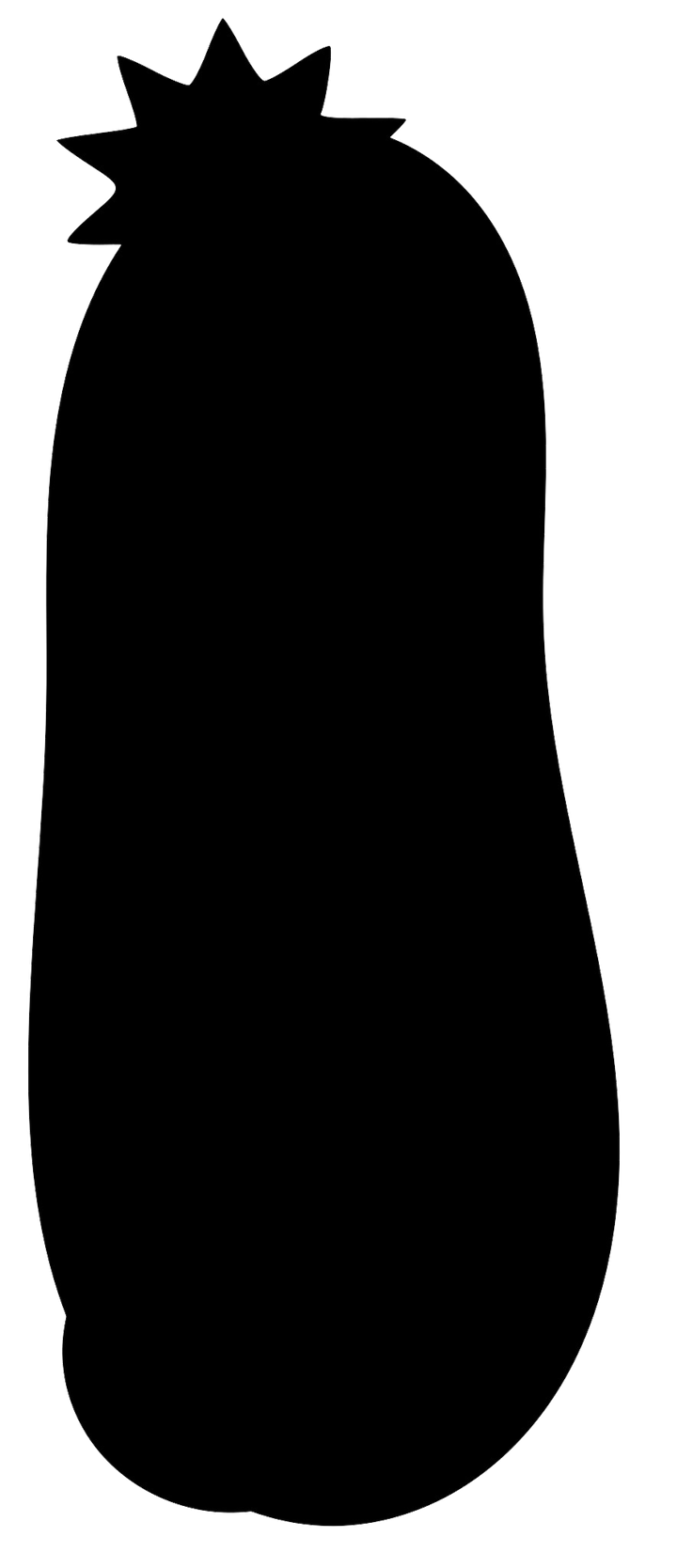
Le marché des produits bio explose. Les épiceries sont rejointes par les supermarchés, eux-mêmes distancés par le hard discount. Et la pierre angulaire de ce mouvement, c’est le portrait rassurant du producteur local aux mains brunies de terre. Mais qui palpe vraiment le blé ? Et qui est roulé dans la farine ? Petite visite dans la distribution bio. Rayon fruits et légumes.
« Oui à la diversité du bio local, non à l’hégémonie des grandes surfaces. » C’est sous ce titre qu’était lancée, l’été dernier, une pétition contre l’implantation d’un supermarché Bio-Planet à Corbais, en Brabant wallon. Parmi les insurgés, des acteurs du bio ! Un producteur du coin (l’Archenterre) et un magasin de la première heure (Bi’OK). Du bio qui râle sur du bio, une bête question de parts de marché ? Pas uniquement. Les pétitionnaires craignaient de voir un patapouf parvenu, appartenant au groupe Colruyt, vendre du bio sous plastique produit à des milliers de kilomètres et leur piquer les fruits d’un lent processus en faveur d’une consommation respectueuse de l’homme et de l’environnement. « Le bio garantit l’absence de pesticides, d’additifs dans les aliments transformés et des techniques de fertilisation organiques, rappelle François de Gaultier, agronome et maître assistant à la Haute École de la Province de Namur. Le bio ne garantit pas autre chose. Il ne faut pas demander au bio ce qu’il ne vend pas. »
Mais pour les pétitionnaires, le bio, ça dépasse « le simple commerce de produits aux normes bio ». « Il y a deux courants dans le bio, explique Pauline Henrion, de Bi’OK, qui possède quatre magasins en Brabant wallon. Ceux qui veulent simplement manger mieux et ceux qui sont convaincus par un projet global. » C’est vrai pour les clients mais aussi pour les commerçants : certains veulent juste vendre ; d’autres impacter positivement la société.
L’enjeu du bio aujourd’hui tourne de plus en plus autour de la distribution. De nouveaux acteurs débarquent en pagaille sur un marché très porteur. Claude Gruffat, auteur de Les Dessous de l’alimentation bio (Éd. La Mer salée, 2017), le constate. « En France, et de ce que je perçois en Belgique, nous sommes à un moment de changement d’échelle de la consommation de produits bio. Tout le monde parle d’un marché, et c’est assez récent. Il a atteint en France les 4 % de l’alimentation, soit le seuil habituel pour que de nouveaux arrivants se manifestent pour entrer sur cette niche. »
4 % ? C’est justement la part « bio » du marché alimentaire belge. Un gâteau qui grossit mais à partager avec de plus en plus de personnes à table : Bi’OK (4 magasins), Bio-Planet (27), Färm (6), Al’Binète (4), Sequoia Bio & Natural Market (6), Biocap (4), Biostory (3), Ekivrac (2), La Ruche qui dit oui (102) et autres innombrables établissements locaux qu’il est impossible de citer ici…
Qui empoche ?
Pour remplir les étagères de tous ces nouveaux relais, l’offre agricole s’étoffe. Depuis 2003, le nombre de fermes bio en Wallonie a presque quadruplé, passant de 455 fermes certifiées en 2003 à 1 493 en 2016, soit 12 % des fermes wallonnes. La surface a elle plus que triplé : de 20 736 à 71 289 hectares, soit 10 % des terres wallonnes.
Les hypermarchés aussi prennent au sérieux les produits bio, eux-mêmes concurrencés récemment par le hard discount (comme Aldi et Lidl), qui vend 10 % des produits bio, contre 1,2 % en 2008. Et avec eux arrivent les politiques agressives de prix. « Si nous ne pouvons pas garantir la qualité et un petit prix pour un produit bio, celui-ci ne fera pas partie de nos produits », confirme Julien Wathieu, porte-parole du groupe Lidl/Aldi. Malgré cette politique offensive, globalement, le bio reste plus cher que le conventionnel. Et les marges, plus juteuses.
Selon une étude française de l’association de consommateurs UFC-Que choisir d’août 2017, la grande distribution se prendrait des marges considérables sur les produits bio. Elle a comparé 24 fruits et légumes, et le panier au label vert est 79 % plus cher que son équivalent conventionnel. Le supplément de prix demandé s’expliquerait de deux façons : une moitié due à des coûts de production plus élevés en bio, et une autre moitié due à… des « surmarges » réalisées par les grandes surfaces. Ces gains sont notamment possibles par les économies d’échelle que permettent les commandes importantes au niveau européen. « La grosse concurrence, bio ou pas bio, c’est l’Espagne, car les normes sociales y sont plus basses, explique l’agronome François de Gaultier. La concurrence vient aussi de Hollande, où la production est hypertechnicisée, avec des serres high-tech et de la culture automatisée. » Une visite au Lidl de Molenbeek n’a que la force d’un instantané mais qui colle parfaitement aux propos de l’agronome.
Au rayon fruits et légumes bio, les tomates cocktail viennent de Belgique, mais les carottes, courgettes, pommes de terre grenaille et citrons ont voyagé de Hollande ou d’Espagne pour rejoindre nos cageots. La cohérence de l’engagement ? Le prix le moins cher.
Concombres luxo-mexicano-belges
Le premier Bio-Planet bruxellois a choisi de s’installer dans les beaux quartiers. Le magasin ucclois annonce dès le parking sécurisé que vous entrez dans une construction durable, grâce à la réduction d’émissions de CO2, l’isolation du bâtiment, les ampoules LED. Avec quelques planches de bois brut, le supermarché maladroitement déguisé en cabane au Canada raconte que, ici, tout est nature. Et certifié « bio ».
Au fond du magasin, une pièce vitrée fait office de chambre froide. Juste en dehors poireautent oignons (hollandais), échalotes (françaises), patates douces (États-Unis/Espagne), pommes de terre Boni en promo (Italie), pommes de terre grenaille (Angleterre), avocat et gingembre (Pérou), ail (Espagne). Les carottes en vrac sont de Hollande et les carottes non lavées nous arrivent tout droit d’Espagne. Mais les framboises, les pommes, les poires, les concombres ou les navets sont belges. Comme les tomates, potirons, poivrons, piments, tomates cerises, salades, épinards, persil, jeunes oignons, concombres, haricots, navets, radis, courgettes, champignons, fenouil, céleris, aubergine, choux. Parmi les fournisseurs principaux de ces légumes se trouve EcoVeg, une société fondée en 2009 par Krist Hamerlinck et Cindy Declercq, et basée à la frontière belgo-hollandaise. Le chiffre d’affaires d’EcoVeg en 2016 se monte à 10 millions d’euros. La famille Hamerlinck détient également la société luxembourgeoise « Organic Farming Invest » qui possède une société au Mexique pour répondre à la demande du marché américain. Elle fournit donc les New-Yorkais en concombres bio, au bout d’un périple de 4 000 kilomètres.
Phare éthique
« Si la Wallonie est encore dans un modèle d’agriculture familiale à taille humaine, que ce soit en bio ou conventionnel, la Flandre s’inscrit plus dans une logique d’agriculture intensive », explique Pierre Wiliquet, porte-parole du ministre wallon de l’Agriculture René Collin (cdH). C’est d’ailleurs en Flandre qu’a grandi BelOrta, premier grossiste maraîcher d’Europe avec un demi-milliard de chiffre d’affaires. BelOrta développe aussi un BelOrta bio. « On arrive à un moment où les standardisateurs habituels de la conso entrent en action, estime Claude Gruffat (Biocoop). Le bio était une vision de société, une cohérence globale à laquelle on avait ajouté un règlement européen. Aujourd’hui, on n’a plus que le règlement européen. » Autrement dit : la seule contrainte obligatoire pour se dire « bio », c’est cette législation commune.
Même s’il reste un phare éthique dans la nuit de la consommation de masse, il est vrai que le bio européen a perdu de sa superbe. Il fait plus qu’interdire l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse. Il impose la rotation des cultures, mais autorise pour les produits transformés 5 % d’ingrédients non organiques et tolère une contamination OGM de 0,9 % au maximum. Quant aux engagements sociaux, le label n’assure aucun service après-vente. « On assiste à un effondrement des valeurs, à une concurrence déloyale d’un système à valeurs avec un système qui n’en a plus et dont la finalité n’est plus que la finance. En termes de valeurs d’agriculture, de commerce, tout cela est passé à la trappe », poursuit Claude Gruffat.
Les tomates, concombres, aubergines, courgettes d’EcoVeg se retrouvent dans les bacs de Bio-Planet, mais aussi dans les Delhaize et chez plusieurs clients d’Interbio. Autant dire potentiellement chez tout le monde. Car ce grossiste wallon livre entre autres Färm, Sequoia, Bi’OK, Bio Fagnes, Biocap, de nombreuses épiceries bio et fermes wallonnes qui complètent ainsi leur offre.
Färm sous influence ?
Parmi les acteurs de la distribution, Färm (six magasins à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve, bientôt sept) est un cas à part. Le projet pourrait incarner les craintes d’un secteur, effrayé d’être récupéré par des financiers dont la sincérité sera toujours remise en question. Färm, c’est d’abord l’histoire de Baptiste Bataille et Alexis Descampe. Les deux jeunes gars se rencontrent pendant leurs études de biologie, ne se quittent plus et lancent un petit magasin, The Peas, à Etterbeek (Bruxelles). Ils ont une idée noble de la vente. Du bio, du local. Respecter la santé, l’environnement, les gens.
Un de leurs clients, 30 ans et bobo à vélo, leur glisse sa carte de visite. Histoire de discuter « projets », et pourquoi pas développement. En plus grand. En très grand. En très très grand. Parce que le cycliste est dans les voitures. Il s’appelle Lionel Wauters. De la famille Moorkens, une des plus grosses fortunes de Belgique, basée sur l’importation, la distribution et la vente de voitures, dont Mitsubishi et Toyota. L’entreprise familiale s’appelle Alcopa, et c’est du lourd. Plus de 2 300 personnes dans 19 pays et un chiffre d’affaires de 1,7 milliard. Jusqu’en 2015, Lionel Wauters était membre du Conseil des actionnaires familiaux, appelé à porter la vision à long terme de la société automobile. Cet ingénieur-architecte est également CEO d’Urbani, une société patrimoniale immobilière, spécialisée dans les « biens immobiliers durables et conviviaux ». Elle loue plus de 160 appartements, essentiellement sur Bruxelles.
Les nouveaux partenaires ne traînent pas en chemin et discutent d’un changement d’échelle. « Nous ne voulons pas la croissance pour la croissance, mais pour avoir un vrai poids sur les enjeux sociétaux », explique le fondateur de Färm, Alexis Descampe. Mais, argent aidant, Lionel Wauters est devenu le président de Färm.coop en 2015. Dans ses bagages, il a emporté son oncle François Stoop et Olivier Van Cauwelaert, déjà partenaires dans Urbani et dans Scale Up, bras financier de projets durables (dont à présent Färm, et surtout Färm Louvain-la-Neuve, qui a coûté 750 000 euros à Scale Up). Scale Up vise pour ses actionnaires un objectif de retour financier de l’ordre de 7 % par an. Les trois hommes sont aujourd’hui dans le CA de Färm.coop et Alexis Descampe est devenu administrateur délégué.
Baptiste Bataille, lui, a été débarqué. Ce qui a choqué pas mal de monde dans le milieu bio. « C’était l’âme de Färm », nous explique un fournisseur. Âme aujourd’hui damnée qui n’a pas souhaité répondre à nos questions. « Derrière cette ‘peoplarité’ de Baptiste, alors que, nous, nous étions perçus comme les méchants, il y a surtout une modification de nos rôles avec Färm grandissant », explique Alexis Descampe. Pour expliquer le divorce, l’administrateur Olivier Van Cauwelaert évoque des aspirations différentes dans le développement de l’entreprise. « Imaginez qu’on aborde deux jeunes gars qui n’ont pas la trentaine, ont un magasin avec un million de chiffre d’affaires et six employés. Aujourd’hui, Färm, c’est six magasins et 100 employés. Le style de management a changé. On doit travailler plus en termes prospectifs, managériaux. Et c’est une évolution dans laquelle Baptiste ne s’est pas retrouvé. » Et les valeurs du bio, la réhumanisation des échanges autour du commerce, vont-elles s’y retrouver ? Car l’évolution est loin d’être terminée ! Färm prévoit d’ouvrir en Belgique 16 ou 17 magasins franchisés d’ici à 2020. Soit un tous les deux mois !
Bruxelles à la Färm
Le journal L’Écho annonçait, en novembre dernier, que la Région bruxelloise mettait 500 000 euros dans l’aventure Färm, via la Société régionale d’investissement de Bruxelles (SRIB), et entrait en tant qu’actionnaire principale dans la coopérative. De plus, les magasins ne sont qu’une facette du développement de Färm, qui entend également devenir producteur. L’idée ? Investir dans la transformation et la production pour avoir une plateforme bio complète. « Si on ne veut pas que ce soit les distributeurs classiques qui s’emparent du bio, on doit réagir, explique Olivier Van Cauwelaert, le représentant de Scale Up. Avec le bio industriel de Delhaize et Colruyt, il ne faut pas se voiler la face. Pour livrer des volumes pareils de carottes, ils commandent sur 100 hectares. Pour nous, les producteurs cultivent sur des surfaces entre un et 20 hectares, et en multiproduits. Ce sont des philosophies différentes. » Colruyt est donc déconsidéré par Färm, lui-même déconsidéré par les petits magasins bio.
Après les filières céréalière et bovine/porcine déjà en place, Olivier Van Cauwelaert annonce quatre nouvelles filières, soit des chaînes vertueuses de production où chaque maillon est certifié par Färm. Ce qui permet par ailleurs d’en contrôler le prix ou la provenance : légumes (avec 12 producteurs proches de Louvain-la-Neuve), les produits laitiers, l’oléagineux et la pisciculture. Le tout sera commercialisé sous une marque qui ne serait pas Färm, pour pouvoir être distribué par des tiers.
Plus que la qualité des produits bio de Färm, qui n’est pas remise en cause, le profil des investisseurs, leurs méthodes de management, l’éviction d’un fondateur et la volonté d’expansion rapide inquiètent des employés de la société. « Quand Baptiste a été viré, on a posé des questions, explique un travailleur. Lui était plus en lien avec nous, il portait la transparence. Les dirigeants jouent sur le fait que les employés s’engagent pour le bio. Ils nous disent ‘C’est vous le magasin’, parlent de ‘färmers’ plutôt que d’employés, de projet plutôt que d’entreprise. Tout le nouveau langage de management. Mais le rythme de travail est celui d’un supermarché et même plus. » Alors Färm, une entreprise comme les autres ? « Non, estime le travailleur. Il y a encore moyen d’avoir un contact direct avec Alexis. Des groupes de travail ont été mis en place. On nous parle d’intelligence collective. » Färm serait au milieu du gué. Et son personnel l’est tout autant. Alexis Descampe le concède : « Avec la croissance, on a connu un épisode de structure pyramidale, mais ce n’était tenable pour personne. » Depuis, des comités d’employés (où chacun est le bienvenu) sont mis en place pour débattre et gérer différents aspects de Färm, dont la gouvernance, l’expansion du projet Färm ou le référencement ou déréférencement de produits vendus (la Ginette a par exemple été « exclue » suite à son entrée dans le giron d’ABInBev). Färm parviendra-t-il à grandir sans trahir ? Et sans détruire toute la diversité de l’offre existante ? Les personnes interrogées dans le secteur « bio » voient ce développement d’un œil circonspect. Là où les dirigeants de Färm parlent de « coopération », les acteurs plus modestes entendent « récupération » et « standardisation ».
Chapeau de paille
Dans le match Bio-Planet vs Färm, être très petit permet d’éviter les coups. Mieux, les « petits » producteurs sont dragués par les nouveaux acteurs de la distribution. Ils ont, par exemple, « tous » sollicité Pia Monville, maraîchère bio de Court-Saint-Etienne : BioPlanet, Färm, e-Farmz, Sequoia.
Elle travaille en couple depuis huit ans sur trois hectares. Elle ressent un « bouillonnement » depuis peu. « Les clients ne savent plus trop. Ils étaient très fidélisés. Maintenant, un tiers de notre clientèle butine, le reste est fixe. Pour moi, ce sont les prémices d’une baisse. » Mais elle a refusé toute collaboration avec les nouveaux venus. « Si je perds une partie de ma valeur, je sais que je devrais augmenter ma production ou me spécialiser. Tout mon projet s’écroule. Je n’ai pas besoin qu’on m’aime. Je veux maîtriser la filière. Mais on veut surtout me mettre un chapeau de paille sur la tête pour faire leur promo… »
Ces collaborations, quand elles aboutissent, sont en effet généreusement mises en avant par les magasins partenaires, trop heureux d’afficher leur authenticité paysanne.
Pour Pia Monville, c’est évident. « On ressent que la distribution classique s’approprie le marketing, comme s’ils se déguisaient en nous ! Ils s’offrent notre image. » Le bio mainstream prendrait le beurre, l’argent du beurre et le salaire de la fermière. Au Biostory d’Ottignies, dix visages s’affichent sous la phrase « Nos producteurs locaux ont du talent. » « Leur barbecue pour rencontrer leurs producteurs, c’est en fait un barbecue avec les grossistes ! », avance Pia. De fait, sur les 10 visages, seuls trois d’entre eux sont des agriculteurs qui livrent directement Biostory. Parmi les autres, on trouve des grossistes, de Belgique ou de Grèce.
Côté Bio-Planet, on aime aussi mettre les producteurs belges en avant. Ils s’appellent Steven Lauwers, de Duffel (Herbio), ou Lies Heyns (Provamel) et s’étalent dans les pages du magazine ou sur le site de Bio-Planet. Le supermarché situe la société Provamel à Wevelgem, en Flandre occidentale. Mais le LinkedIn de cette sympathique productrice flamande Lies Heyns la qualifie plutôt de « Senior Divisional Strategic Buyer » chez Alpro. Cette société de transformation de produits à base de soja est en effet basée à Wevelgem (mais on doute que le soja soit belge) et affiche un chiffre d’affaires de 448 millions d’euros en 2016. Tout de suite moins champêtre.
La guerre de com est déséquilibrée. Mais il est possible pour un petit producteur de tirer sa paille de la botte de foin. « Nous parlons à nos clients de ce qui se passe sur le champ, explique Benoit Redant, de la ferme « As veyou l’porê ? » à Jallet (1,5 hectare de légumes bio). On a ouvert une page Facebook pour mettre régulièrement des photos de la vie de la ferme, des récoltes de patates avec le cheval. La ferme ouvre aussi ses portes tous les deux ans, ce qui est beaucoup de travail. Je devrais demander un subside pour la sensibilisation au bio ! » Résultat : 200 ménages viennent chaque semaine.
La Ruche qui chamboule tout !
Pour cette enquête, Médor a contacté une vingtaine de petits producteurs. Des maraîchers dans toute la Wallonie cultivant sur de petites surfaces (de 1 à 10 hectares). De cet échantillon aléatoire, des tendances se dégagent. Si les agriculteurs qui avaient misé sur la logique des « paniers » souffrent plus que les autres, le constat que le bio reste un projet porteur, aussi au niveau économique, est partagé. « Le prix de vente en bio reste plus élevé, ajoute Ariane Beaudelot de Biowallonie, une structure qui met en relation producteurs et filière de distribution. Les producteurs ont plus de marge, mais ce n’est pas le seul facteur. Les prix du bio restent élevés, car la demande dépasse toujours l’offre. »
Ce qui n’empêche pas de voir poindre l’inquiétude des années à venir. Que se passera-t-il si l’offre dépasse la demande ? Avec la venue des financiers « de l’ancien monde », des Lidl ou Colruyt, les travers de l’agriculture conventionnelle envahiront-ils le bio ? Une des clés pour les producteurs est de garder la maîtrise de la fixation du prix, de la commercialisation de leur produit, afin d’avoir un pouvoir par rapport aux distributeurs. Voire de s’en passer.
S’organiser en coopérative est une réponse. Passer par des plateformes en est une autre, une solution dopée par la technologie web, qui promet la mise en contact de producteurs et consommateurs en un seul clic.
C’est sur ce créneau que surfe la Ruche qui dit oui !, lancée en Belgique en 2013. Cette start-up française à l’essor fulgurant, forte d’un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros annuels, compte 102 « ruches » chez nous (pour 5 millions d’euros de ventes par an). Le principe est simple : n’importe quelle « abeille » peut décider d’ouvrir une ruche, à savoir tenter de réunir des consommateurs et des producteurs, les uns désireux de consommer local (pas forcément bio), les autres désireux d’écouler leurs denrées. Tout ce petit monde se retrouve ensuite physiquement, pour procéder à l’échange, dans une ambiance conviviale. Un peu comme sur Airbnb ou BlaBlaCar, le site s’occupe de la plateforme de paiement, propose un site et une com très efficaces. Et ponctionne 8,35 % de la transaction. Le gestionnaire de la ruche, lui, empoche aussi 8,35 % pour service rendu. Pour des petits producteurs, qui peinent à élargir leur clientèle ou qui n’ont pas les moyens financiers d’investir dans un outil web, c’est un très bon plan. Pour les consommateurs désireux de tester les valeurs du « circuit court », c’est aussi tentant. Car sans engagement. Mais c’est là que la limite se pose.
Avec ce système, le principe qui prime, c’est la « liberté » et son corollaire : l’absence de règles. Une charte tripartite des bonnes pratiques existe, mais n’a pas de force légale. Ce que nous confirme Hannes Van den Eeckhout, responsable Belgique de la société : « On n’a pas envie de donner un cadre légal. On mise sur l’autocontrôle et nous intervenons comme médiateurs en cas de conflits, et dans 90 % des cas ça fonctionne. » La société précise bien qu’elle n’agit pas comme un intermédiaire mais comme un prestataire de services. Autre bémol : les abeilles qui lancent les ruches s’engagent de façon quasi bénévole dans un travail qui leur prend « au moins 10 heures par vente », selon les abeilles contactées. Elles doivent assurer la com, la venue des producteurs comme des consommateurs, gérer les questions d’assurance et de statut professionnel, et même trouver les locaux qui accueilleront la vente.
Tout cela n’est pas « caché » par la boîte, qui ne prétend pas offrir des « emplois » aux abeilles. Mais en France, quelques producteurs locaux avaient hurlé au loup en 2014, les qualifiant de « frelons parisiens ». Leur critique : « Ce sont des opportunistes. L’objectif, c’est de surfer sur une demande en faisant travailler des gens avec un statut précaire, sans les employer. La Ruche qui dit oui ! prend une marge alors que ce sont les agriculteurs et les responsables de ruches qui font le travail. Ce n’est rien d’autre que le “UberPop de l’agriculture”. » Une « polémique » certes retombée, mais qui achève de montrer que le secteur du « consommer mieux », en quittant le marché de niche pour la massification, a bien du mal à faire tenir ensemble toutes ses valeurs d’origine.