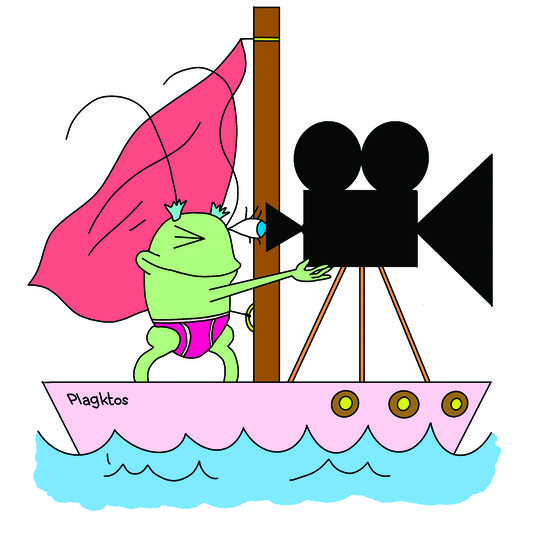Le lien au monde
Mark Hunyadi

Dans le « Livre de la Jungle » version Disney, le serpent Kaa chante « Aie confiansssse » au jeune Mowgli. Facile à dire ! Perte de confiance dans la justice, le gouvernement, les médias, le vaccin. Jamais notre époque n’a semblé aussi démunie de ce sentiment. La confiance n’existerait plus… « Faux ! », rétorque Mark Hunyadi. Le philosophe, également professeur à l’UCL, vient de publier un livre sur la confiance tant de fois convoquée, si rarement expliquée (« Au début est la confiance », éditions Le Bord de l’eau). Conclusion ? Épargne-nous tes grands yeux hypnotiques, Kaa ! Ce n’est pas la peine. La confiance est partout, elle est l’expérience mère du monde, celle qui nous relie dès que nous posons le moindre acte.
Quand Médor précise au philosophe qu’il ne pourra pas relire l’interview, il regrette. « Mais allons-y. » En toute confiance.
Médor On a l’impression d’être dans une société où la confiance ne cesse de s’éroder. Et vous nous dites qu’elle est… partout.
Marc Hunyadi On ne peut pas parler d’une crise de confiance en général. C’est un slogan impropre, mal pensé, mal conceptualisé. La confiance est un rapport élémentaire au monde, ce dans quoi nous séjournons. S’il y a déficit, il ne peut être que partiel. On peut avoir moins confiance dans un gouvernement pour lutter contre la pandémie, par exemple, mais dire que « le citoyen n’a plus confiance dans le politique » est une extrapolation abusive. On peut citer quelques exemples paradoxaux. On critique l’hôpital, mais si on est malade, on file aux urgences. On critique les Big Pharmas à propos des vaccins, mais on prend un médicament à la première douleur. Il y a une illusion d’optique. Dès que l’on met en cause le singulier, on a tendance à extrapoler vers le général. Des enquêtes comme la « World Value Survey » (une étude internationale sur l’évolution des valeurs, NDLR) montrent une baisse tendancielle de la confiance, mais je n’y crois pas une seconde. Ces enquêtes disent bien quelque chose, mais elles ne mesurent que le jugement. Ce sont plutôt des enquêtes sur l’optimisme des gens.
M. Vous avez l’impression qu’il y a beaucoup de confusion autour de la confiance ?
M.H. Sans arrêt. La confiance est un concept disparate, comme le temps pour saint Augustin qui disait « je sais ce qu’est le temps, mais, si on me demande de l’expliquer, je ne peux pas ». La confiance, on la pense intérêt, calcul, croyance, fiabilité, sécurité. Ce n’est pas cela.
M. Pour le sociologue allemand Niklas Luhmann, la confiance permet de réduire la complexité du monde. Puisque nous ne pouvons maîtriser tous les enjeux qui nous sont soumis, nous déléguons une forme de connaissance vers des relais. Une manière de simplifier notre réel.
M.H. Cet aspect peut expliquer la fonction de la confiance au niveau social. Elle fluidifie les choses. Je suis d’accord avec cela, mais cela ne définit pas la confiance.
M. Et c’est quoi alors ?
M.H. La confiance est une action. Ensuite, elle est un pari sur des attentes de comportements. Ce n’est pas un savoir ou un calcul. Quand un enfant a confiance dans ses parents, il ne calcule pas leur comportement futur.
M. Vous écrivez que, malgré l’incertitude, nous faisons tout le temps preuve de confiance, même envers les objets. Inconsciemment, nous faisons confiance à l’échelle en montant dessus, par exemple. La confiance est permanente et le confinement le démontrerait par l’absurde, c’est ça ?
M.H. Avec le confinement, ce qui a été suspendu par les mesures d’hygiène, de contact, c’est ce rapport fiduciaire, donc de confiance au monde. Tout d’un coup, il devenait suspect. Mais cela montre bien qu’en temps normal, on a spontanément confiance. Celle-ci est notre relation fondamentale, sans que ce soit pensé. Et c’est une vision pratique, en action. Mon exemple favori est la conduite automobile. Quand on croise quelqu’un en voiture, la confiance n’est pas de croire qu’il va poursuivre sa route, la confiance est de poser un acte et de le croiser.
M. Ce pari dans l’action constitue un défi essentiel à l’occasion de la vaccination contre le coronavirus, par exemple.
M.H. Oui. L’exemple du vaccin est parfait. On y voit les deux grands moments de la confiance. D’abord tout ce qui nous motive ou nous décourage de nous faire vacciner. Les discours politiques, scientifiques, des proches. Cet ensemble antérieur à l’action construit un jugement, qui peut être rationnel ou pas. Ensuite vient la confiance dans le vaccin, qui sera l’acte de se faire vacciner. Les deux temps sont distincts. Un ensemble de croyances ne m’engage à rien, cet ensemble se convertit en confiance uniquement par l’action. C’est la distinction spécifique de la langue française entre « avoir confiance » et « faire confiance ». La pensée sans acte est ce que l’on appelle en philosophie une pure disposition à agir. Le « faire confiance » est une action.
M. Une institution peut-elle susciter, gagner, générer la confiance ?
M.H. La confiance dans une institution au sens large, le gouvernement ou la monnaie, se mesure à la hauteur des attentes de comportements qu’elle est capable de générer. Ces attentes sont fixées par des règles publiques. De la police par exemple, on attend d’être protégé, et qu’elle protège tout le monde.
M. Il y aurait une quelconque utilité d’intégrer un ou une philosophe dans une plateforme fédérale de gestion de la crise sanitaire ?
M.H. Absolument.
M. Si c’était vous, qu’apporteriez-vous ?
M.H. D’abord, j’adopterais une position permettant d’envisager les problèmes sous un autre angle que strictement technique ou à court terme. Créer la confiance est un phénomène complexe. En l’occurrence, j’insisterais sur la confiance de proximité. Typiquement dans son médecin de famille, par exemple. En France, je suis également engagé dans les enjeux de vaccination et je prône la thèse selon laquelle le médecin généraliste doit être partie prenante de la politique de vaccination. La proximité est très importante, plus que tous les arguments rationnels. Si votre médecin s’est fait vacciner lui-même et vous recommande le vaccin, vous aurez tendance à le croire. Vous êtes alors motivé à agir, donc à vous faire vacciner. Au final, comme en amour, il n’y a de preuves que par l’acte, mais il faut créer les conditions de la confiance.
M. Vous écrivez que l’individualisme contemporain aboutit avec le numérique à la représentation de l’individu qui vit dans un cockpit, sécurisé, gérant sa vie seul à travers des écrans. C’est embêtant pour dégager une solution collective…
M.H. L’enjeu autour du vaccin oblige à adopter un point de vue collectif, à sortir de ce cockpit. Nous ne pouvons pas faire un simple calcul coût/bénéfices pour soi. Ce n’est pas le bon point de vue. Un vaccin n’a de sens que collectivement. Il faut sortir du « je » pour adopter le point de vue du « nous ». La communication politique aurait dû insister sur l’enjeu collectif de la vaccination, et non sur les intérêts de chacun de se faire vacciner. Montrer qu’il ne fallait pas se limiter aux simples spéculations individuelles. Le vaccin est d’ailleurs un objet étrange. Il nécessite un engagement individuel, une décision forte, très intrusive, avec un produit que l’on s’injecte, mais au nom de la collectivité ! C’est très intéressant philosophiquement et politiquement. Il nous oblige à sortir du cockpit, ce qui est si difficile pour l’individu contemporain qui est calé dedans. Le numérique nous y enferme par nature. Le public des GAFA1 est extraordinairement individualisé. Ces sociétés cherchent notre profil individuel, et nous y enferment.
M. Et elles connaissent nos attentes.
M.H. Ce qui compte à leurs yeux est la certitude de votre comportement futur. Elles accumulent les informations sur vous, ce que Shoshana Zuboff (sociologue américaine qui a théorisé l’idée de « capitalisme de surveillance », basée sur ce que les big datas récoltent sur nous, NDLR) appelle le « surplus comportemental ». Soit les informations que vous n’avez pas données explicitement. Exemple : si vous jouez aux cartes sur internet, elles savent quel type de joueur vous êtes – prudent, rapide, futé. Ces informations, combinées avec vos goûts de chaussures, de livres ou que sais-je, les GAFA les convertissent en certitudes. Vous avez l’impression que Google, Amazon et consorts répondent à vos attentes. Celles-ci sont satisfaites, mais ce système élimine tout le processus de confiance, et donc de pari. Il automatise le désir. Votre comportement est de moins en moins réflexif. Et c’est confortable, agréable. C’est là le danger ultime du numérique, on contourne les processus de pari, d’hésitation, de confiance, d’erreur.
M. Vous pouvez donner un exemple ?
M.H. Imaginez votre arrivée dans une ville inconnue. Vous cherchez une adresse, vous demandez votre chemin. Il y a un risque d’être mal aiguillé parce que la personne sollicitée est prise au dépourvu, ne connaît pas le nom des rues, n’a pas le sens de l’orientation. Il y a là une dimension exploratoire. Mais, avec le GPS, ce risque est réduit à zéro. Tout le modèle d’affaires des GAFA est basé là-dessus. Éliminer le pari, la dimension exploratoire du monde. Ils ne cherchent pas la confiance, ils la contournent et cherchent la sécurité.
M. En même temps, vous le dites, j’ai envie de l’efficacité redoutable du GPS. Je ne vais pas m’en passer.
M.H. Le GPS est une formidable création de l’esprit humain avec une somme d’intelligence admirable ! Mais c’est une question de seuil. Le problème est que cette sécurisation du désir, ce modèle consistant à aller de A à B, se généralise à toutes nos activités. Y compris le choix d’un partenaire sexuel. La nourriture, l’habillement, les loisirs, les vacances, tout devient piloté par le système. De plus, nous vivons une révolution anthropologique : c’est la première fois dans l’histoire de la technique et de l’humanité que nous sommes en position d’obéir à des machines dans tous les domaines de notre existence.

M. Ce n’est pas les machines qui nous obéissent ?
M.H. Au niveau du numérique, on doit sans cesse répondre à une offre. Le caractère pernicieux de la chose est que cette offre nous correspond. On nous propose une quantité de choses. Et c’est encore mieux qu’au supermarché car le choix est profilé pour nous. Le tout est très satisfaisant, mais nous devons nécessairement nous conformer au système, accepter sa rationalité pour réaliser notre volonté. Le problème, c’est qu’on ne maîtrise pas les paramètres de ce système. Ceux-ci sont conçus pour servir le système. Nous ne sommes que l’appât.
M. C’est la double finalité que vous mentionnez. Pour la première fois, à l’inverse du marteau ou de la machine, l’outil nous sert et sert à autre chose. Collecter et vendre nos données.
M.H. Oui. Et j’insiste sur le fait qu’on est obligés de reproduire le système si on veut être au monde. Par exemple à l’université, il n’y a plus d’accès sans le numérique. L’inscription au cursus, aux examens, aux cours, passe par un écran. Et si vous ne parvenez pas à cocher la petite case nécessaire d’un formulaire, vous ne pourrez pas tourner la page. Comme avec un distributeur d’argent. Si vous ne suivez pas la procédure que vous impose la machine, si vous ne lui obéissez pas, vous n’aurez pas votre argent. Il n’y a plus de raison libre, subjective. Est rationnel celui qui se conforme au système.
M. N’est-ce pas inhérent à tout outil ? Pour envoyer une lettre, je dois me plier aux formats, au fait de mettre un timbre, etc.
M.H. Oui, vous devez vous conformer à l’outil. Marx le signifiait déjà : quand vous utilisez un outil, vous ne faites pas que transformer le monde. Vous vous transformez vous-même. Vous devenez un être capable d’utiliser cet outil. Mais deux points sont à souligner dans le numérique : son incroyable généralisation et la substitution progressive des relations naturelles au monde par la technique. L’écran s’interpose et donne le cadre. Peut-être que la prochaine génération pensera que l’école est sur Zoom, via un écran paramétré par d’autres.
M. Cette vie dans le cockpit est selon vous l’aboutissement de l’individualisme contemporain, et, en même temps, c’est une illusion. Il nous est impossible de ne pas être lié au monde par la confiance.
M.H. Oui. La représentation moderne, selon laquelle la volonté est souveraine, est fausse. On dépend du monde. Pour n’importe laquelle de nos interactions, nous devons tenir compte des attentes de comportements de ce sur quoi porte notre action – objets, personnes ou institutions. Si je monte sur l’échelle, c’est que je m’attends à ce qu’elle me soutienne. En montant, je parie donc qu’elle le fera. C’est un acte de confiance. Accomplir ma volonté dépend donc intrinsèquement d’autre chose que de ma volonté. Mais l’individu contemporain oublie cette confiance, pour introniser la volonté souveraine. Il a tendance à penser que tout dépend de lui et de lui seul. Cette représentation occulte la dépendance de la volonté à ce qui… n’est en rien contrôlé par la volonté ! À savoir ici la résistance de l’échelle.
M. Votre approche philosophique est aussi un regard politique.
M.H. Je peux développer, mais oui (rires). Dans cette vision de cockpit que partagent les libéraux et les ultralibéraux, ils sous-estiment ce qu’ils doivent au monde pour leur réussite. Ils minimisent systématiquement leur dépendance à l’égard du monde, et ne valorisent que les relations de contrat. Les libéraux aiment les contrats, parce qu’ils sont un acte de la volonté souveraine. Mais ils oublient ce qu’un contrat lui-même doit au contexte dont il dépend : la sécurité juridique, les infrastructures publiques, l’éducation. Les riches de nos sociétés oublient ce dont leur richesse même dépend. Le problème, c’est que cette représentation du cockpit marche. Le nanti n’a pas besoin de savoir ce qu’il doit au contexte ! Une représentation fausse peut fonctionner. Au niveau international, même valorisation du contrat : voyez Trump, qui dénonçait tous les accords multilatéraux contraignants, pour imposer des contrats bilatéraux qui favorisent ses intérêts, sa volonté souveraine.
M. À quoi doit-on s’attendre, dans un monde où la confiance serait remplacée par la sécurité ?
M.H. Le scénario que je prévois, c’est le modèle du fitness. De la même manière que, dans notre société sédentaire, on paie pour courir sur place, on va payer pour se faire confiance entre les humains. On paiera deux heures pour faire des exercices où l’on dépend les uns des autres. Se tenir pour ne pas tomber, que sais-je ? Un fitness de la confiance. Cela va devenir un marché, c’est à moitié une plaisanterie, à moitié vrai, je pense que c’est un scénario tout à fait plausible…

M. C’est déjà le cas avec les team buildings des entreprises où l’on construit de la confiance, des liens. Via les coachs, n’est-ce pas la nécessité de réapprendre à être en relation au monde ? À être en confiance ?
M.H. Il n’y a rien qui m’énerve plus que les coachs. Ils participent à la standardisation et à l’automatisation des comportements. C’est la même représentation qui anime le numérique : il faut bien faire, il faut être normé. Nous devons nous conformer pour participer à des entretiens d’embauche, pour manager une équipe, pour être en forme physique, comme si la vie était un vaste mode d’emploi. Quand on se fait coacher, c’est pour être conforme aux attentes de comportements. Ce n’est plus une liberté subjective qui s’épanouit. C’est une liberté qui est capable de se conformer aux normes du système. Pour montrer à quel point on est pris dans ce mouvement, je prends souvent en exemple Jean-Jacques Rousseau et ce chef-d’œuvre de la littérature française que sont « Les rêveries du promeneur solitaire ». Sur l’île Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne, en Suisse, Rousseau explique avoir passé les trois semaines les plus heureuses de sa vie parce qu’il a rêvassé. Il se baladait sans aucun but, sa subjectivité était totalement libre et détachée de toute attente de comportement qui lui aurait été imposée de l’extérieur. C’est l’expérience d’une subjectivité épanouie, exploratrice du monde. Ça, c’est devenu un comportement complètement irrationnel aujourd’hui. On ne peut pas rêver sur sa place de travail. Même dans la rue, c’est difficile de rêvasser. On se fait bousculer. Il faut aller plus vite. Mais voilà, par contraste, ce qui nous est demandé par le système, ce n’est pas du tout de rêver. C’est de nous conformer à des paramètres que nous ne maîtrisons pas et qui nous sont imposés.
M. Pourtant, on recherche ces moments, cette relation au monde.
M.H. C’est pour cela qu’on paiera pour l’avoir…
M. En ouvrant votre ouvrage, on est traversé par une vague d’optimisme parce que la confiance est partout, mais on le referme avec une impression pessimiste, car le numérique exacerbe notre isolement. Alors ? On balance de quel côté ?
M.H. Optimisme et pessimisme ne sont pas de bons critères en philosophie, mais je vais quand même répondre à la question (rires) en partant du titre de mon livre, « Au début est la confiance ». « Est ». Pas « était ». Pourquoi ? Parce que la confiance est quelque chose que l’on ne peut pas perdre puisqu’elle nous relie de manière constitutive au monde. Mais c’est vrai que des forces très puissantes érodent, occultent, contournent, évitent les relations de confiance au profit d’un transfert massif vers le numérique. Vers le GPS.
M. Mais à quoi ressemblerait une société qui se passe de confiance ?
M.H. À une société mise en pilote automatique, où chacun exécute sa volonté coordonnée par le système. L’aspect « optimiste », c’est que cela ne peut pas arriver intégralement. Tout ce qui est non numérisable, tout le rapport à soi-même, nos joies, nos peines, le plaisir de danser, de fumer, demeurent. La confiance, c’est un rapport d’esprit au monde. Nous ne pouvons pas l’éliminer – sauf à devenir des robots.
-
Pour qui voudrait tenter l’expérience de ces rêveries, le texte est disponible facilement sur le web.
↩