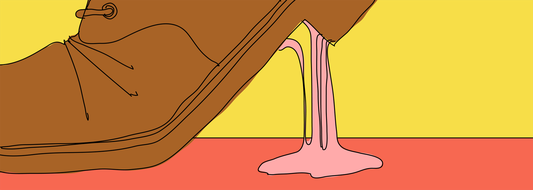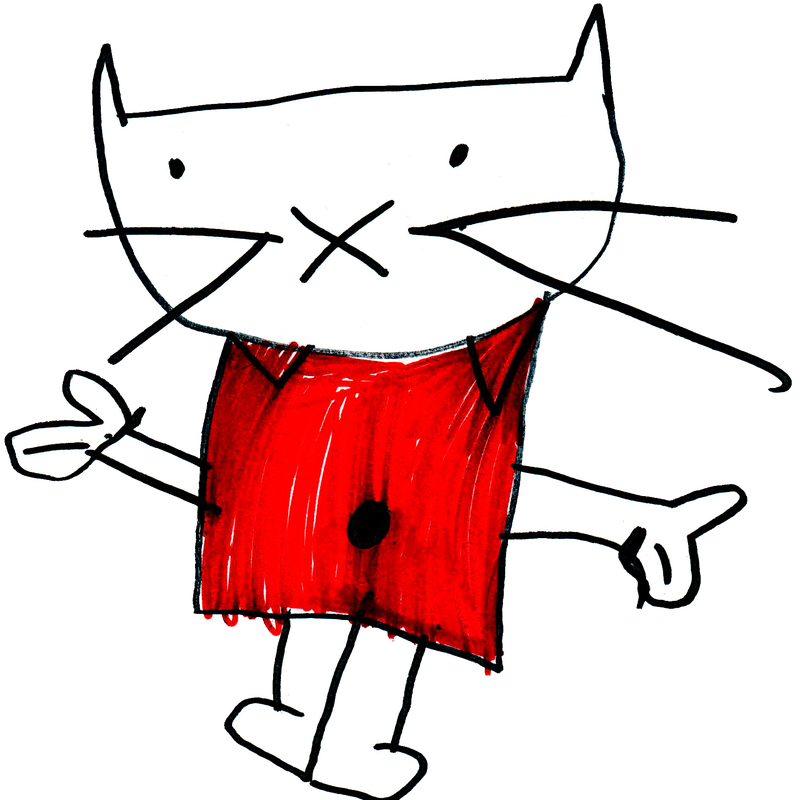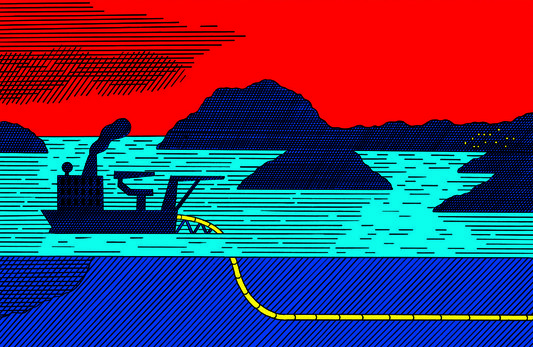Les familles « corn flakes » ont éclaté
Entretien avec Laura Merla, sociologue de la famille
Interview (CC BY-NC-ND) : Céline Gautier & Chloé Andries
Illustrations (CC BY-NC-ND) : Yoann Van Parys
Publié le
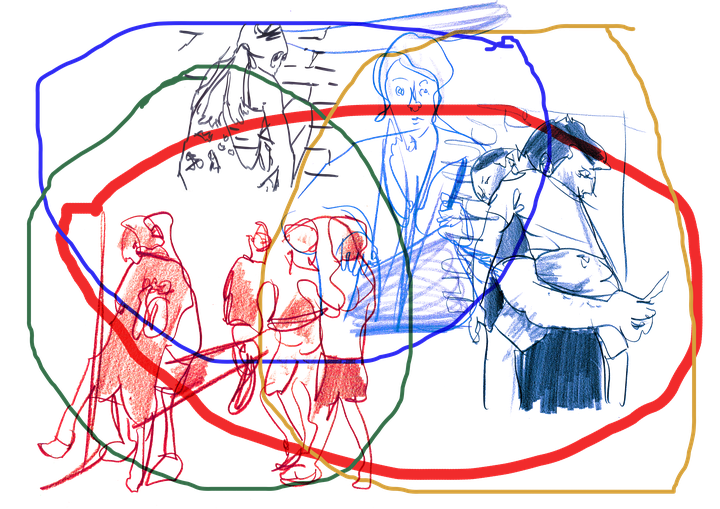
Il y a la famille « corn flakes » (papa, maman et enfants blonds) et puis toutes les autres, aussi variées que les menus de petit déjeuner. C’est à ces nouveaux modèles que s’intéresse Laura Merla, sociologue de la famille. Avec le projet MobileKids, elle se penche sur les enfants super-mobiles, qui vivent dans plusieurs foyers.
Elle nous prévient d’emblée. « J’ai beaucoup de mal avec les auteurs qui prennent une page pour décrire un concept, qui sont jargonnants pour le plaisir de l’être. » Son truc, à elle, c’est l’approche anglo-saxonne, plus concrète, plus « ancrée dans les pratiques » que sa cousine française.
Quand on lui demande quel est son parcours, Laura Merla n’évoque pas de passion dévorante pour la prose bourdieusienne ; elle se raconte par Anderlecht. « Je suis née dans une famille mixte, italo-belge, dans un milieu modeste. C’est important de le dire ! Je suis la première à avoir fait des études universitaires. » Et pas qu’un peu : Sciences Po et master en droit et sociologie du travail à l’ULB, thèse sur les pères au foyer, recherches postdoctorales en Australie. Jusqu’à l’année dernière, elle dirigeait le Centre de recherches sur les familles et les sexualités (CIRFASE) à l’Université catholique de Louvain. Un lieu unique dans une Belgique francophone où l’on étudie peu le sexe et les familles, alors qu’ailleurs, c’est une branche majeure de la sociologie. Comme il y a « catholique » et « sexualités » dans la même phrase, Laura Merla se sent obligée de préciser qu’il y a au CIRFASE une grande ouverture sur « toutes les formes de familles ».
Après avoir étudié le maintien des liens familiaux dans les familles transnationales (dont une partie a migré, l’autre pas), elle s’intéresse aujourd’hui aux enfants qui vivent en hébergement alterné – attention, on ne dit plus « garde » car « ce ne sont pas des moutons ». Plein de bonnes raisons pour l’interroger sur les mutations de ces familles qui ont quitté le troupeau. Un entretien garanti sans jargon.
Médor : Vous n’aimez pas les moutons. Qui est votre idole en sociologie de la famille ?
L.M. L’une des sociologues que je préfère, c’est Raewyn Connell, qui étudie les masculinités à Sydney. Elle était dans mon jury de thèse. D’ailleurs, au départ, elle s’appelait Robert Connell. J’avais un souci parce que mon jury n’était pas paritaire… Mais Robert est devenue Raewyn et mon problème de parité était réglé ! Elle est la première à avoir mis le mot « masculinités » au pluriel, dans les années 90. À cette époque, il y avait un boom des « études de genre », qui étaient en fait des « études de femmes ». C’était légitime car les femmes étaient invisibles, tant dans la recherche que comme objet d’étude. Si on travaillait sur l’immigration, c’était d’office l’immigration masculine. Le masculin était considéré comme le neutre universel.
Médor : Qu’est-ce qui était neuf dans l’approche de Connell ?
L.M.Elle a montré que différents types de masculinités coexistent. La masculinité hégémonique, le modèle qui occupe une position dominante à un moment donné, n’est pas incarnée par tous les hommes. Et peu d’hommes l’incarnent complètement car elle contient des éléments contradictoires : par exemple un côté technique et rationnel, et un côté bestial et viril. Les différentes masculinités sont liées à des sous-cultures : la masculinité noire du Bronx n’est pas la même que celle des banlieues françaises, celle des avocats n’est pas celle des journalistes, etc. Il peut y avoir des rapports de domination entre elles, par exemple envers la masculinité gay.
Médor Vous aimez étudier les contre-modèles. L’étude « MobileKids » que vous dirigez s’intéresse aux « enfants du divorce »… Avec quel regard ?
L.M. L’approche majoritaire avec le divorce, c’est celle du bien-être : qu’est-ce qui est bon ou pas bon, quelles sont les conséquences négatives sur les enfants ? C’est important, mais ce n’est pas l’approche que nous avons adoptée. Nous partons du constat que cette situation existe : des enfants grandissent dans plusieurs familles en même temps. Et nous observons ce que ça change. Nous nous demandons si cela ne leur donne pas des compétences, dans un monde où l’on nous demande à tous d’être mobiles. Peut-être que, plus tard, quand ils devront changer de boulot ou travailler dans des lieux différents, ils auront acquis ce que l’on appelle un « capital de mobilité ». L’idée est de donner la parole aux enfants.
Médor : Vous ne voulez pas vous positionner sur ce qui est préférable comme situation ?
L.M. Non, car ce serait me positionner comme psy et plus comme sociologue ! De plus, se positionner sur ce terrain, c’est comme si on considérait la famille nucléaire (le couple père-mère + enfants) comme la norme non problématique et que les autres modèles étaient dysfonctionnels. Or, ce n’est pas du tout le fait d’être une famille nucléaire qui va faire que la famille sera saine ou heureuse.
Médor : En revanche, les familles séparées sont économiquement plus fragiles.
L.M.Oui. Le divorce amène un appauvrissement, toutes configurations confondues. Car même quand on se remet en couple, si les deux membres du couple ont déjà des enfants, ça peut devenir compliqué. Aujourd’hui, on assiste à deux évolutions : la réduction de la taille des ménages, liée à l’augmentation des personnes isolées, et une augmentation statistique des familles nombreuses, liée notamment aux familles recomposées.
Médor : Comment se déroule l’enquête MobileKids ?
L.M. C’est une étude qualitative internationale de cinq ans (on en est à la moitié) sur les enfants qui bougent d’un foyer à l’autre. Un volet cherche par ailleurs à voir si les politiques publiques sont adaptées aux réalités (qui touche les allocations familiales ? qui prend un congé parental ? etc.) et à faire des recommandations, en collaboration avec COFACE (défense des familles au niveau européen). Enfin, on cherche à comprendre quels sont les types de familles qui ont recours à l’hébergement alterné. On vient de faire une étude sur les ados pour cartographier, notamment, les questions d’hébergement.
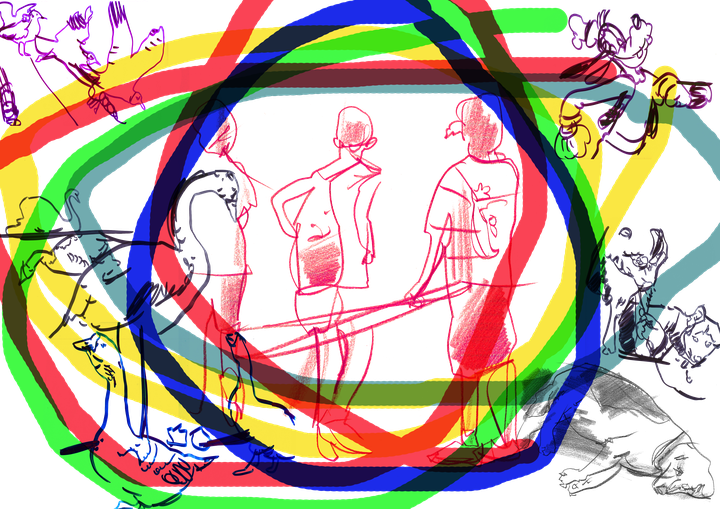
Médor : Qu’est-ce qui ressort de cette étude ?
L.M. Les chiffres montrent que, sur 1 600 jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles, 60 % vivent dans une famille nucléaire et 40 % dans d’autres formes familiales. Il y a une « mobilité » dans le sens où, au cours d’une vie, on passe d’une forme familiale à une autre. Parmi les enfants de couples séparés, 4/10 sont en hébergement exclusif chez la mère – ça reste le modèle dominant, 3/10 en alterné (minimum 30 et 70 % du temps passé chez l’un ou l’autre parent), moins de 2/10 en principal chez la mère (plus de 70 % du temps chez la mère) et 1/10 en exclusif chez le père.
Médor : Y a-t-il un lien entre l’hébergement alterné et le niveau de revenus ? Est-ce un choix de riches ?
L.M. Oui. Les premières familles à mettre en place ce type d’hébergement sont les familles qui ont les moyens d’accommoder deux lieux de vie pour leurs enfants. C’est un phénomène de classes moyennes supérieures plutôt éduquées. Mais on voit que la pratique commence à traverser les frontières des catégories sociales, malgré la question des moyens financiers. Reste cette injonction normative qui perdure : on considère qu’avoir sa propre chambre est un droit et une nécessité pour un enfant. C’est pourtant une construction sociale.
Médor : Vous avez interrogé les ados sur les disputes de leurs parents. Y a-t-il des familles plus conflictuelles que d’autres ?
L.M. Non. On voit qu’il y a des familles conflictuelles dans toutes les configurations familiales, même chez les « parents ensemble ». Les parents séparés ne se disputent pas plus que les autres.
Médor : Qu’en déduire ?
L.M. On peut y voir un signe alarmant : il existe des conflits dans toutes les familles. On peut aussi interpréter cette présence de conflits comme le signe que l’autorité familiale est partagée de façon plus démocratique qu’avant. Les décisions font désormais l’objet de discussions, de négociations entre les parents… et donc possiblement de conflits.
Médor : Qu’avez-vous observé sur le vécu des enfants en hébergement alterné ?
L.M. On observe chez les enfants d’âge scolaire qu’ils peuvent développer un sens du « chez-soi » qui intègre deux lieux de vie. Certains jeunes vont voir leurs deux foyers comme un tout, ou au contraire comme deux lieux étanches, mais dans lesquels le passage de l’un à l’autre n’est pas problématique. On avait le cas d’un papa plongé dans la transition écologique et l’éducation non genrée, et d’une maman pas du tout là-dedans. Les deux univers familiaux étaient à ce point différents que les institutrices pouvaient deviner si les enfants étaient, cette semaine-là, chez leur papa ou leur maman. Mais le passage d’un modèle à l’autre ne posait pas de problème. En grandissant, l’enfant choisit.
Médor : Cela leur demande une certaine souplesse, quand même…
L.M. Oui. Ils développent ce qu’on appelle de « l’agentivité », une faculté de façonner leur quotidien. Par exemple, un jeune nous expliquait que son père vivait loin de l’école et qu’il devait se lever à 6 h 30, alors que sa mère vit tout près et qu’il peut se lever une heure plus tard quand il est chez elle. Mais il a décidé de se lever tous les jours à 6 h 30, où qu’il soit, pour préserver son biorythme.
Médor : En Belgique, l’hébergement égalitaire est encouragé par la loi…
L.M. Oui, cela fait 12 ans que la Belgique a légiféré sur cette question. La loi ne pousse pas à l’hébergement égalitaire mais dit que, si un des deux parents en fait la demande, il faut en examiner l’opportunité et l’accorder si cela est possible.
Médor : Cette loi a-t-elle eu un impact ?
L.M. Oui, considérable. Dans les statistiques, le nombre d’hébergements alternés a explosé à partir de 2006. La loi a eu un rôle précurseur. À l’époque, c’était une pratique marginale. Aujourd’hui, cela concerne environ un tiers des familles séparées.
Médor : Dans quel contexte cette loi est-elle née ?
L.M. En 2004, la Belgique a réuni les États généraux des familles, en mettant tous les acteurs autour de la table, pour réfléchir aux enjeux des mutations familiales et voir comment adapter le cadre légal. Ces États généraux ont permis de déconflictualiser le débat, contrairement à la France par exemple, où le débat est encore très tendu.
Médor : Qu’est-ce qui a motivé la rédaction de cette loi ?
L.M. Au départ, cette loi a été portée par des préoccupations d’égalité hommes-femmes. La demande venait d’abord de pères qui souhaitaient rester reconnus et impliqués dans l’éducation des enfants, au moment de la séparation. Jusque-là, dans les décisions de justice, l’hébergement était quasiment exclusivement octroyé aux mamans.
Médor : Aujourd’hui, tout le monde est-il d’accord de privilégier la garde alternée ?
L.M. Il y a toujours des débats tendus, dans lesquels on entend surtout les groupes les plus extrêmes. Certains pères considèrent que si l’on refuse l’hébergement égalitaire, c’est un retournement de la domination. Ils invoquent parfois des arguments tendancieux comme de dire que les femmes inventent des violences qui n’existent pas. Il y a aussi des groupes de féministes qui s’opposent à l’hébergement alterné car c’est une manière pour des hommes violents de garder le pouvoir sur leur ex-conjointe. C’est une vraie problématique mais qui se joue dans toutes les formes de familles…
Médor : Il y a aussi l’argument, défendu par certaines féministes, qu’il faut refuser l’hébergement égalitaire aux pères qui n’étaient pas impliqués avant la séparation…
L.M. C’est une approche extrêmement figeante, qui prive les personnes de la capacité d’évoluer. J’ai travaillé sur les pères au foyer. J’en ai observé certains qui paniquaient totalement les premiers mois, ne savaient pas gérer la préparation du cartable, mais qui se sont peu à peu adaptés. Si l’on veut une plus grande égalité, il faut permettre aux femmes d’entrer dans les sphères traditionnellement masculines mais aussi permettre aux hommes d’entrer dans les sphères plus féminines. Heureusement, la logique des cours et tribunaux, c’est celle du cas par cas. Il y a peu de critères exclusifs.
Médor : Qu’observe-t-on comme types de comportements chez les pères qui ont la garde exclusive ?
L.M. Ils ont des comportements à bien des égards similaires à celui des mères gardiennes exclusives. Autrement dit, c’est le fait d’être le parent gardien (homme ou femme) qui semble déterminant sur les comportements vis-à-vis de l’enfant, et non le genre du parent. C’est donc bien la preuve que les fonctions parentales ne sont pas de l’ordre de l’inné mais de l’acquis.
Médor : Le droit et les politiques doivent sans cesse s’adapter aux nouvelles formes familiales…
L.M. Clairement. Depuis deux ou trois ans, par exemple, les familles peuvent enregistrer deux résidences à la commune. C’est un bouleversement ! Pour l’inscription à l’école notamment, on peut aujourd’hui choisir une école dans la commune de résidence du père ou de la mère. Pas mal de choses ont été faites aussi sur le statut du beau-parent. Ce dernier peut-il continuer à avoir des droits par rapport à ses beaux-enfants quand le couple se sépare ? Le droit s’est beaucoup penché sur la question de la filiation sociale, avec le statut de la co-mère dans les couples homosexuels, par exemple. En revanche, il reste un gros chantier sur les fratries. Quand des parents se séparent, comment les enfants qui n’ont parfois aucun lien de sang entre eux peuvent-ils maintenir le lien ?
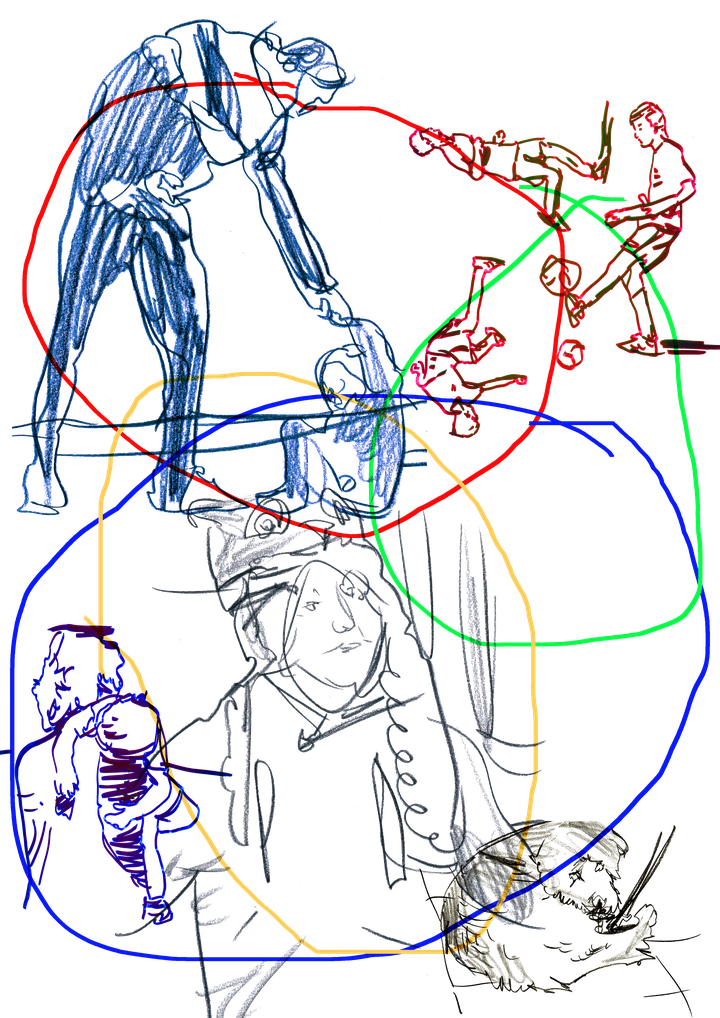
Médor : La famille nucléaire a-t-elle perdu sa place dans notre imaginaire ?
L.M. Non. Le modèle de base qu’on a toujours en tête, c’est la famille « corn flakes » : un papa, une maman, deux enfants blancs et blonds vivant sous le même toit. Pensez à cette petite maison en briques rouges qu’on dessine pour figurer le foyer, le ménage. C’est directement lié à la manière dont les États ont géré les populations. Elles ont assigné les individus à un lieu de résidence et ont considéré que les personnes qui vivent dans un même lieu constituaient un ménage. Mais c’est de moins en moins le cas aujourd’hui, y compris dans les familles nucléaires.
Médor : C’est-à-dire ?
L.M. Dans beaucoup de familles nucléaires, on peut voir un parent absent toute la semaine pour travailler. La famille est de moins en moins définie par la coprésence des individus dans un lieu unique. Elle colle de moins de moins aux murs d’une maison ! On n’est plus dans un seul modèle de vie linéaire avec ses étapes traditionnelles : école – recherche de boulot – mariage
– pension. Maintenant, on change plusieurs fois de couple, c’est plus mouvant. Résultat : on valorise davantage le caractère électif de la famille.
Médor : La famille devient-elle plus une affaire individuelle ?
L.M. On dit que la famille contemporaine est à la fois plus individuelle et plus relationnelle. Mais quand on dit « individuelle », ce n’est pas égoïste. Une des fonctions de la famille aujourd’hui, c’est d’aider les individus à se réaliser. La famille devient aussi un lieu de refuge dans un univers où les repères s’effondrent, notamment dans la sphère professionnelle.
Médor : Et ces fonctions peuvent être remplies même avec de la distance géographique ?
L.M. Il y a quelques années, j’ai étudié les familles transnationales, c’est-à-dire dont les membres vivent dans des pays différents. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, on observe que la distance n’entame pas la force des liens familiaux. Les migrants ne « coupent pas les ponts ». On reste imbriqué dans un système de droits et d’obligations : certaines personnes suivent de près les sorties ou le travail scolaire de leurs enfants ou prennent des dispositions pour le suivi médical de leur parent âgé. Dans ce cadre, les TIC (Technologies de l’information et de la communication) jouent un rôle fondamental. Elles permettent de remettre en place des routines.
Médor : Par exemple ?
L.M. Certaines familles recréent la routine du repas familial du dimanche sur Skype – y compris quand les membres sont séparés par plusieurs fuseaux horaires. Chacun se branche et on passe un repas ensemble. Dans l’étude MobileKids, on a observé que les jeunes de familles non nucléaires communiquaient davantage avec leurs parents, via les TIC, que ceux de familles nucléaires. Ça participe de ce « faire famille ». Certains jeunes retrouvent leur père sur des jeux multijoueurs en ligne, comme Fortnite, par exemple.
Médor : Visiter ses parents âgés sur Skype, ce n’est quand même pas la même chose…
L.M. Bien sûr. Et c’est une pente glissante. Il y a des moments de la vie où il faut être présent et le danger serait que les politiques prennent l’excuse qu’il existe ces TIC pour empêcher les personnes de se voir. Aux États-Unis, on supprime de plus en plus les visites en prison et on les remplace par des conversations en vidéo-conférence. En Belgique, on est dans un contexte de politique migratoire de plus en plus difficile, notamment dans les relations aux parents vieillissants.
Médor : C’est-à-dire ?
L.M. Les ressortissants de pays tiers n’ont plus accès au regroupement familial avec un ascendant. La Belgique a été condamnée pour cela mais s’est assise sur sa condamnation.