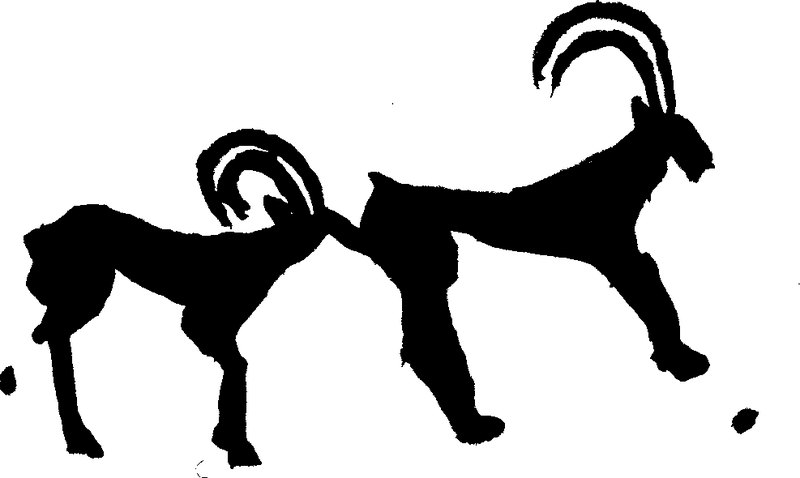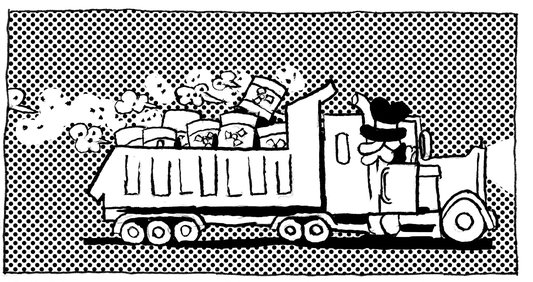L’avocat et le robot
Enquête (CC BY-SA) : Quentin Noirfalisse
Publié le

En Belgique, moins de 1 % de la jurisprudence est accessible en ligne. Des avocats rêvent pourtant d’un logiciel de « justice prédictive ». Celui-ci limiterait leur travail de fouille, proposerait des pistes juridiques et informerait des chances de succès d’une action en justice. Mais à quel prix ?
La scène se passe à Strasbourg, en décembre 2016. Un avocat belge portant boutons de manchette, cravate noire et veston gris s’adresse à ses pairs lors de la conférence Cyberjustice Europe 2016. Il en va de l’avenir de la justice et du métier d’avocat dans le monde, et en Belgique donc. Jean-François Henrotte, qui est en charge du projet « intelligence artificielle » pour Avocats.be, l’ordre des barreaux francophones et germanophone, lance une petite vidéo de démonstration. Dans celle-ci, un avocat est contacté par un client, propriétaire, qui aimerait mettre fin au bail commercial d’un locataire sans payer d’indemnité d’éviction. L’avocat, au lieu de mettre un jeune juriste frais émoulu le nez dans des kilomètres de jurisprudence et de textes de loi, ouvre un programme informatique. Il pose la question à son ordinateur, en langage naturel (c’est-à-dire en français écrit, dans ce cas). Deux clics plus loin, le logiciel lui propose les articles de loi qui concernent le bail commercial, la décision de justice la plus proche de ce cas et, surtout, toute une série de solutions juridiques pour permettre au client d’aboutir à ses fins. Fort de ces informations, l’homme de droit serait en mesure d’intimer à son client de suivre telle ou telle voie, en lui prédisant ses chances de succès, grâce à ce scan poussé de la jurisprudence belge.
Disposer de cette magnifique bécane coûterait, selon Me Henrotte, 40 euros par avocat par an, si les avocats se mettent d’accord pour mutualiser les coûts. Dans sa présentation, l’homme de droit met un avantage en avant : « Les pauvres vont voir les avocats parce qu’ils ne payent pas, les riches parce qu’ils ne savent pas combien ils payent mais la classe moyenne ne vient plus », de peur de payer trop. Ce genre de logiciel ferait donc baisser les coûts d’un recours à un cabinet en automatisant une partie du travail. « Ferait », car, pour le moment, il n’en est qu’à l’état de projet en Belgique.
Numérisation privatisée
Les legaltechs (technologies au service du droit) sont apparues aux États-Unis au début des années 2000. À l’origine, il s’agissait surtout pour des entreprises privées de mettre à la disposition des cabinets d’avocats des systèmes de gestion administrative, d’archivage ou de recherche juridique. Mais, aujourd’hui, les start-up traquent l’innovation dans tous les recoins d’un secteur peu réputé pour cajoler les bouleversements et la disruption.
Parfois, elles veulent même se substituer aux cabinets juridiques, comme LegalZoom, boîte américaine qui propose de créer des documents juridiques sans passer par un avocat. Le tout dans une logique assumée de profit. Une start-up comme Legalist propose à des citoyens et des entreprises de financer leurs actions en justice en échange de la moitié des dommages et intérêts perçus à la fin des procès. La clé de voûte de sa stratégie : un traitement de données surpuissant qui, en deux jours, mâchouille quinze millions de dossiers de justice et parvient à en recracher une prédiction sur les chances de succès d’une affaire et sa durée.
Au mois d’octobre 2017, près de 9 millions de dollars ont été investis pour accélérer Ross, « avocat-robot » qui travaille dans un cabinet d’avocats américain de 900 personnes et répond à des questions en analysant d’imposantes bases de données sur les faillites et le copyright.
Avocats.be, l’ordre des barreaux francophones et germanophone, aimerait bien entrer de plain-pied dans la justice prédictive. Mais l’informatisation de la justice est une épine dans le pied de l’État belge aussi profonde que la fosse des Mariannes.
Moyen Âge Numérique
Jean-Pierre Buyle, le président d’Avocats.be, balance les chiffres : « Les sources réglementaires sont accessibles sur le Moniteur en ligne, mais les sources jurisprudentielles sont problématiques. Un million de décisions judiciaires sont actuellement prononcées chaque année. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu 34 millions. La seule banque de données publiques qui contient de la jurisprudence, Juridat, elle ne compte que 160 000 jugements ; 0,47 % des décisions prononcées ont été publiées en ligne. C’est indigne d’un État démocratique. »
Pour tenter, une nouvelle fois, d’accélérer cette numérisation, l’État a pris une décision peu banale. En 2016, Koen Geens, le ministre de la Justice, a refilé la tâche aux ordres des barreaux du nord et du sud du pays. Selon Jean-Pierre Buyle, il s’agirait d’une première en Europe. Cette privatisation nous rappelle, surtout, à quel point la justice, désargentée, semble perdue face aux défis du numérique.
Jean-Pierre Buyle estime qu’il faudrait environ 2 millions de décisions numérisées, en accès « open source » (anonymisées), pour obtenir une base de données pertinente pour un algorithme prédictif.
L’automatisation des tâches va modifier le métier d’avocat (et surtout celui des jeunes qui farfouillent dans la jurisprudence) mais aussi la culture des cabinets, bien obligés d’innover, et d’être concurrentiels. « Les Anglo-Saxons investissent déjà là-dedans, et, si nous ne le faisons pas, nous serons des réfugiés du numérique », lance Buyle.
Robots injustes
Surtout, c’est une bardée de questions qui accompagne les legaltechs. Et de doutes. Aux États-Unis, une enquête du site d’investigation ProPublica avait montré que le programme Compas, qui juge les risques de récidive de prévenus et sert parfois pour définir les peines, donnait de plus mauvais scores aux Noirs qu’aux Blancs. L’entreprise créatrice du programme a, bien sûr, réfuté l’enquête mais celle-ci a permis de nourrir un débat de plus en plus présent quant aux algorithmes. Loin d’être des émanations d’un langage informatique pur et neutre, ils sont avant tout construits par des êtres humains, avec leurs intentions, leurs préjugés et leurs biais.
Le tribunal civil de Rennes a testé lui aussi depuis avril dernier une plateforme de prédiction, Predictice. Mi-octobre, le couperet est tombé : les magistrats n’y voient pas de plus-value pour leur travail et le logiciel doit être « sensiblement amélioré ».
Aujourd’hui, écrit le magistrat français Antoine Garapon, secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice, il ne s’agit plus « d’être pour ou contre la justice prédictive car elle est bien là et ne désertera pas de sitôt notre horizon » mais d’en « proposer une critique constructive et argumentée ».
Cette critique porte, entre autres, sur la nécessité de pouvoir ouvrir le capot des algorithmes, de connaître leur processus de fabrication et de préciser exactement les limites de leurs interventions, pour éviter qu’ils ne deviennent des juges-robots. La fascination qu’ils exercent actuellement sur les hommes et leur capacité à être utilisés à des fins opaques dans d’autres sphères (surveillance, marketing, soins de santé, et, bien sûr, réseaux sociaux) doivent inciter à la prudence. Comme nous le disait la philosophe et juriste belge Antoinette Rouvroy, il y a deux ans déjà : « Une décision est dite juste non parce qu’elle est conforme au résultat d’un calcul, mais parce que celui qui la prend est capable d’en donner les raisons et d’y adhérer au regard de la situation singulière, inédite, imprévisible qui se présente à lui. »