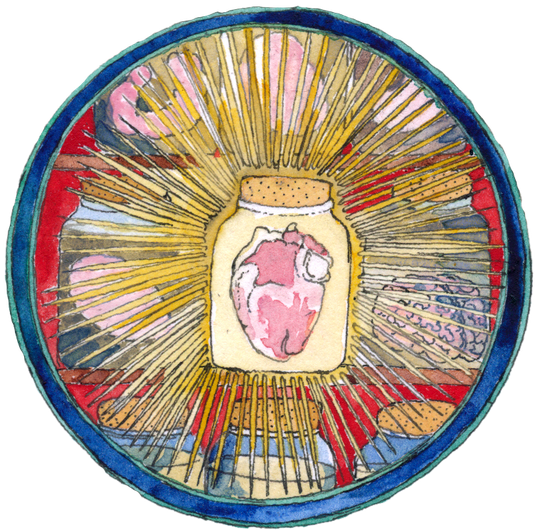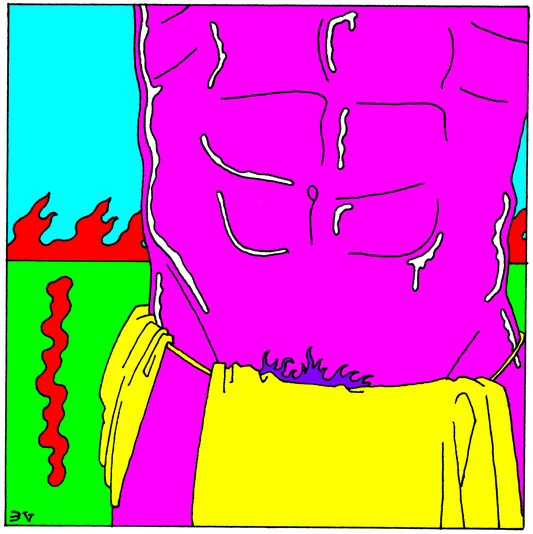Sources, tuyaux et caniveaux

Vous avez une info ? La rédaction vous écoute. Ensemble, on va peut-être sauver le monde. Ou votre peau. Ou la nôtre.
Ils s’appellent Edward Snowden, Irène Frachon ou Antoine Deltour. Profil : lanceurs d’alerte. Signe distinctif : marre de se taire. Vous aussi, vous avez un scandale sur le bout de la langue ? Un patron corrompu ? Un cycliste non dopé ? Des extraterrestres dans le jardin ? Au mieux, vous connaissez un journaliste ou quelqu’un qui en connaît un. Mais rien ne dit que ce sacripant daignera se pencher sur votre scoop. Et pourquoi pas la lettre anonyme à un quotidien, façon collage flippant ?
Par ici les corbeaux
Heureusement, dans les salles obscures des rédactions, on a pensé à vous. Depuis bientôt deux ans, le site Sourcesûre permet aux citoyens de déposer anonymement une alerte à destination d’un ou de plusieurs médias francophones (au choix : la RTBF, La Libre Belgique, Le Soir, L’Avenir, Le Monde, France TV info, L’Obs et la Radio télévision suisse). Soit une boîte aux lettres ultrasécurisée à laquelle ne peuvent accéder que quelques journalistes en possession d’une clef USB et d’un code idoine.
Le but annoncé de ce raffinement technologique est de vous faire prendre le moins de risques possible. Car à l’heure des GSM et des e-mails sous surveillance, le déficit de paranoïa serait un mal répandu. « L’objectif est de protéger les sources contre elles-mêmes », explique Patrick Remacle, l’un des journalistes de la RTBF à l’origine du projet. « C’est surtout un moyen de se mettre aux normes. Les lanceurs d’alerte ont toujours existé, mais les outils ont changé. On a besoin d’un guichet numérique », estime Yves Eudes du journal Le Monde. « J’y vois plutôt une tentative de la presse traditionnelle de reprendre la main sur une information dont elle n’a pas plus le monopole depuis l’avènement d’Internet », analyse, sceptique, Jacques Englebert, avocat spécialisé en droit des médias.
Lors de son lancement, Sourcesûre a fait craindre à certains une vague de délations crapuleuses. Aucun risque, répond-on chez les fondateurs, à condition qu’il y ait un journaliste sérieux pour recevoir l’alerte au bond. Pour eux, les motivations de la source – pas toujours jolies à voir – importent peu. Si l’info relève de l’intérêt général, on donne suite. Sinon, on laisse tomber. Même si la confusion entre la moralité et la fiabilité des lanceurs d’alerte n’a, il est vrai, jamais été aussi grande qu’aujourd’hui : la directive européenne du 8 juin 2016 sur les secrets d’affaires prévoit la clémence pourvu que le « défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ». « Imposer un but légitime dans le chef de la source, c’est un moyen de restreindre l’information », estime Jacques Englebert. En plus d’être les nouveaux héros de nos démocraties fatiguées, les lanceurs d’alerte devraient aussi être des saints ? Drôle de morale.
Cas psychiatriques
Sourcesûre n’a pas encore eu son Wikileaks ou son Panama Papers. Mais les rédactions attendent leur heure. Patiemment. Pour Yves Eudes, « il suffirait d’une fois pour rentabiliser l’outil ».
L’Avenir, qui a mené une vaste enquête sur les dysfonctionnements de l’Office wallon des déchets au printemps dernier, a bien eu quelques alertes intéressantes à la suite de la publication d’un « pavé promo » Sourcesûre.
« Il s’agissait de pistes sérieuses concernant ce dossier mais, pour le coup, nous avions déjà été informés par nos canaux habituels », explique Yves Raisière, chef des infos nationales. Pour le journaliste, les pressions exercées sur les fonctionnaires wallons pour qu’ils évitent de bavarder sont néanmoins une preuve parmi d’autres de la nécessité d’un tel outil, « même si ce n’est pas le Graal ».
Du côté de la RTBF, Georges Lauwerijs déclare que « 10 % des alertes reçues ont donné lieu à un résultat sur antenne ». Harcèlement au travail, escroquerie en ligne, parents d’élèves inquiets : « de bonnes illustrations de problématiques sociétales ». Les 90 % d’alertes non exploitées sont à mettre au rang des « cas psychiatriques ».
« Des gens qui se croient victimes de complots machiavéliques. Beaucoup d’appels au secours », raconte Georges Lauwerijs. « Du bruit », résume Yves Eudes. Pour Patrick Remacle, c’est plus que ça : « un observatoire sociologique ». « Nous en avons besoin car ce métier est un monde clos, estime-t-il. Les journalistes bossent ensemble, bouffent ensemble, baisent ensemble. » Hmmm. Une info, comme qui dirait, de source sûre.