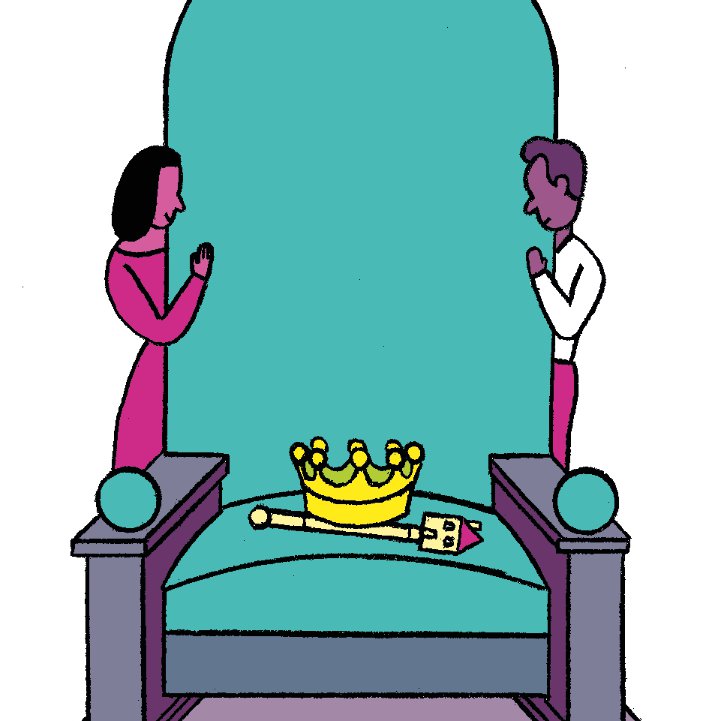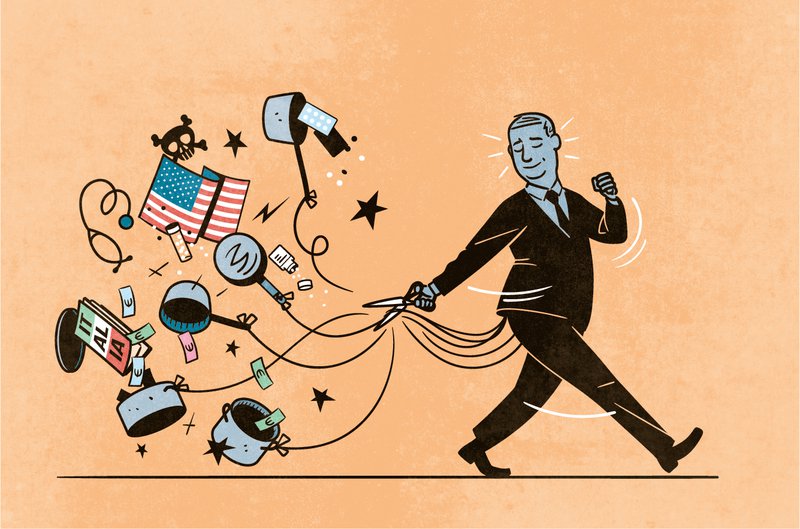La maculée conception
Ces bébés belges issus du business des ovules espagnols

La Belgique ne trouve pas assez de donneuses d’ovules pour répondre à la demande croissante des femmes infertiles. Heureusement, il y a l’Espagne et sa « solidarité féminine ». Sur fond de crise économique, de jeunes Espagnoles se soumettent à des stimulations hormonales pour « donner » leurs ovules à des cliniques privées. Compensation pour ce geste jamais anodin : 1 000 euros. Derrière un masque d’œuvre de bienfaisance, la procréation sans frontières cache des intérêts économiques faramineux.
Article primé en 2017 au Prix de la Presse Belfius dans la catégorie Presse écrite.
Leah enfonce l’aiguille dans son ventre. Elle retient son souffle. Le liquide se répand comme un venin. Il contient de la gonadotrophine, une hormone qui déclenche l’ovulation. Des larmes coulent de ses yeux. La douleur, la fatigue, la colère aussi… Cela fait plus d’un an qu’elle essaie d’avoir un enfant. Elle a 37 ans. Les piqûres quotidiennes dessinent sur sa peau un ciel d’orage rougeoyant. Mais ses ovaires restent impassibles. Malgré la stimulation hormonale, ils ne produisent pas assez d’ovules de bonne qualité pour créer un embryon. Leah souffre d’une insuffisance ovarienne. Pour le dire vite fait, une « ménopause précoce ». Si elle avait rencontré son compagnon plus tôt, elle n’aurait peut-être pas eu de problème de fertilité…
La dernière solution pour tomber enceinte est la fécondation in vitro (FIV) avec le sperme de son conjoint et les ovocytes d’une donneuse. Plus celle-ci est jeune, plus les chances de grossesse sont grandes car, en matière de fertilité, c’est l’âge des ovules, et non celui de l’utérus, qui compte. Cela explique pourquoi, en Espagne ou aux États-Unis, des femmes ont pu tomber enceintes à plus de 60 ans.
La Belgique est un pays « pionnier en matière de procréation médicalement assistée », qu’entre amis, on appelle « PMA ». Le premier bébé belge issu d’une FIV naissait en 1983, cinq ans seulement après la petite Anglaise Louise Brown (premier bébé-éprouvette au monde). Aujourd’hui, plus de 3 % des bébés nés dans notre pays ont été conçus avec l’aide de la médecine, estime la Société européenne de reproduction humaine et d’embryologie (ESHRE). En Belgique, le « taux » de PMA par habitant est l’un des plus élevés d’Europe.
Maladie vieille comme l’humanité, l’infertilité est devenue pandémie. Elle touche, sous une forme ou l’autre, un couple sur six dans le monde et un sur cinq en Belgique. « L’augmentation de l’âge de la partenaire féminine est l’une des explications les plus courantes de l’infertilité aujourd’hui », précise l’ESHRE. Et c’est pour cette raison que le recours au don d’ovocytes ne cesse d’augmenter. S’il peut être indiqué en cas de maladie ou à la suite d’un traitement anticancéreux, il s’agit avant tout d’une solution « anti-âge ». Des amies de Leah, mères de fratries de cartes de vœux, la rassurent : « La ressemblance physique, dans une famille, ce n’est pas très important. »
Souk procréatif
L’Europe de la PMA n’existe pas. Chaque État légifère à sa sauce. L’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, encore traumatisées par les expériences eugénistes nazies ou attachées au bon sens chrétien, autorisent le don de sperme mais pas le don d’ovocytes qui consacre la conception « à trois » (donneuse, receveuse et père). La France réserve son sperme et ses ovules aux couples hétéros bien installés. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas n’autorisent que le don « connu » (l’enfant doit pouvoir connaître ses origines à 18 ans). Quant à l’Espagne, elle n’accepte, à l’inverse, que le don strictement anonyme. En Belgique, la loi de 2007 sur la procréation médicalement assistée est plus souple. « Tout » est permis : don de sperme et d’ovocytes, anonyme ou direct, sans distinction d’état civil ou d’orientation sexuelle pour la receveuse, jusqu’à 47 ans.
Dans ce souk procréatif, chaque patiente qui en a les moyens voyage vers le pays qui lui convient. Parmi les destinations prisées : la Belgique, où des Thalys entiers de Françaises, seules ou homosexuelles, viennent se faire féconder (avec du sperme danois), mais aussi l’Espagne, qui peut compter sur de nombreuses donneuses d’ovocytes et une loi non restrictive.
Partout, le don doit être « volontaire » et « non rémunéré », comme l’impose une directive européenne de 2004 sur les tissus et cellules d’origine humaine. Une indemnisation peut être proposée mais uniquement pour couvrir les dépenses et désagréments « liés au don », comme un trajet en métro, un sandwich au pâté à l’hôpital, ou l’indisponibilité au travail (en Belgique et en Espagne). Les montants ne sont pas précisés.
Les centres belges respectent l’esprit de cette directive en ne communiquant pas sur l’existence de ces éventuelles indemnisations, afin de ne pas encourager les dons pour motifs économiques. Selon nos informations, les montants oscilleraient entre 400 et 2 000 euros pour un don d’ovocytes (impliquant plusieurs visites médicales pendant 15 jours), et entre 50 et 75 euros pour un don de sperme. Résultat : dans les 18 centres de PMA du pays, on manque cruellement de sperme et d’ovocytes.
Mais où recruter une donneuse ? Leah épuise son entourage, sa sœur, ses amies. Aucune d’entre elles ne se sent la force ou l’envie de poser un tel acte. « Ce serait comme te donner un demi-bébé », lui répond-on. En octobre 2013, Leah m’écrit : « Je pars aujourd’hui à Barcelone pour un premier rendez-vous à la clinique Eugin. » C’est son médecin qui le lui a suggéré : en Espagne, les donneuses tombent du ciel. Parce qu’elles reçoivent systématiquement 1 000 euros par don ? Non. Parce que les Espagnoles sont plus altruistes, dit-on…
Bébés Ryanair
« Eugin », c’est un nom qui se refile dans les salles d’attente de PMA de Belgique. La clinique catalane affiche un taux de grossesse de 65 % (après deux essais de FIV avec ovocytes de donneuse), alors qu’on n’arrive pas à la moitié de ce résultat en Belgique. C’est que les donneuses espagnoles sont jeunes : « Chez Eugin, elles ont en moyenne 27 ans », explique la Dre Valérie Vernaeve, la directrice de la clinique, qui est Belge. Et les patientes ? « La moyenne est de 41 ans. »
Fondée en 1999 par deux gynécos catalans, Eugin a su profiter de la loi espagnole de 2006, stable et ouverte : traitements de fertilité accessibles aux homos, aux femmes seules ou plus âgées (la loi parle d’un « âge adéquat » ; chez Eugin, la limite est fixée à 50 ans), et dons strictement anonymes. Les Françaises et les Italiennes, soumises à des législations nationales très conservatrices, ont accouru en nombre. De même que les Belges en mal d’ovocytes (139 patientes belges en 2015). « En Europe, 50 % des traitements avec don d’ovocytes ont lieu en Espagne ; une patiente sur dix vient chez Eugin », poursuit la Dre Vernaeve.
La clinique compte plus de 70 % de patientes étrangères, d’Europe occidentale mais aussi d’Asie, de Russie, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Rien qu’à Barcelone, il existe une trentaine de cliniques de fertilité de ce type. On peut donc imaginer que des centaines de « bébés Ryanair » naissent chaque année en Belgique, grâce aux ovules espagnols. Mais il est impossible de les comptabiliser : certains parents n’informent ni leur gynécologue ni leur entourage des secrets de la conception de leur enfant et, en Belgique, le Conseil des médecins de la reproduction ne dispose d’aucune statistique sur le tourisme procréatif vers l’Espagne.
« On n’aime pas le mot “tourisme” », corrige la Dre Vernaeve. Pourtant, NMC Health, la multinationale des Émirats arabes qui a racheté Eugin en février 2015 à une société de capital-risque espagnole pour 143 millions d’euros, l’écrit noir sur blanc dans un communiqué de presse : « L’acquisition d’Eugin va permettre à NMC de s’implanter sur le marché du tourisme médical. » Soit. Les patientes ne viennent évidemment pas ici pour les joies de la Costa Brava mais pour les ovocytes pimpants et disponibles sans liste d’attente. Leah est aussi rassurée d’apprendre qu’on lui a trouvé une donneuse « qui lui ressemble ».
La clinique des Enfants « plausibles »
Dans une vidéo sur le site d’Eugin, une quadragénaire de type scandinave pose à côté de « sa » jeune donneuse : mêmes cheveux blond purée, même couleur de peau pâle, mêmes yeux clairs. La clinique insiste sur sa pratique de l’« appariement » ou « matching phénotypique ». Il s’agit de veiller, dans le choix de la donneuse, à ce que le futur bébé soit « raccord » avec ses parents (pas de bébé marron si les deux parents sont blonds). « Le but, c’est d’avoir un enfant “plausible”, qui soit intégré dans le couple, qu’on ne se dise pas qu’il y a “quelque chose” quand on les voit en rue », explique la Dre Vernaeve.
Plus étonnant : la clinique applique la même règle pour les groupes sanguins. Cette précaution permet aux parents de maintenir le secret de la conception de l’enfant sans qu’une prise de sang ne puisse éveiller les soupçons d’un médecin. « Certains ne veulent rien dire à leur enfant », justifie la Dre Vernaeve. Il va sans dire que Les secrets de famille du psychiatre Serge Tisseron, qui insiste sur les ravages du non-dit sur l’équilibre des enfants, ne figurent pas dans la pile de lectures des salles d’attente d’Eugin…
À l’étage, dans le laboratoire de la clinique, le Dr Albert Obradors plonge ses gants de géant dans la vapeur d’azote. À l’aide d’une sorte d’épuisette, il retire de la brume une petite caisse gelée et en sort une paillette. « Sur cette tige se trouvent trois ovocytes. » L’homme, responsable du labo, gère ses tanks comme un trésor de guerre : cinq cuves d’azote à -196°C, remplies de sperme, d’ovocytes et d’embryons vitrifiés. Il ne cache pas son émerveillement : « L’ovule, c’est la cellule la plus importante de la vie. Il y en a 13 000 dans ce tank, dont 10 000 de donneuses. » La clinique en prélève en moyenne sept par donneuse. Le contenu de ce tank a donc coûté près d’un million et demi d’euros à Eugin rien qu’à titre de dédommagement. Mais on ne s’inquiète pas pour la santé financière de la clinique… Son chiffre d’affaires s’élevait à plus de 34 millions d’euros en 2014.
Le jour du « transfert » arrive. Leah est invitée à solder sa facture avant l’intervention : 6 880 euros. Elle ressort de la clinique quelques heures plus tard avec sa première échographie en main : on y voit deux embryons conçus grâce au don d’une jeune fille de 19 ans. Leah est folle de joie. Elle ressort ses listes de prénoms. Au-dessus de son bureau, à Bruxelles, elle a écrit : « Quand tu penses à tout laisser tomber, pense à la raison pour laquelle tu as tenu le coup si longtemps. »
Altruisme et castagnettes
À l’ouest de Barcelone, dans une rue perpendiculaire au bâtiment principal, se trouve l’« autre » entrée de la clinique Eugin… C’est le centre Eudona, destiné aux donneuses. Sur la façade, des portraits de filles de toutes les couleurs, au milieu d’ovules pétillants. Sara, 30 ans, vient d’achever son deuxième cycle de don. C’est Eugin qui me la présente et, sans surprise, elle est formidable : déjà maman de cinq enfants, elle « ne peut supporter la souffrance de celles qui ne peuvent pas être mères ». Elle le fait « pour aider ». Sara cadre parfaitement avec le marketing de la solidarité féminine développé par Eugin.
« Les Espagnoles sont vraiment plus altruistes, insiste la Dre Vernaeve. « C’est incroyable. En venant de Belgique, j’ai vu la différence. » Et la preuve massue : « Les Espagnols font aussi beaucoup plus de dons d’organes et de dons de sang. » De fait : il existe un « modèle espagnol », mondialement reconnu, fait de dispositions légales, économiques, politiques et médicales favorisant le don. Mais on ne peut pas mettre tout le matériel biologique dans le même sac ! Le don de moelle ou de rein vise à sauver un proche, un ami ou un enfant qu’on connaît – le lien relationnel est important. Quant au don de sang, il n’est pas invasif comme le don d’ovules, qui est lourd, douloureux et chargé de sens.
Le retrait des ovocytes se fait au bloc opératoire, sous anesthésie générale. Si le syndrome d’hyperstimulation ovarienne (qui, dans sa forme la plus sévère, peut entraîner la mort) a pratiquement disparu dans les cliniques sérieuses, « on ne peut jamais exclure les risques infectieux ou hémorragiques », rappelle le professeur Michel Dubois, chef de service du centre de PMA de l’Université de Liège. Et ce, même si Eugin l’écrit sur le site d’Eudona : « Rappelle-toi que le don d’ovules est une intervention sûre et qui ne comporte aucun risque. »
En admettant cependant que l’altruisme soit, au même titre que les castagnettes, une particularité culturelle espagnole, il faudrait encore rappeler que toutes les donneuses ne sont pas des Espagnoles « de souche ». En Catalogne, un quart d’entre elles sont nées à l’étranger, selon le registre catalan de reproduction médicalement assistée. Eudona traduit son site en anglais, italien, chinois, japonais et russe, et déclare avoir principalement des donneuses « européennes, d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale ».
L’attrait des 1 000 €
À l’Institut Marqués de Barcelone, le Dr Ángel López ne tourne pas autour du pot : « Nous devons nous adapter à nos patientes et chercher des donneuses qui sont compatibles. On essaie d’attirer les étudiantes Erasmus et les Espagnoles aux yeux clairs. Quand on a une fille avec un phénotype “du nord”, on lui demande si elle n’a pas des amies du même type. On ne l’écrirait pas sur une pub mais on le dit : on cherche surtout des yeux clairs, des cheveux clairs, des peaux blanches. » Enfin, si l’altruisme est typiquement espagnol il faudrait aussi expliquer par quel miracle il se répand en Grèce et en Tchéquie, deux destinations européennes montantes pour le don d’ovocytes.
Effet de la crise économique ou de l’augmentation de la demande ? Entre 2009 et 2013, le nombre de donneuses en Catalogne a augmenté de 35 % (de 3 032 à 4 108) : on voit croître la proportion de très jeunes filles (moins de 25 ans), de chômeuses et d’Espagnoles « de souche ». La Dre Vernaeve assure que chez Eugin, il n’y a pas eu de « pic » de dons avec la crise. « Et j’anticipe déjà votre question, il y a moins de chômeuses parmi nos donneuses (24 %) que dans la population jeune moyenne en Espagne (49 %). »
Ce n’était pas la question : en Espagne, il ne faut pas être chômeuse pour être précaire. 1 000 euros, c’est au-delà du salaire moyen d’une jeune diplômée. C’est plus qu’un minerval universitaire. Dès le moment où l’on paie, la vulnérabilité économique entre en jeu.
Pour nous rassurer, la Dre Vernaeve sort les résultats de l’étude réalisée par Eugin auprès de ses donneuses. « En moyenne, on voit que l’altruisme est un élément important pour elles : 30 % le font par pur altruisme et 50 % le font par altruisme et pour la compensation financière. Donc dans 80 % des cas, l’altruisme est vraiment un facteur qui ressort. » Mais les 20 % restants l’ont fait uniquement pour l’argent. Dit autrement : une fois sur cinq, dans l’une des cliniques les plus réputées d’Europe, la donneuse vend ses ovocytes et ne s’en cache pas. Dans 70 % des cas (« en moyenne », donc), on ne respecte ni la directive européenne ni la loi espagnole qui imposent que le don soit désintéressé. Mais Eugin peut prouver sa bonne foi : 100 % des donneuses ont bien signé le contrat stipulant qu’elles s’inscrivent dans une démarche « volontaire et altruiste ». Combien, finalement, savent jouer des castagnettes ?
Pendant quinze jours, Leah couve ses embryons jumeaux. Mais la prise de sang de contrôle sera un nouveau coup dur : ils se sont tous les deux envolés.
Fabricante d’ovules
Ivonne insiste pour témoigner sous son vrai nom6. Il y a quelques années, elle a donné ses ovocytes à un hôpital privé de Barcelone. « J’avais 26 ans. Des amies colombiennes m’en ont parlé comme d’une histoire de shopping : tu as une marchandise, tu la vends ; d’autres en ont besoin, elles l’achètent, et voilà. Le montant et la possibilité de faire des analyses médicales gratuites m’ont convaincue. J’y allais pour ça. Mais, quand je me suis retrouvée dans la salle d’attente, avec toutes ces photos de bébés, ma motivation a changé : j’ai voulu aider une femme qui ne pouvait pas avoir d’enfant. »
Le processus est éprouvant. « Les piqûres m’ont traumatisée. J’ai grossi comme une femme enceinte, comme si j’allais exploser. Puis je me suis retrouvée dans cette salle d’op, avec une dizaine de personnes autour de moi, et je me suis réveillée, plus tard, avec une compresse entre les jambes. J’ai pris mon chèque, en ayant l’impression d’être une marchandise, une fabricante d’ovules au service d’un système capitaliste. »
Ivonne n’a pas de remords mais ne peut s’empêcher de penser à la portée de son geste. « À l’époque, j’avais bien lu tous les documents mais je ne réalisais pas ce que je faisais. Depuis, je pense souvent à cet enfant qui doit me ressembler, quelque part dans le monde. Les donneuses ne parlent jamais de cela. Il y a un tabou lié au fait qu’il y a de l’argent derrière, une double morale. »
Chez les receveuses aussi, le processus peut laisser un goût amer. Carine, qui a tenté sans succès le coup du « bébé Eugin », se sent arnaquée : « Ils présentent les choses de manière hyper-commerciale – comme s’il s’agissait d’acheter une voiture » : on parle d’offres, de garanties, de délais. « Or, les ovocytes de la donneuse étaient mauvais, il n’y avait qu’un seul embryon. Ils auraient pu me proposer un autre essai. » Mais non. La médecine n’a pas, comme l’automobile, d’obligation de résultat. « À ce prix-là, on s’attend à un “service après-vente” ! En fait, c’est une usine à reproduction, une usine à fric mais – il faut le reconnaître – avec quand même des gens humains derrière. » Faute de moyens financiers, Carine a abandonné son projet d’enfant.
Registres fantômes
Valérie, une autre Belge, aussi : « On ne pouvait pas se le permettre, alors qu’on remboursait encore l’emprunt pour les fécondations in vitro à Bruxelles. Pour un bébé qu’on n’a jamais eu ! » Dans un parcours pareil, les couples se demandent désormais non pas s’ils ont les moyens d’« avoir » un enfant mais de « faire » un enfant.
Depuis l’hôpital public de Sant Pau de Barcelone, joyau d’art moderne, le Dr Joaquim Calaf, chef du service de gynécologie, observe le développement des cliniques privées : « Bien entendu, c’est du commerce. » Plutôt rassuré par leur professionnalisme, il identifie néanmoins deux menaces : « Le fait que les centres de reproduction passent progressivement des mains des médecins aux mains de capitalistes qui recherchent le profit – ça a déjà commencé ; et, à l’inverse, le développement du low-cost. Quand on diminue les prix, on diminue la qualité. »
Sur le site ReproduccionAsistida.org, ce sont déjà les soldes : congélation d’embryons à moitié prix « parce que nous voulons vous aider à réaliser votre rêve » (mais il faut se taper Malaga) ; « FIV avec don d’ovules à 5 920 euros au lieu de 6 960 euros » (mais plus que quatre jours pour en profiter) ; « mini-don d’ovules » super pas cher…
« Le don d’ovocytes a généré des inquiétudes depuis le début », rappelle Guido Pennings du Bioethics Institute Ghent (BIG). En 2005, un scandale éclate en Roumanie : des cliniques ont abusé de jeunes filles pour qu’elles donnent leurs ovocytes. L’Espagne semble, jusqu’ici, épargnée par de telles dérives. Mais elles sont possibles, notamment si des donneuses se présentent dans différents centres sans déclarer leurs dons antérieurs, risquant leur santé et rendant impossible le contrôle de la consanguinité des enfants.
Le registre national des donneurs et donneuses, prévu par la loi, n’existe toujours pas en Espagne – ni en Belgique, d’ailleurs. Il est donc impossible pour les cliniques de vérifier que les donneuses n’ont pas fait plus de six dons au total (règle en Catalogne) et qu’elles n’ont pas donné naissance à plus de six enfants sur le sol espagnol, les leurs compris (loi espagnole). « En attendant, oui, en théorie, il pourrait y avoir des donneuses professionnelles, admet le Dr Javier Nadal du Centre médical Teknon. J’ai eu une fois un cas. Après avoir fait un don, une patiente m’a avoué qu’elle avait déjà donné douze fois. » Les risques pour les donneuses et la société ne sont donc pas « théoriques ». La consanguinité liée au don de sperme préoccupe déjà depuis longtemps : en 2013, la Belgique découvrait que les gamètes du donneur danois 7042 de la Nordic Cryobank, porteur d’une maladie génétique, avaient servi à concevoir 99 enfants, dont 20 en Belgique, de 16 mères différentes (alors que la loi belge limite ce nombre à six). Sans registre, le système est incontrôlable.
Leah va d’échec en échec. Elle tente encore deux implantations d’embryons chez Eugin avec de nouvelles donneuses, sans résultat : peu d’embryons « utilisables », beaucoup de malchance. Après avoir dépensé 19 275 euros en Espagne, en plus des frais d’avion, de taxi et de logement, elle décide de créer un blogue, « LeahChercheDonneuse », qui lui permettra, grâce au geste d’une inconnue, de profiter d’un don direct en Belgique. « Pour moi, c’est plus facile de continuer ce combat que d’arrêter et de faire le deuil d’une grossesse… »
Des donneuses invisibles
C’est un petit bureau caché, à l’arrière d’un syndicat, croulant de livres sur les femmes et la santé. Margarita López Carrillo et Montserrat Cervera Rodon, militantes du Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), m’accueillent comme un roi mage. Mais mon butin journalistique est maigre : à Barcelone, je n’ai trouvé aucune association de donneuses, aucune permanence psy, aucun groupe de soutien qui leur soit dédié. Même l’Église s’en fiche ! Pour Margarita, il s’agit d’une réalité invisible : « Je crois que nous sommes les seules personnes dans cette ville à nous préoccuper des donneuses d’ovocytes. » Elles sont trois et elles publient Mujeres y Salud, une revue associative sur les femmes et la santé. « Pourtant, on parle d’un commerce dans lequel on manipule des jeunes filles qui ne mesurent pas bien les conséquences de leurs actes. » Leur espoir, ce sont les associations nord-américaines, comme Our bodies ourselves au Massachusetts, qui s’inquiètent des donneuses. Et des cas comme celui de Yolanda.
« Je ne porterai pas plainte. Je veux surtout ne plus entendre parler de cela. » Yolanda a donné ses ovocytes à Eugin, il y a une dizaine d’années, pour profiter des examens médicaux offerts aux donneuses et se faire un bilan de fertilité. À l’époque, elle n’arrivait pas à tomber enceinte. « Ils m’ont dit que je ne produisais pas assez d’ovocytes ; ils ont dû augmenter les doses de gonadotrophine. » Quelque temps plus tard, la clinique l’avertit que la receveuse est bien enceinte. Mais elle, toujours pas. « On m’a diagnostiqué un cancer de la thyroïde. Plus d’essais pendant trois ans : c’était ça le pire. Je pensais tout le temps à cette femme que j’avais aidée, à l’âge que devait avoir cet enfant… »
Après de nouvelles stimulations ovariennes, Yolanda donne finalement naissance à une petite fille. « Trois ans plus tard, je fais un cancer du sein. Est-ce un hasard ? Pour mon gynéco, non. Certains disent que le traitement peut augmenter les risques de cancers gynécologiques. Même si ce n’est qu’une suspicion, il faudrait en parler aux donneuses. »
Yolanda me met en contact avec Luna, une jeune Canarienne, qui a donné ses ovocytes à l’âge de 22 ans et ne s’imaginait pas le tourment émotionnel que cela provoquerait chez elle. « On fait comme si on avait oublié. Mais on n’oublie jamais. » Un jour, elle a rappelé la clinique, « pour savoir »… « On m’a juste confirmé qu’un enfant était né. Il a peut-être 9 ans maintenant. Comme adulte, je peux encore supporter de ne pas le connaître. Mais lui, s’il veut savoir la vérité, s’il veut me rencontrer ? »
Pas de risques « avérés »
Le don d’ovocytes est-il réellement sans risque ? Sur un plan médical, la dizaine de spécialistes consultés, en Belgique ou en Espagne, sont unanimes : les données portant sur les femmes qui se soumettent à une stimulation ovarienne pour elles-mêmes (FIV) peuvent être extrapolées à la population de donneuses. Elles seraient suffisantes pour conclure qu’il n’y a pas de risque avéré ni d’infertilité ni de cancer. « Des études récentes suggèrent qu’il pourrait exister un risque accru de tumeurs ovariennes borderline, soit un stade précancéreux, nuance simplement la professeure Anne Delbaere, chef de clinique de la fertilité de l’hôpital Érasme à Bruxelles. Mais c’est probablement parce que les patientes ont des échographies plus fréquemment que la population générale et qu’on diagnostique donc ces tumeurs plus souvent. De plus, le fait de ne pas avoir d’enfants est un facteur de risque connu pour le cancer de l’ovaire. » De façon générale, les études de suivi concluent qu’il n’y a pas de risque accru de cancer des ovaires « chez la majorité des femmes » mais qu’un doute persiste dans certains sous-groupes comme les femmes qui demeurent sans enfant après le traitement.
En Amérique du Nord, où le don d’ovocytes est un business en règle (les donneuses reçoivent facilement 10 000 dollars, surtout si elles sont blondes, minces et diplômées de Harvard), cette réponse ne suffit plus. « Quand les cliniques disent qu’il n’y a pas de risque “avéré” ou qu’il est rare, c’est parce que les recherches n’ont pas été faites sur des donneuses », affirme Diane Tober, une anthropologue de la santé qui dirige une vaste étude sur les donneuses à l’Université de San Francisco et réalise un documentaire, The Perfect Donor. Pour cette chercheuse, il est urgent de mener une étude sur la population spécifique des donneuses (qu’elle appelle « fournisseuses »), notamment « parce qu’elles sont plus jeunes, et donc typiquement plus sensibles à la médication, que les femmes qui subissent un traitement de leur propre infertilité ».
Ni soutien ni débat
« Aux parents qui élèvent mes ovules ». L’article est posté sur le blogue de l’association internationale We are egg donors (Nous sommes donneuses d’ovules). Il plaide, comme beaucoup d’autres témoignages sur ce site, pour une meilleure prise en compte des risques physiques et émotionnels liés au don. Au Nebraska, Sierra Poulson, l’une des cofondatrices de l’association, en appelle à une information transparente : « Beaucoup de donneuses cherchent du soutien et se demandent si ce qui leur arrive est normal. Nombreuses sont celles qui vivent le don sans complication ultérieure mais il y en a aussi beaucoup qui ne le vivent pas bien. Je suis personnellement préoccupée. Après avoir parlé avec des centaines de donneuses, cela semble difficile de croire qu’il n’y a pas de risque à long terme. Et l’absence de recherches rend cela encore plus troublant. »
Les féministes catalanes cachées dans leur petit bureau m’ont aussi mise en contact avec Beatriz Gimeno, militante pour les droits des femmes et des homosexuels et députée Podemos au parlement régional de la Communauté de Madrid. Si quelqu’un se décide à bouger en Espagne, ce pourrait être elle. L’élue confirme l’urgence à ouvrir ce dossier. « Les féministes espagnoles se sont beaucoup mobilisées sur les “ventres à louer” (gestation pour autrui) mais il n’y a jamais eu de débat sur le don d’ovocytes, qui est une autre forme de marchandisation du corps de la femme. » Si les progressistes ne développent pas rapidement cette réflexion critique, l’Église ou les mouvements pro-vie (pro-life) pourraient bien se réveiller avant eux. Nul doute qu’ils jetteraient alors le bébé avec l’éprouvette et crisperaient les positions : les féministes auraient-elles envie de s’allier avec des antiavortement ? Aux États-Unis, les conservateurs du Center for Bioethics and Culture Network se mobilisent déjà massivement contre le don d’ovocytes, produisant des documentaires-chocs, comme Eggsploitation ou Maggie’s story.
« Je ne sais pas d’où tu viens »
La scène se passe dans un parc bruxellois. « Madame, est-ce que Chloé est adoptée ? », demande une petite fille du quartier. Sa question fait l’effet d’un glaçon dans le cou de Christine. Elle répond calmement : « Non, je l’ai portée dans mon ventre et je lui ai donné naissance. » Mais elle comprend la confusion : « Je suis seule, je suis une maman âgée et Chloé n’a pas de papa. Je cumule les particularités. » Christine a obtenu chez Eugin un double don, de sperme et d’ovocytes. « C’est classique pour eux. Vous payez ? On vous le donne. » Ses yeux s’embrument : « Contrairement à ce qu’ils m’avaient “vendu”, ma fille ne me ressemble pas du tout. Chloé est très jolie, beaucoup plus que moi. Mais me ressembler, ça non… Et cette différence physique me rappelle constamment ce que j’ai enduré. » La petite fille a aujourd’hui 5 ans et Christine l’aime plus que tout au monde. « J’ai eu ce que je voulais. Mais il ne faut pas croire que les questions s’arrêtent avec la naissance. Ce qui m’inquiète, c’est si elle le vit mal plus tard. Je ne pourrai jamais répondre aux questions sur ses origines. Non, génétiquement, je ne sais pas d’où tu viens. »
« Ne répétons pas l’histoire du don de sperme », implore le Dr Dubois, de l’Université de Liège, qui refuse les dons d’ovocytes anonymes. Ce professeur espère que la Belgique va revoir sa législation, comme l’ont fait les Pays-Bas en 2004 et la Grande-Bretagne en 2005. « On a vu les dégâts chez certains enfants de donneurs de sperme qui recherchent désespérément leur géniteur », rappelle-t-il. Les asbl belges Enfants de donneurs/Donorkinderen et Donorkind réclament elles aussi l’abolition de l’anonymat total pour les dons futurs. Comme les enfants adoptés, qui peuvent accéder à leur dossier (en vertu de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant), les enfants de donneurs souhaitent obtenir l’accès à des informations sur leurs géniteurs11.
En Flandre, l’affaire du donneur de sperme danois a fait du bruit dans la presse et a ouvert le débat. En 2014 et 2015, des députés ont remis des propositions de loi au parlement fédéral : Sabien Lahaye-Battheu et Ine Somers (Open VLD) proposent de « permettre aux donneurs et aux parents demandeurs de choisir parmi différentes gradations d’anonymat » ; Els Van Hoof et Sonja Becq (CD&V) souhaitent abolir l’anonymat du don ; Valerie Van Peel (N-VA) en appelle à la création d’un registre central pour la gestion des données relatives aux donneurs, avec la possibilité de communiquer aux enfants des données identifiables ou non, dans certaines conditions. Parmi les spécialistes de la procréation médicalement assistée (PMA), certains soutiennent ces propositions. D’autres s’y opposent, au nom du droit au secret médical des parents infertiles et par crainte d’une plus grande pénurie de dons. Ces questions sont actuellement pendantes à la Chambre et rien n’indique qu’elles seront encore abordées durant cette législature.
Un défi pour la Belgique
Avec son excellence médicale et sa loi non excluante, la Belgique est partie en tête dans la lutte contre l’infertilité. Mais aujourd’hui, notre pays pourrait se perdre dans les bois de la PMA s’il ne se demande pas d’abord où il va. Comment répondre à la demande croissante pour des dons d’ovocytes sans devoir recourir à des multinationales étrangères ou tomber dans l’« altruisme de marché » ? Quelles réponses apporter à ces enfants belges à l’ADN espagnol, qui s’interrogeront un jour sur les conditions de leur conception ? Comment assurer le bien-être à long terme des donneuses, tant médical que psychologique, en Belgique ou à l’étranger ?
Parmi les urgences, il y a aussi ce caillou dans nos bottes : tous les spécialistes de la PMA s’accordent pour dire que les femmes, même les plus éduquées, ignorent trop souvent les lois de la fertilité. Celle-ci diminue à partir de 35 ans, même si les règles surviennent normalement, et les femmes deviennent infertiles bien avant d’être ménopausées. Aujourd’hui, à 40 ans, on n’a plus l’air, comme nos ancêtres, de vieilles pommes sur le déclin. Certaines changent encore de conjoint, d’autres viennent à peine d’en trouver un ou obtiennent enfin qu’il s’engage. L’espérance de vie a bondi. Mais les ovaires n’ont pas suivi. Comment informer sur cette réalité sans culpabiliser les femmes ? Comment réfléchir à la pression sociale autour du fait d’avoir ou non des enfants ? Comment prendre en compte la maternité tardive comme un phénomène de société et non comme un caprice de business women qui « privilégient leur carrière » ? Peut-être y a-t-il là un défi à relever pour un pays pionnier…
Leah va avoir 40 ans. Malgré le recours à cinq donneuses, trois en Espagne et deux en Belgique (l’une via son blog, l’autre après de longs mois d’attente à l’UZ VUB), aucun des embryons qu’on lui a implantés ne s’est développé. Il lui en reste encore deux au frais… « Qui sait ? » Elle n’ose plus trop y croire… Pour la première fois depuis trois ans, Leah ne me parle plus de prises de sang, d’échographies ou d’antidépresseurs. Elle me raconte ses vacances, son envie de lever le pied, de se rendre utile. Son désir d’enfant est intact mais la vie l’oblige à repenser le modèle familial dont elle avait rêvé. Au passage, elle a peut-être appris à lâcher prise. Pour mieux escalader autre chose ? « Tu ne vas pas me croire, ajoute-t-elle, mais on a même reparlé de l’adoption… »