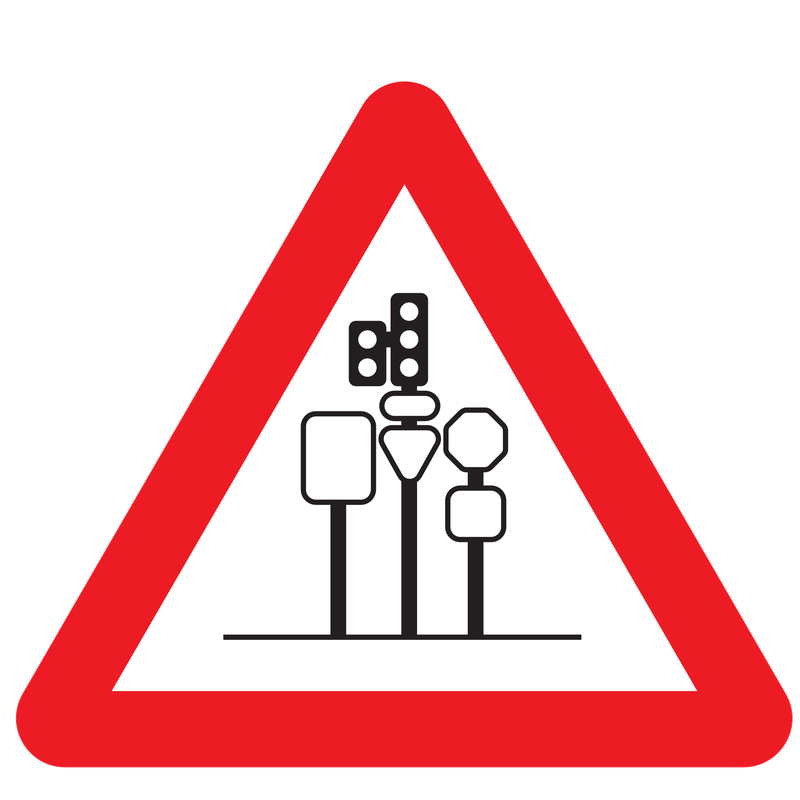Ça vous dérange si je relis ?
Enquête (CC BY-NC-ND) : Julien Bialas
Publié le

Faire relire une interview ou un article avant sa publication : de grandes institutions en font de plus en plus la demande. Un vrai casse-tête pour les journalistes.
Janvier 2019, les procureurs généraux diffusent une nouvelle circulaire pour organiser la communication du ministère public vers les médias. Extrait : « La convention (entre le journaliste et le parquet, NDLR) contiendra obligatoirement une clause permettant de censurer inconditionnellement le contenu du reportage (images, son, texte). Il en résulte que le magistrat presse peut faire effacer, ou interdire de diffusion, des textes, paroles ou images, sans avoir à en justifier la raison ou le fondement auprès de son interlocuteur. » Concrètement, si le journaliste n’accepte pas ces conditions, il ne peut rencontrer certaines personnes ou accéder à certains lieux. La justice assure que la circulaire ne concerne que les longs reportages et l’immersion, pour rassurer et protéger ses intervenants. L’Association des journalistes professionnels dénonce dans un communiqué « plusieurs dispositions particulièrement inquiétantes pour les journalistes et leur liberté d’informer ». Et rappelle que la censure préventive va à l’encontre de la liberté de la presse, inscrite dans la Constitution.
Donnant-donnant
Si cette circulaire et le mot censure choquent, les demandes de relecture et le droit de regard d’intervenants font partie du quotidien des journalistes. De grandes institutions, comme la police ou l’armée, établissent déjà des accords dans ce sens. Une pratique qui n’est pas idéale pour Muriel Hanot, secrétaire générale du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) : « Quand un accord préalable est conclu, le journaliste doit obligatoirement le respecter. S’il accepte une relecture, il concède une part de sa liberté éditoriale. Le code déontologique recommande d’éviter ces situations. » Mais ce n’est pas facile. « Ces demandes sont souvent informelles, remarque Frédéric Loore, journaliste d’investigation indépendant. C’est du donnant-donnant. Je peux faire mon reportage et, en échange, ils ont un droit de regard. Je ne les accepte que quand le reportage est en jeu. »
Erreur factuelle
Les journalistes sont-ils pour autant muselés par ces grandes institutions ? Éric Walravens, journaliste, assure que non : « Pour moi, ces conventions ne sont qu’un bout de papier qui ne limite en rien ma façon d’écrire. » Auteur d’une enquête sur les prostituées nigérianes dans le précédent Médor, il a signé une convention acceptant une relecture de la police afin que celle-ci s’assure du respect de la présomption d’innocence et de la dignité humaine notamment. « Cela ne fait que rendre plus explicites des précautions que je prendrais de toute façon. Je n’ai jamais modifié ou supprimé des propos. » Un constat que partage Frédéric Loore.
« Je n’ai jamais été censuré. Je modifie mon texte seulement s’il y a des erreurs factuelles, que des informations pourraient compromettre une enquête en cours ou que l’intégrité de personnes est menacée. Si elle ne relève pas d’erreurs factuelles, je refuse toute intervention. » D’ailleurs, il refuse les relectures hors de ce contexte et souhaite garder une relation de confiance avec ses intervenants. « Je m’engage à rapporter les propos de manière loyale et fidèle. Je n’accorde donc pas de relecture, sauf sur des éléments très techniques. » Une option qui n’est pas partagée par l’ensemble de la profession. Karl van den Broeck, rédacteur en chef d’Apache, autorise toutes les relectures, quel que soit le domaine. Pour lui, il s’agit même d’un droit implicite. « Si une personne veut relire son interview, j’accepte. Mais je n’envoie que ses citations et il ne peut y avoir des changements que sur la forme et en aucun cas sur le fond. Le dernier mot revient toujours au journaliste. »
En publiant sa dernière circulaire, la justice a affirmé vouloir faciliter la communication, notamment avec les journalistes. Mais ces conventions ne sont-elles pas, au contraire, les signes d’une frilosité – ou d’une envie de contrôle – croissante des grandes institutions ? Frédéric Loore et Karl van den Broeck s’accordent sur le fait qu’il devient compliqué d’avoir des échanges « off the record » (sans que leur contenu ne soit publié).
Les services de communication s’invitent partout. Frédéric Loore : « Avant, on pouvait parler beaucoup plus facilement avec un policier, un militaire ou un juge. Maintenant, ils sont briefés et ne peuvent plus nous rencontrer sans autorisation. » Constat partagé par Karl van den Broeck. « C’est le fléau des porte-parole. Il y en a partout, même dans de petites structures. Ils sont de véritables gardiens de portes. Ils décident qui dit quoi à qui. Les institutions se referment sur elles-mêmes. »
Pour les journalistes, il est parfois compliqué de refuser de signer une convention ou une demande de lecture. Les réponses sont à apporter au cas par cas. Muriel Hanot, du Conseil de déontologie, en est consciente : « Certaines sources sont incontournables et, si elles imposent des règles, cela devient difficile d’exercer le métier. Le mieux déontologiquement est d’essayer d’éviter des contreparties. C’est un travail compliqué, mais il y aura toujours des sources. Si un journaliste prend un engagement, il impacte toute la profession. » Confronté pour la première fois à une demande de convention écrite, il y a quelques mois, Frédéric Loore a réussi à négocier. « La police voulait avoir son mot à dire en cas de reprise de mon travail [par un autre média, NDLR] et exigeait une destruction des rushs non utilisés. » Après discussions, ces deux éléments ont été retirés. Si cela n’avait pas été accepté, je n’aurais pas fait ce reportage. Je peux me le permettre. Mais, pour d’autres journalistes, cela peut être plus délicat. » Et surtout, pourra-t-il encore négocier la prochaine fois ?