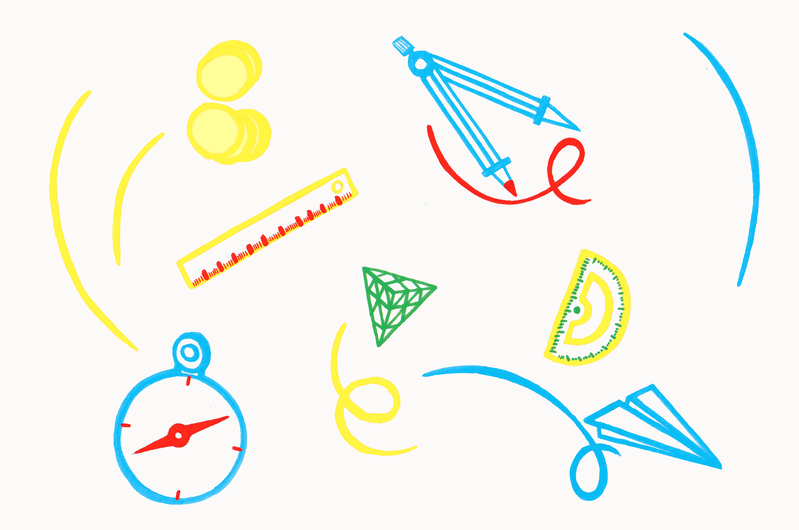[Ep 1/2] Réussir à l’école ? Tu vas le payer !
Épisode 1/2 : Laurent, le professeur qui dit « Stop »
Textes (CC BY-NC-ND) : Julien Winkel
Publié le

En Fédération Wallonie-Bruxelles, se rendre chaque jour à l’école et y travailler n’est pas toujours suffisant pour réussir. Qu’importe : de nombreuses solutions, payantes, s’offrent aux parents. Cours particuliers, études, coachs, la liste est longue. Médor a rencontré un professeur et une élève qui nous ont parlé de ces « cours en plus » qui mettent le portefeuille à forte contribution. Aujourd’hui, rendez-vous avec Laurent.
Le 2 mai dernier, alors que nous lancions un appel à témoignages sur les inégalité scolaires, Laurent nous a écrit :
« Enseignant dans une école d’excellence, d’élite (biffer les mentions inutiles), je suis à votre disposition pour témoigner sur l’inégalité scolaire. »
Jusqu’ici, Laurent avait réservé ses analyses tranchées à ses collègues ou à la direction de l’établissement d’enseignement secondaire catholique qui l’emploie. Aujourd’hui, il a décidé de s’exprimer plus ouvertement.
Une des explications à ce changement d’attitude tient dans une feuille posée juste devant lui. Il s’agit d’un document interne à son école. Au fil des lignes, on découvre l’histoire d’un gamin du secondaire dont les parents se sont endettés pour plus de 500 euros envers l’établissement scolaire. Avant de partir en laissant la note impayée. « Tout ça pour des études payantes », souffle l’enseignant.
1 500 euros par an !
C’est un fait : depuis des lustres, l’établissement où travaille Laurent organise des sessions d’études – surveillées ou dirigées – payantes à destination des élèves. Au mois d’août déjà, des cours de remise à niveau sont mis sur pied. Puis, dès la rentrée, les étudiants se voient proposer une étude surveillée par des professeurs, que ce soit après les cours ou durant les après-midi de sessions d’examens.
Mieux : ils peuvent aussi prendre part à une étude organisée toute l’année après 16h00 où des groupes d’enseignants et d’anciens étudiants répondent à leurs questions. Visiblement, ça marche. Dès octobre, les études commencent à se remplir de jeunes de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année.
Pour que leurs enfants puissent participer à ces activités, les parents doivent mettre le prix. De 3 à 8 euros la séance, selon l’option choisie. Des sommes qui peuvent paraître dérisoires mais qui, accumulées sur l’année, prennent parfois des proportions impressionnantes.
En 2016, une enquête menée par la Ligue des Familles notait qu’une année scolaire en secondaire général coûtait en moyenne 1 550 euros par élève. Une famille sur cinq ayant répondu à l’enquête déclarait faire appel à du soutien scolaire. Dans plus de 50 % des cas, le soutien s’effectuait au sein de l’école, parfois moyennant rémunération. En secondaire, les montants étaient compris entre 1 et 21 euros de l’heure.
Ces études organisées par l’école de Laurent sont censées aider les élèves (ce qu’est déjà supposé faire le programme de base..). Mais il y a un problème : parce qu’elles sont payantes, elles créent une fracture sociale au sein de l’établissement.
« On génère une inégalité au sein d’une même école entre, d’un côté, des élèves dont les parents peuvent se permettre de leur payer ces études et, de l’autre, des élèves dont les parents ne le peuvent pas et qui ont donc moins de chances de réussir », constate Laurent, avant de s’emparer d’une autre feuille. Il s’agit cette fois-ci d’un document qui est déposé dans le journal de classe de chaque élève.
Sur le papier à en-tête de l’école, diverses informations à destination des parents sont reprises : prix des études, horaires. Et une phrase, qui mentionne que le fait que les parents ne puissent pas payer la participation de leur enfant aux études ne doit pas empêcher celui-ci d’y participer. Ils sont dès lors invités à s’adresser à l’école…
La "honte"
Dans les faits pourtant, Laurent l’affirme, les parents font rarement cette démarche. Pourquoi ? Parce qu’à part la feuille glissée dans le journal de classe, l’école ne crie pas sur tous les toits qu’elle peut venir en aide aux parents plus fragiles économiquement. Or, ces derniers « ne lisent pas ce document. Ils ne savent donc pas. »
Ou, quand il savent, ils ont parfois honte. Demander de l’aide, c’est aussi prendre le risque de se faire pointer du doigt. À plus forte raison lorsque l’on est pauvre dans une école aisée… Pour cette raison, « de nombreux parents hésitent à faire appel à la solidarité, à l’aide de l’école, afin d’avoir accès aux études, c’est clair », soupire Laurent.
Ces deux situations sont des classiques du « non recours aux droits », phénomène où une personne ne bénéficie pas des prestations sociales auxquelles elle a pourtant droit.
En 2017, un document du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (1) notait que la méconnaissance de leurs droits par les bénéficiaires potentiels pouvait expliquer une grande partie des non-recours.
Autre explication mentionnée : le sentiment de stigmatisation qui, d’après le document, engendre « un refus de demander un droit en raison du stigmate qui lui est accroché, dont la perception est vécue comme une procédure d’étiquetage et de catégorisation, comme la marque d’une disqualification sociale ou comme l’indice d’un déclassement »…
Soit se résigner, et ne pas inscrire leur enfant aux études payantes, quitte à lui donner moins de chances de réussite. Ou alors l’inscrire, risquer de ne pas pouvoir payer, et voir une société de recouvrement frapper à leur porte.
Certaines écoles font effectivement appel à ce type d’opérateur pour récupérer leur dû auprès des parents mauvais payeurs. C’est le cas de l’établissement où travaille Laurent. Une pratique qui semble gagner en importance.
TCM Belgium, une société de recouvrement qui traite la majorité des dossiers ouverts pour le compte d’écoles en Belgique, est ainsi passée de 16624 factures « scolaires » en 2015 à 23752 en 2019, pour un total de 95180 factures sur ces cinq années. Le tout pour le compte de plus de 1000 écoles. D’après TCM Belgium, cette augmentation n’est pas due au fait que les parents paient moins bien qu’avant. Il y a juste plus d’écoles qui ont recours à ses services ces dernières années…
En toute légalité
Mais que cherchent-ils, ces parents qui inscrivent leurs enfants aux études organisées par l’école de Laurent ? Du soutien, surtout, dans un milieu scolaire où tout va parfois très vite et où on n’a pas toujours le temps de s’occuper au mieux des élèves durant les cours.
En face d’eux, lors des études où il leur est loisible de poser des questions, les élèves trouvent non seulement des professeurs, mais aussi des étudiants, des enfants de la direction ou d’enseignants « qui ne sont bien évidemment pas porteurs de titres ou de diplômes d’enseignement ». Tous sont payés via les « cotisations » des parents. Et au passage, l’école réalise également un bénéfice.
Laurent ne jette pas un regard trop sévère sur les professeurs qui participent à ces études. En Fédération Wallonie-Bruxelles, faire carrière dans l’enseignement ne rapporte pas des fortunes. Au 1er février 2020, un enseignant « isolé » nommé en secondaire inférieur gagnait 2119,09 euros par mois s’il comptait 11 ans d’ancienneté. 1801,51 euros s’il débutait sa carrière. De quoi donner des idées…
Par contre, lorsqu’il évoque l’école, Laurent se fait plus grave :
« Elle dit que l’argent gagné via les études sert à compenser les factures que certains parents ne paient pas ou encore à payer l’électricité ou le chauffage. Mais il est très difficile d’identifier clairement les entrées et le sorties dans le budget de l’école. Quant au pouvoir organisateur, il vous dira qu’il s’agit du seul moyen pour financer correctement notre école suite au sous-financement de l’enseignement libre par la Fédération Wallonie-Bruxelles. »
Effectivement, voilà des années que l’enseignement libre se plaint d’être sous-subventionné par rapport aux établissements organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (Segec) estime que l’écart de financement entre les écoles du libre et celles organisées par la FWB serait en moyenne de 50 %. Dans un arrêt rendu début octobre, la cour constitutionnelle vient d’ailleurs d’invalider une dérogation qui permettait à la FWB de prolonger sans justification cette inégalité jusqu’en 2038. La Cour donne jusque fin 2022 au législateur francophone pour adopter de nouvelles règles.
Rien d’illégal
Il n’empêche, cette situation de sous-financement incite les écoles comme celles de Laurent à multiplier les activités payantes, les fancy-fair et autres… études payantes pour renflouer les caisses, en toute légalité. Car ce qui est finalement le plus surprenant, c’est que la plupart de ces études payantes n’ont rien d’illégal.
Rien n’empêche en effet une école de réclamer de l’argent pour une activité qu’elle organise après les cours, au risque de pénaliser la frange de son public ayant plus de difficultés financières.
« Par contre, ce qui est illégal, c’est l’organisation par notre école d’études payantes les après-midi pendant la session d’examen. S’il est possible de suspendre les cours pendant cette période, les enfants doivent alors pouvoir être encadrés pédagogiquement et… gratuitement. Peut-être qu’à la lecture des frais réclamés, certains parents hésitent à inscrire leur enfant chez nous. Il s’agit peut-être aussi d’une manière de sélectionner une certaine élite sociale », précise Laurent.
Avant de conclure. « Mon établissement va se défendre en disant qu’il peut agir de la sorte. Mais on parle d’une école, de quelque chose de public ! Pour moi, les études doivent être organisées gratuitement. La réussite ne peut en aucun cas être le fruit d’études supplémentaires tarifées… »
(1) « Pauvreté et ineffectivité des droits, non-recours aux droits », Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, die Keure/la Charte, 2017.
Demain, ne manquez pas l’épisode 2 de cette mini-série : une rencontre avec "Lily, l’élève qui n’a pas eu le choix".