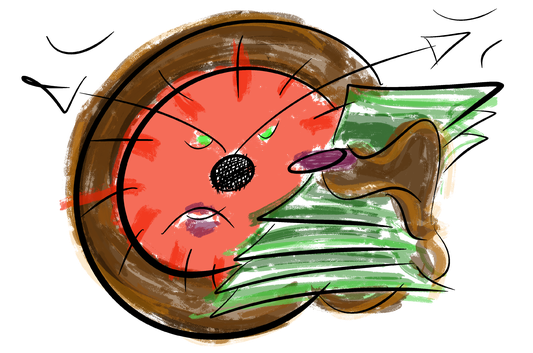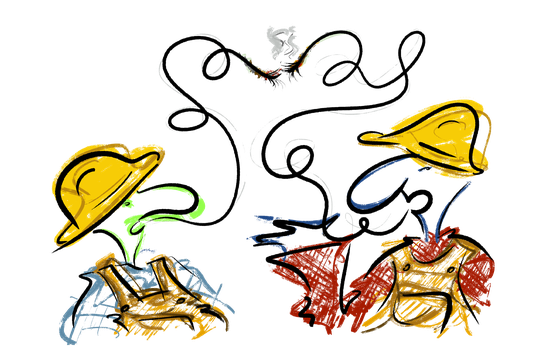- ép. 7
« Qu’il y ait tant d’accidents du travail doit nous alerter »
Interview de la sociologue Véronique Daubas-Letourneux. Episode 7/7
Illustration (CC BY-NC-ND) : Mariavittoria Campodonico
Enquête (CC BY-NC-ND) : Julien Bialas & Louis Van Ginneken
Publié le

« Un accident du travail n’est pas un fait divers mais un fait social. » La Française Véronique Daubas-Letourneux, l’une des meilleures spécialistes des accidents du travail, le martèle : pour agir sur les accidents du travail, il faut arrêter de les considérer comme causés par celui ou celle qui en est la victime.
« Les accidents du travail sont dus au travail. » Une phrase d’apparence simple, déposée page 171 du livre « Accidents du travail, des morts et des blessés invisibles », de la sociologue Véronique Daubas-Letourneux. Une phrase simple qui, pourtant, redéfinit le cadre du sujet : on ne peut pas comprendre les accidents du travail en dehors du contexte dans lequel ils se produisent.
Généralement perçus comme des « erreurs humaines » ou des fatalités sur lesquelles on ne peut agir, les causes des accidents du travail sont en réalité tout autres : le contexte, les choix d’organisation du travail et le manque de prévention.
Pour nous inviter à déplacer notre compréhension du phénomène, Véronique Daubas-Letourneux donne la parole à ceux qui n’ont, depuis bien longtemps, plus voix au chapitre : les victimes. En rassemblant leurs récits, elle dresse un tableau implacable : les accidents du travail sont tout sauf des événements isolés et individuels.
« Un accident du travail n’est pas un fait divers, mais un fait social. » Cette phrase est l’une des premières de votre livre. Pourquoi était-il essentiel de le rappeler ?
Aujourd’hui, les accidents du travail sont traités comme un fait divers dans la presse quotidienne. Ou alors, on analyse les pertes et les chiffres lorsque les statistiques annuelles tombent. On n’interroge pas la connotation sociale des accidents du travail, ni le fait qu’ils sont très inégalement répartis. Une fois ce constat fait, deux questions se posent naturellement. Quel est le travail qui se cache derrière ces accidents ? Pourquoi ces accidents arrivent-ils ?
Le terme « accident » est-il un obstacle à la bonne compréhension du phénomène ?
On parle d’accident parce que l’événement est défini par son caractère soudain. Le moment précis de la lésion peut être défini, ce qui permet de le distinguer de la maladie professionnelle. Mais on sait que les mots jouent sur notre interprétation et notre compréhension du phénomène. Dans les esprits, le sens du mot « accident » est fort relié à celui de « hasard ». On évoque un accident du travail comme on évoque un accident de la vie ou de la circulation. En évoquant le manque de chance, les accidents du travail sont moins remis en question. Le terme « accident » n’aide pas à appréhender ce phénomène de manière politisée.
C’est pour cela que, selon vous, un accident du travail est « un processus dans un processus » ?
Il faut relativiser l’idée de la soudaineté qui définit l’accident. Parfois, il y a eu des signes avant-coureurs, comme la survenance d’autres accidents. L’accident est aussi inscrit dans une durée plus longue que l’instant T. La lésion qui apparaît suite à l’accident s’inscrit dans un processus long. Elle ne s’arrête pas au moment où la personne se blesse ou au moment où l’accident est reconnu. Cela se prolonge dans un processus de soins. Des accidentés en gardent parfois des séquelles. Le retour au travail peut être difficile ou doit être adapté. Tout cela prend du temps.
Vous qualifiez certains accidents du travail de mort sociale…
Un accident du travail peut entraîner la victime dans une spirale infernale. Conduire à la perte de l’emploi, à une perte de revenus, avec des répercussions importantes sur la vie privée. La mort sociale, c’est une expression forte, mais l’idée, c’est qu’on est face à des personnes qui ont été détruites par la survenue d’une blessure provoquée par le travail. Le coût humain peut être considérable.
Votre livre rassemble de nombreux témoignages d’accidentés. De quelle manière permettent-ils de comprendre cette problématique ?
Les statistiques peuvent être porteuses d’enseignements, mais il faut regarder comment elles sont construites et avoir conscience de leurs limites. Le reste, c’est mon travail de sociologue. J’évoque l’invisibilisation des accidents du travail, il était donc normal que j’interroge les premiers concernés. On ne les entend jamais. Cette parole, on ne peut l’obtenir qu’en faisant des entretiens. Elle permet, par exemple, de constater l’écart entre le travail prescrit et le travail réel. On peut avoir des consignes de sécurité fixées au mur, mais, dans la réalité, pour tenir le délai, tout le monde enfreint ces règles.
Quels sont les mythes à casser ?
Tout l’enjeu, c’est de s’interroger sur l’organisation du travail et de la remettre en question pour sortir de cette vision d’une victime qui l’aurait bien cherché ou qui aurait manqué de prudence. Les prises de risque et les contraintes sont parfois complètement intériorisées et il faut, selon moi, examiner l’organisation du travail qui se cache derrière.
C’est-à-dire ?
Le travail moderne est marqué par une très forte intensification, que ce soit dans les services ou dans l’industrie. Aujourd’hui, notre organisation du travail incite à produire plus avec moins. Ce n’est pas une gestion durable des ressources humaines. C’est important d’être bien dans son travail, on y construit des liens. C’est une activité sociale centrale. Mais le fait qu’il y ait tant de maladies professionnelles et d’accidents doit nous alerter.
Notre organisation du travail n’accorde plus de temps à la transmission du savoir-faire. On ne valorise pas l’expérience des anciens et les jeunes travailleurs doivent être directement opérationnels. De la part du collectif, il faudrait plus de transmission, d’expérience et de formation. Il faut aussi intégrer davantage les travailleurs dans l’analyse des accidents, dans les démarches qui visent à comprendre comment ils surviennent pour mieux organiser la prévention. Ce qui est fait aujourd’hui n’est pas suffisant.
Pourquoi ce sujet est-il aujourd’hui dépolitisé ?
Puisqu’il y a une automatisation de la prise en charge, on s’intéresse moins aux causes de l’accident et aux réponses à apporter pour les prévenir. Ce compromis entre le monde patronal et ouvrier, appelé « paix sociale » par certains historiens, a contribué à la dépolitisation. Dès qu’on met en place un système d’indemnisation automatique, des logiques plus individuelles d’accès aux droits sont encouragées, aux dépens de logiques collectives de lutte contre les causes.
Un silence surprenant est celui des syndicats…
Dans les années 70, à une époque où les taux d’accidents étaient élevés, il y avait des mobilisations très fortes. Ce qu’on peut observer aujourd’hui, c’est que les enjeux de santé au travail ne sont pas simples à mettre en avant. Les syndicats se mobilisent sur des questions de préservation de l’emploi, de pouvoir d’achat et de salaires. La question de la santé contre l’emploi traverse toute l’histoire syndicale. Il y a toujours la crainte que les améliorations apportées sur le plan de la sécurité entraînent un coût qui pourrait nuire à l’activité de l’entreprise… Résultat, au nom de l’emploi, tout est justifiable et on accepte des conditions de travail délétères.