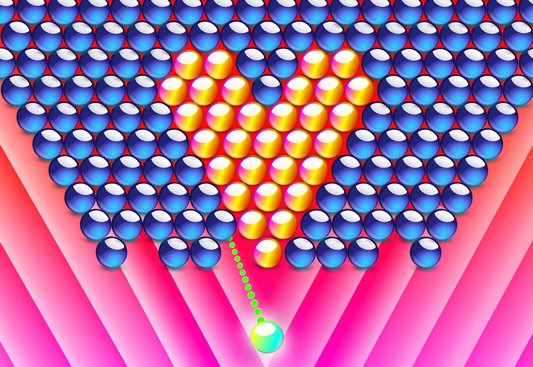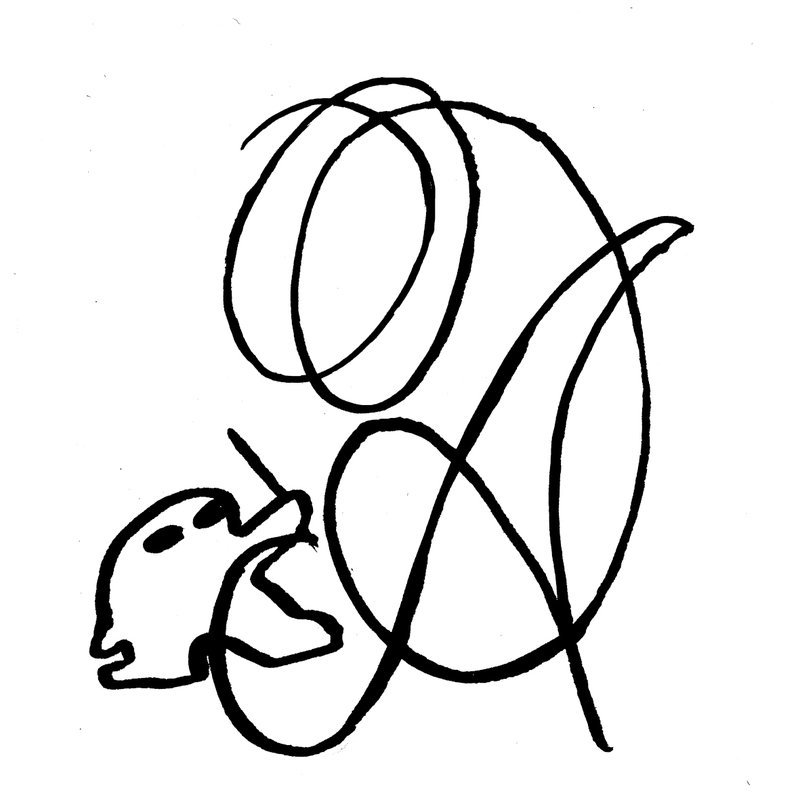Cauchemar à Istanbul
Esila Ayik, emprisonnée en Turquie
Photos : Jelle Vermeesch & Esila Ayik
Traduction : Thomas Lecloux
Interview : Ayfer Erkul (Humo)
Publié le
Elle ne répondra pas à des questions du type « Erdogan est-il un dictateur ? », nous a prévenus Esila Ayik, 22 ans. Cette étudiante gantoise en photographie a passé cinq semaines dans une prison turque en avril 2025. Libérée à la suite de pressions internationales, elle reste contrainte de surveiller ses propos, étant toujours sous le coup d’une peine de 4 ans et 8 mois d’emprisonnement. « Comment les Turcs de Belgique peuvent-ils voter pour Erdogan ?, enrage-t-elle. C’est à cause d’eux que j’ai été emprisonnée. »
Interview parue dans Humo.

Vous avez été arrêtée le 8 avril après avoir participé à une manifestation de soutien à Ekrem Imamoglu, le maire d’Istanbul, qui avait été emprisonné peu avant.
Imamoglu est la énième figure d’opposition à se retrouver derrière les barreaux en Turquie. Il est très populaire, surtout auprès des jeunes. Sa réélection comme maire, l’année dernière, a porté un coup à Erdogan, dont il est devenu en peu de temps le principal rival. Beaucoup de mes amis ont participé aux manifestations qui ont suivi son arrestation. Certains ont été arrêtés puis rapidement relâchés. J’étais révoltée et me sentais en même temps un peu coupable : pendant qu’eux descendaient dans la rue, je vivais ma petite vie confortable en Belgique.
Vous êtes alors partie à Istanbul pour prendre part aux manifestations.
Pour rendre visite à ma famille, en fait. Mon billet était réservé depuis des mois. Mais une fois sur place, je me suis senti le devoir de participer. Je suis allée avec des amis à un concert de solidarité qui a rassemblé 6 000 personnes, essentiellement des étudiants. J’ai voulu faire des photos – en veillant à ne pas photographier de visages. Beaucoup de gens tenaient des banderoles et des pancartes aux slogans tels que « Erdogan dictateur ».
La police turque, qui n’hésite pas à faire usage de gaz lacrymogène ou de balles en caoutchouc, était aussi présente en masse.
Ils étaient tantôt plus nombreux que les manifestants. Quel besoin y avait-il de déployer autant de policiers ? Que pouvaient bien des étudiants et quelques banderoles face à leurs armes et leurs canons à eau ? J’ai commencé à photographier les policiers. Avec le flash, en plein visage. Ils criaient « Pas de photos ! », mais je continuais. Je savais que je m’exposais, mais je m’en fichais. Quand j’ai eu suffisamment de photos, j’ai saisi une banderole. Je n’ai pas couvert mon visage comme le faisaient certains autres. Je pensais n’avoir rien à craindre : j’allais de toute façon m’envoler vers la Belgique une semaine plus tard.

Avez-vous été arrêtée tout de suite ?
Non. Mais j’ai bien remarqué qu’on me tenait à l’œil. J’ai même apostrophé une femme qui prenait des photos de moi avec son téléphone. Elle a prétendu être journaliste pour un magazine féministe, mais n’a pas su me dire lequel. Peu après, elle s’est évaporée. Je suis certaine que c’était une policière en civil. Plus tard, la police a commencé à contrôler les identités, et a relevé la mienne. D’autres manifestants ont fui à ce moment-là, mais moi pas. Je trouvais que je n’avais rien fait de mal. Cette nuit-là, je devais loger chez une amie. À minuit, mon père m’a téléphoné pour me dire que la police était à sa porte et me demandait une déposition. J’ai alors appelé moi-même la police et demandé si cela ne pouvait pas attendre le lendemain. J’avais un rendez-vous à l’hôpital et je pourrais me présenter ensuite. Mais on m’a assuré qu’il n’y en aurait pas pour longtemps. Ils sont venus me chercher peu après chez mon amie. J’étais convaincue que je serais de retour au bout de quelques heures. Je suis même restée en pyjama.
Quand avez-vous compris qu’ils ne voulaient pas qu’une déposition ?
Dans la voiture, quand ils sont allés d’abord à l’hôpital. On m’a examinée et les policiers ont reçu un document certifiant que je n’avais pas été maltraitée. À l’arrivée au poste de police, j’ai été menottée dans le dos. « Procédure », m’ont-ils dit. Puis ils m’ont emmenée tête baissée dans le bâtiment. Quelqu’un filmait même la scène. Comme si j’étais une baronne de la drogue. J’ai pu appeler mon père, mais ils ont ensuite refusé que j’appelle un avocat. Je n’avais droit qu’à un coup de téléphone. Là, ils m’ont assaillie de questions : « Pourquoi tu tenais cette banderole ? », « T’as rien dans la tête, ou quoi ? », « Tu savais pas lire ce qui était écrit ? » Ils m’ont aussi mis des photos d’autres manifestants sous le nez : « C’est qui, ça ? », « Tu le connais ? », « Ne mens pas ! » Je ne leur ai rien dit. Ce n’est que le matin, quand l’avocat pro deo est arrivé, que j’ai pu faire ma déposition.
COMME DES ANIMAUX
Mais vous n’avez pas été libérée pour autant.
J’ai été emmenée dans une cellule obscure et répugnante. Les six heures que j’ai passées là m’ont semblé soixante jours. J’ai comparu devant le juge le jour même. Mon avocat m’avait assuré que je serais libérée dans l’attente d’un procès. Au lieu de cela, j’ai été arrêtée sur-le-champ pour insulte au Président et mon audience a été fixée à décembre. Ils m’ont enfermée dans une cellule avec 15 autres femmes. On recevait des assiettes de riz, mais pas de couverts. J’ai demandé au garde une fourchette ou une cuillère. « Nous sommes des êtres humains, ne nous faites pas manger comme des animaux », ai-je supplié. « Des êtres humains ? Vous n’avez rien d’humain », a-t-il rétorqué.
Les autres détenues avaient-elles aussi été arrêtées lors des manifestations ?
Si seulement ! Les jeunes arrêtés en même temps que moi avaient tous été placés ensemble. Moi, je me suis retrouvée au milieu de meurtrières, de voleuses et de trafiquantes de drogue. Je ne sais toujours pas pourquoi. Le lendemain, on m’a emmenée dans une unité où s’entassaient déjà 52 femmes. Beaucoup dormaient par terre, faute de place. Il y avait deux salles de bains en tout et pour tout. Le premier jour, je n’ai pas cessé de pleurer. J’étais certaine de ne jamais pouvoir rentrer en Belgique et de devoir faire une croix sur mes études. Puis j’ai commencé à parler avec les autres détenues, à leur demander pourquoi elles avaient commis leurs méfaits. Beaucoup avaient agi par pure nécessité. Il faut savoir qu’un grand nombre de familles sont tombées dans la pauvreté, ces dernières années. Certaines de ces femmes m’ont dit qu’elles n’avaient pas de quoi acheter du lait ou du pain pour leurs enfants et étaient donc contraintes de voler. Cela a apaisé la crainte que j’avais d’elles.
Pendant ce temps, votre état de santé se dégradait.
Je suis atteinte du syndrome néphrotique (une déficience rénale qui cause une forte perte de protéines par les urines, NDLR). Avant d’être incarcérée, je perdais 500 milligrammes de protéines par jour, la norme étant de 150 milligrammes. Là, j’en étais à 2 grammes. J’ai aussi ce qu’on appelle une bicuspidie aortique, une malformation qui crée un risque d’insuffisance cardiaque. Je dois éviter les émotions fortes et surveiller mon alimentation. Je suppliais les gardes de me donner mes médicaments et je ne comprenais pas pourquoi ils refusaient. J’ai eu plusieurs fois du sang dans les urines, parfois même de la mousse. Ils s’en moquaient complètement. Mes codétenues n’étaient pas étonnées. L’une d’elles n’avait pas reçu ses médicaments contre l’hypertension depuis neuf mois. Elle mâchait des gousses d’ail pour se soulager. De plus, les conditions d’hygiène laissaient fortement à désirer, si bien que j’ai attrapé la gale par-dessus le marché.

Votre situation a été suivie de près dans les médias turcs et belges. Cela a-t-il aidé ?
Je pense que oui. Quand ils ont vu que je recevais des visites de politiques de l’opposition, les gardes se sont dit que je devais être quelqu’un d’important. Au bout d’une semaine, j’ai enfin reçu mes médicaments. Ils m’ont alors mis sous le nez un document disant que je les avais reçus dès le premier jour. Pour se couvrir. J’ai refusé de signer.
Pendant votre incarcération, le 23 avril, Istanbul a été secouée par un tremblement de terre.
De magnitude 6,2 sur l’échelle de Richter. C’était hallucinant. Tout tremblait. À la télévision, ils recommandaient de sortir immédiatement, car il risquait fortement d’y avoir de puissantes répliques. Mais nous ne pouvions évidemment pas sortir. Nous avons frappé et frappé à la porte, en panique. Jusqu’à nous résigner à attendre notre sort. Les gardes, eux, avaient bien suivi la recommandation. Ils ne sont revenus que bien plus tard. Je me sentais déjà très mal à ce moment-là. Mon cœur s’emballait, j’avais des vertiges, j’étais faible. Les gardes ont d’abord refusé de m’emmener à l’hôpital, mais mes codétenues ont protesté. « On parle de cette fille tous les jours dans le journal », ont-elles crié. « Si vous ne la soignez pas maintenant, vous aurez bientôt tous les médias internationaux sur le dos. » Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on m’a conduite à l’hôpital.
Pouviez-vous avoir des contacts avec votre famille ?
Je pouvais appeler pendant dix minutes trois fois par semaine. Sur écoute. Mon père critiquait beaucoup les autorités turques. Je n’embrayais pas : j’ai souvent parlé de notre chat (rires). Il y avait un risque qu’ils arrêtent aussi mon père. De plus, mes avocats m’avaient prévenue que ma détention préventive pouvait être prolongée si je faisais des déclarations politiques.
Vous aviez plusieurs avocats ?
Il existe une équipe de crise qui rend visite et apporte une aide aux détenus comme moi. Des milliers de volontaires transmettent toutes les informations sur les personnes arrêtées via WhatsApp. Ils sont absolument indispensables : n’importe qui peut être arrêté sans la moindre raison en Turquie.
Vous avez comparu le 15 mai. Le procureur demandait que votre privation de liberté soit prolongée.
Mais le juge ne l’a pas suivi. Étrange, car à peine une semaine plus tôt, mon maintien en détention avait été confirmé au moins jusqu’à début juillet, ce qui voulait dire que je ne pourrais pas passer mes examens et devrais donc potentiellement redoubler mon année. Dans mes lettres, j’écrivais que je n’avais pas perdu espoir, mais au fond de moi, j’étais brisée. Puis, soudain, j’ai été libérée. Je ne sais pas exactement ce qui s’est joué dans les coulisses.
À LA RUE
Quatre jours plus tard, vous êtes rentrée en Belgique, où vous attendait une nouvelle douche froide : vous étiez à la rue.
Quand la nouvelle de mon arrestation est sortie dans les médias, la famille turque qui me logeait a demandé à mes amis de venir chercher mes affaires. Je pense qu’ils étaient mis sous pression par leur entourage. On sait qu’une grande partie de la diaspora turque en Europe soutient Erdogan, et cela se sent aussi à Gand. Ce qui se disait de mon cas, c’était que l’affaire n’était pas si grave. « Elle n’a qu’à purger sa peine. » « Quel service rend-elle au pays en insultant ainsi Erdogan ? » « Quelques mois de prison, ce n’est tout de même pas la mort. »
Aujourd’hui, recevez-vous encore souvent des critiques de la communauté turque ?
Non. Je garde mes distances avec les partisans d’Erdogan. On ne peut pas discuter avec eux. Ils sont beaucoup trop conservateurs. Ils vous lancent tout de suite une tonne de reproches.
Comprenez-vous que les Turcs de Belgique votent en masse pour Erdogan ?
Absolument pas. Si je vis toujours en Belgique dans cinq à dix ans, je ne voterai plus aux élections turques. Je trouve que je n’en aurai plus le droit. Grâce à la diaspora turque en Europe, Erdogan a pu remporter élection après élection. Énormément de gens l’ont très mauvaise en Turquie. C’est mon cas aussi. Nous en subissons les conséquences. Leur vote m’a directement menée en prison. Ici, les Turcs vénèrent Erdogan et pensent que la Turquie est un paradis, mais ils ne connaissent pas le pays. Ils critiquent mon style vestimentaire et la couleur de mes cheveux, mais ne savent pas qu’à Istanbul, la moitié des jeunes femmes s’habillent comme moi. Ils n’ont pas idée de la situation économique. Je les mets au défi d’aller habiter un mois en Turquie et de vivre de ce que les gens gagnent là-bas. Beaucoup ne tiendraient pas le coup.
Erdogan est au pouvoir depuis 23 ans. Vous n’avez jamais connu que lui à la tête du pays.
Quand j’étais enfant, je voyais très peu mon père. Il était ouvrier et travaillait souvent 12 heures par jour, y compris le week-end. Il était déjà parti quand je me réveillais le matin et pas encore rentré quand je me couchais le soir. Mais Erdogan, lui, était toujours là. Vous allumiez la télé, il était en plein discours. Dans la rue, son portrait s’affichait en grand un peu partout. À l’école, ça parlait encore de lui. Je voyais et entendais Erdogan plus que mon propre père. Ma génération a grandi avec lui. Il aurait pu être un exemple pour la jeunesse, voire une figure paternelle. Mais il n’a fait que soulever notre colère. Plutôt que d’arrêter des étudiants, il devrait se regarder dans un miroir, lui et son parti, et se demander pourquoi les jeunes sont tellement en rage.
Pourquoi le sont-ils ?
Je n’ai pas eu de véritable enfance. Je ne m’en suis rendu compte qu’à 16 ans, quand je suis partie en échange scolaire en Alaska. Là-bas, les jeunes étaient heureux, s’amusaient, riaient. En Turquie, vous baignez très tôt dans des considérations politiques et économiques, vous ne pouvez pas y échapper. Un enfant d’ouvrier, ou même de fonctionnaire, est très vite mis à contribution pour soutenir la famille.
Vous y avez consacré un livre, à seulement 18 ans : « Z Bakis » ou « Le regard de la génération Z ».
Un cri de détresse sur les problèmes des jeunes en Turquie. Beaucoup de jeunes, dont moi, ne veulent plus y vivre. Je ne voulais pas faire mes études en Turquie parce que le système d’enseignement y est pourri. Si vous étudiez la photographie, comme c’est mon cas, il n’existe pas de studio convenable et le matériel d’apprentissage est rare. Vous pouvez terminer des études de cinéaste sans jamais avoir mis les pieds sur un tournage. Sans compter qu’une jeune femme n’y est en sécurité nulle part. À Istanbul, il est devenu presque impossible de marcher dans la rue après 22 heures sans être importunée, entre les automobilistes qui vous lancent des obscénités et les passants qui vous fixent le décolleté… Et le monde politique en rajoute une couche. Récemment, Hüda Par, un parti islamiste, a introduit une proposition de loi qui cible la communauté LGBTQ. Ils veulent criminaliser les rapports homosexuels et l’expression de l’homosexualité. Des débats ont eu lieu au parlement pour savoir si deux filles se tenant la main dans la rue pourraient tomber sous le coup de cette loi. Il vient d’être décidé que les femmes de moins de 25 ans doivent obligatoirement être mariées pour pouvoir consulter un gynécologue dans un hôpital public. Celles qui ne le sont pas n’obtiennent plus de rendez-vous. Voilà à quoi s’occupent les politiques en Turquie.
Erdogan ne pourra normalement plus se présenter aux élections présidentielles de 2028. Mais beaucoup craignent qu’il modifie la Constitution à son avantage.
Cela se pourrait. Il se pourrait aussi qu’il perde ces élections. Tout est possible en Turquie. Mais même si un très bon candidat devait être élu, il nous faudrait encore au moins dix ans pour réparer le traumatisme et les dégâts causés par ce gouvernement.

Gardez-vous espoir malgré tout ?
Depuis ma libération, j’ai un regain de confiance en l’avenir de la Turquie, car si compliquée soit la situation, un réel mouvement peut être enclenché si la société se rassemble. On le voit bien avec ces manifestations, qui sont toujours en cours. J’ai des amis en Turquie qui soutiennent Erdogan. Même eux ont reconnu, après mon arrestation, que ces pratiques étaient intolérables. L’un d’eux m’a même écrit une lettre pour s’excuser d’avoir soutenu Erdogan tout ce temps.
Retournerez-vous en Turquie ?
Mon procès est prévu pour décembre. Je risque toujours d’être renvoyée en prison. Mais je voudrais tout de même retourner en Turquie après mes examens. Quand j’ai été arrêtée, je n’y étais que depuis une semaine. J’avais apporté du chocolat et de la bière pour mes amis et je n’ai pas pu les leur donner. Mais j’attends d’avoir disparu de l’actualité et que la situation se soit calmée.
Et après vos études ?
Je ne vois pas mon avenir en Turquie, à mon grand regret. Je pourrais pourtant y faire carrière comme photographe et bien gagner ma vie. Mais je ne serais jamais libre.
Ce papier a initialement été publié dans l' ;édition du 9 juin 2025 de Humo.