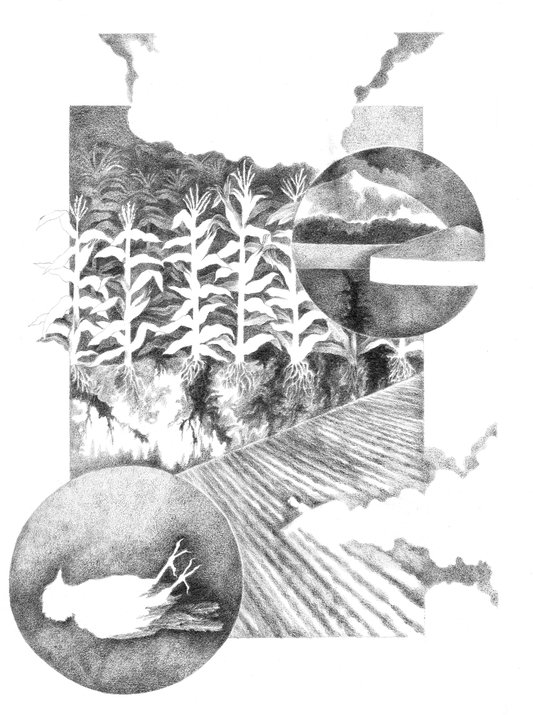Le logement, c’est notre problème
Interview de Sarah De Laet et Aline Fares

Pourquoi les loyers sont-ils si élevés ? Comment se loger dignement ? Qui dessine nos lieux de vie ? Sarah De Laet et Aline Fares étudient la mécanique de la promotion immobilière, montent sur les planches pour vulgariser leurs analyses et tendent le poing au sein de collectifs engagés. Retour à l’essentiel : « Le logement est un droit. » La propriété privée, « une narration difficile à défaire ». On change ?
En quelques études chiffrées et autant de coups de griffe, Sarah De Laet, une géographe issue de l’ULB, et Aline Fares, ex-banquière chez Dexia, bousculent les spéculateurs. L’une est balèze dans l’analyse des villes. L’autre apporte sa compréhension des flux massifs de capitaux. Au sein de deux collectifs, Action Logement Bruxelles et le Front Anti-Expulsions, elles unissent leurs forces face aux promoteurs qui ont reçu carte blanche de la part des politiques. Et elles s’opposent à la pensée dominante selon laquelle la propriété privée amène du bonheur même quand on a peu d’argent. À propos du logement et de la spéculation, elles se livrent sur scène lors de « conférences gesticulées », complices, théâtrales : leur non-verbal colle à leurs idées. Le logement, c’est politique, disent-elles. C’est un bien qu’il faut gérer de manière collective.
Dans vos conférences, vous dites qu’avoir un logement, c’est une réponse à notre besoin de sécurité, c’est ontologique, ça relève de notre être. Vous pouvez expliquer ?
Les mots viennent d’un livre extraordinaire – In defense of housing – écrit par deux Anglais. Ils estiment que, parmi tous les éléments dont on a besoin pour se sentir « ontologiquement en sécurité », le logement est essentiel. Pas juste avoir un toit sur la tête, mais savoir que ça va durer.
Je travaillais chez Dexia au moment de la crise financière de 2007-2008. J’ai été marquée par la vision de ces centaines de personnes qui se retrouvaient à vivre dans leur voiture aux États-Unis, puis même chose en Espagne ou en Hongrie. Les subprimes, c’était ça : les banquiers avaient vendu des crédits hypothécaires à des gens qui ont tout perdu. Plus aucune sécurité pour eux.
Quel est l’état du logement en Belgique ?
Finalement, on n’en sait pas grand-chose depuis 2001. C’est la date du dernier recensement « papier », où des questions précises avaient été posées à tous les Belges. Du genre, disposez-vous d’un w.c. individuel, combien de pièces y a-t-il dans votre logement, quel est le nombre de chambres, quel est le montant de votre loyer ? Depuis lors, pour des raisons budgétaires, il n’y a plus eu de recensement d’une telle ampleur. Le gouvernement fédéral se prive d’un tableau de bord.
Aujourd’hui, sur la base des données disponibles, tout de même, quels sont les chiffres clés à retenir ?
Dans les grandes villes, la situation du logement est particulièrement dramatique. À Bruxelles, où environ 60 % des ménages sont locataires, 35 000 ménages occupent actuellement un logement social et 51 000 en attendent un. En moyenne, le délai d’attente est de douze ans. Un peu moins d’un ménage bruxellois sur 100 se fait expulser chaque année. Cela fait quand même 5 000 expulsions de familles par an ! Selon l’Observatoire bruxellois de la santé et du social, 37 % d’enfants vivent dans un logement insalubre.
À quel niveau se situent les prix de l’immobilier ?
À Bruxelles, ils ont énormément augmenté. De 2004 à 2020, soit en quinze ans, leur hausse est de 30 %. Anvers ou Gand sont dans le même cas. Charleroi et Liège commencent à monter très, très fort aussi. Liège s’est pris une volée de bois vert après les inondations. Les loyers y ont augmenté de 16 % en un an parce que les gens dans la difficulté ont besoin d’un logement.
Les besoins sont criants. Il faut des moyens pour affecter du logement aux personnes mal logées, rénover tout ce qui est inhabitable, organiser la réquisition de bâtiments mal utilisés ou appartenant à des marchands de sommeil… Mais on ne voit rien venir. Dans les faits, l’économie capitaliste est là pour perpétuer la propriété privée.
Des dispositifs légaux permettent de réquisitionner des logements vides, insalubres ou qui sont aux mains de marchands de sommeil. Pourquoi ne le fait-on pas ?
Dans notre société, contraindre la propriété, la limiter ne fait pas partie du projet politique. Si on parle de réquisition, par exemple, il y a un outil à la disposition des communes, leur permettant de préempter un bien quand il est mis en vente. De leur donner une priorité sur ce bien, donc. Mais c’est au prix du marché et les pouvoirs publics sont le plus souvent incapables de s’aligner. Une autre possibilité en vigueur à Bruxelles est le droit de gestion publique, qui permet de confisquer un bien insalubre appartenant à un marchand de sommeil…
… Mais cette loi-là est inapplicable et c’est pour ça qu’elle est en cours d’amendement. Dès qu’un propriétaire fait mine d’engager des travaux, rentre un devis ou introduit une demande de permis, on repart à zéro dans la procédure.

Avec la hausse brutale des coûts de l’énergie, les difficultés de se loger dignement augmentent encore, non ?
Ce qui se passe est super grave, et ça mérite un soulèvement social ! On voit déjà de nombreuses initiatives collectives en Belgique et à travers l’Europe pour remettre en question le paiement de factures d’énergie qui n’ont plus aucun sens, et pour exiger la reprise en main d’Engie et des autres. Peut-être qu’on n’arrivera pas tout de suite à cet objectif (elle sourit), mais j’espère vraiment que la mobilisation prendra de l’ampleur.
Vous y croyez, à un « soulèvement social », comme vous dites ?
Disons que la narration de la propriété privée est un concept particulièrement difficile à défaire. Mettre l’essentiel des fruits de notre travail dans un loyer et des factures, c’est en soi problématique. D’autant que, pendant ce temps-là, une petite partie de la population s’enrichit en encaissant des loyers et des dividendes.
La crise du logement semble permanente, avec des phases de haut et de bas.
Oui. Ce n’est pas neuf. Déjà au XIXe siècle, le philosophe Friedrich Engels dans La question du logement constatait que le marché privé locatif ne logeait pas les pauvres dans des conditions dignes et salubres. Ça n’a pas changé. Jamais. Au contraire, le marché met les gens en concurrence sur des appartements ou des maisons qui ne le méritent pas. Les promoteurs immobiliers s’avèrent incapables de produire du logement social de qualité à bas coût. Il leur faut du dividende. Ça ne rapporte pas assez.
Même des projets de mixité sociale, vous vous en moquez dans vos conférences…
C’est quoi en général un projet de mixité sociale ? C’est installer des classes moyennes et élevées chez les pauvres. Et ça, non, ça ne les aide pas puisque ça fait monter les prix.
Les promoteurs, la spéculation
Les grues tournent à plein régime, mais il manque de logements à prix modérés. Comment expliquer ce paradoxe ?
Depuis les années 1990, Bruxelles comme la plupart des villes belges ont gagné beaucoup d’habitantes et d’habitants après en avoir perdu un paquet à partir des années 1960. Entre 2006 et 2011, on a construit moins vite que l’augmentation de la population. Il fallait dès lors bâtir pour compenser, en tout cas jusqu’en 2015. Jusque-là, rien à dire. L’ennui, c’est que rien n’a stoppé les grues. Il y a aujourd’hui une inadéquation totale entre ce qui reste érigé en masse et le besoin en logements abordables.
Qu’est-ce qui est construit à l’excès ?
Des « appartements à deux chambres », tels que le veut la promotion immobilière. Cela correspond juste à une typologie d’investissement. Ça fait bien sur les brochures… Les travailleurs sociaux disent que ce qu’il manque, ce sont de grands appartements pour des familles ou de tout petits studios.

Vous avez décortiqué l’attitude de deux promoteurs immobiliers (Immobel et BPI)
Un promoteur immobilier, comme l’a développé Alice Romainville, autrice de La production capitaliste de logements à Bruxelles, c’est un entrepreneur qui lance un projet de construction et le coordonne depuis la recherche des financements jusqu’à la vente des logements. Ils se présentent comme des « façonneurs » de la ville, des visionnaires, ils racontent des histoires attrayantes à des banquiers et des investisseurs, pour les convaincre que ces complexes résidentiels, bureaux ou centres commerciaux qu’ils font construire sont une bonne affaire, rapportant de l’argent. Vu que leur objectif c’est d’offrir des rendements financiers intéressants à leurs investisseurs, en bout de chaîne, les loyers doivent être élevés.
Comment font-ils pour s’imposer ?
J’ai analysé les rapports d’activités de ces deux promoteurs. J’ai lu ce qui figure sur leurs sites, derrière l’onglet « investor relation ». Ça m’a permis par exemple de montrer le changement intervenu chez Immobel : ils ont voulu devenir un acteur reconnu des marchés financiers. Ils ont commencé des tournées de présentation dans des places financières. Ils y ont présenté leurs ambitions directement aux banquiers, aux investisseurs, aux fonds de placement. Là, leur discours est clairement de promettre des rendements, de l’argent – pas de construire des solutions pour la population.
En période de crise, ça marche encore mieux ?
Oui. Les investisseurs cherchent des solutions pour sécuriser leur argent et « fixer » celui-ci dans des projets concrets. Ils craignent les pertes de valeur. On le voit à Bruxelles et dans beaucoup de grandes villes, les logiques de spéculation se renforcent encore quand l’économie patine : acheter du foncier dans les villes tant qu’il en reste et qu’il est possible d’obtenir un permis, attendre qu’un quartier monte encore, revendre si l’occasion se présente. L’argent, c’est comme les trombes d’eau. Il doit trouver un endroit où aller.
D’où vient tout cet argent ?
En 2008 surtout, puis en 2011, des États comme la Belgique ou la France sont intervenus massivement pour sauver les banques. En trois ans, au niveau européen, ces sauvetages bancaires répétés ont coûté à la collectivité près de 2 000 milliards d’euros. Les grandes banques ont été tirées d’affaire alors qu’elles avaient pris des risques inconsidérés. Résultat, ceux qui ont profité du système n’ont rien perdu et, même, ils ont continué à accumuler du capital. De gigantesques montants d’argent sont restés disponibles pour tous types de placements, notamment dans l’immobilier.
Aucune leçon n’a été retenue de cette époque de l’argent fou ?
Nooon (elle rigole) ! Les gouvernants ont été jusqu’à utiliser la même recette au début de la pandémie en 2020 ! Des masses d’argent ont été envoyées à destination des banques pour qu’elles continuent de faire tourner la machine. Ceux qui nous dirigent n’ont aucune envie de remettre en question le fonctionnement des banques et le système financier : ça ferait perdre de l’argent à ceux qui en ont beaucoup, et puis ce sont les banques qui, par le crédit hypothécaire, rendent possible l’accès à la propriété privée du logement.
Depuis dix ans environ, la construction de hautes tours, comme ici dans le quartier Nord de Bruxelles (où se déroule une partie de l’interview), est à nouveau tolérée par les pouvoirs publics. Pourquoi ?
L’intention politique a changé et fait sauter un bouchon législatif. La tour Atenor érigée le long du canal de Bruxelles (42 étages et 140 mètres de hauteur) a été la première. C’était un message politique envoyé à d’autres promoteurs : « OK, vous pouvez y aller. Tout est possible, y compris des tours de logements de luxe. » On est ici sur un ancien bassin industriel et les habitants peuvent déduire de ce côté « waterfront » qu’il n’y aura plus d’investissement dans ce qui a créé jadis beaucoup d’emploi.
Ça permet de densifier, non, et ça correspond à un objectif politique assez clair depuis une dizaine d’années, tant en Wallonie qu’à Bruxelles ?
Mais ils vivent où, les gens qui pensent ça ? À Uccle, entre un séjour à la mer et au ski ? Bruxelles a déjà un cœur-de-ville très densifié. Ça va, quoi ! Il n’y a quasi plus d’espace vert. Ça suffit… Il y a une énorme arnaque qui consiste à confondre densité et hauteur. Si la tour qu’on a sous les yeux est si haute, c’est uniquement pour rentabiliser le prix du sol, qui est élevé. On pourrait penser que la tour en elle-même n’est pas un problème, mais tout autour cela génère une hausse des loyers et de la spéculation.
Un « waterfront », c’est un langage que comprennent tous les investisseurs du monde. Vous leur montrez une photo, vous rajoutez une péniche, un musée et ils ont leur repère : un truc culturel, qui bouge, qui ressemble à ce qu’on voit dans d’autres capitales européennes. Construisez une belle passerelle, connectez-la à une gare et à un quartier en renaissance, complétez par un bout de parc, indiquez qu’il y a un tram tout près, et vous rentrez à fond dans leurs codes. C’est ça qu’ils aiment, les investisseurs. Ils savent qu’ils vont pouvoir louer cher ce qu’ils achètent. Sinon, s’ils veulent revendre, ce sera possible aussi. Avec une grosse plus-value.

Ces promoteurs qui ont le vent en poupe, ils renforcent la gentrification ?
Oui. Gentrifier, c’est réinvestir en capital dans des lieux qui n’étaient plus trop valorisés. Prenons un quartier ouvrier à Molenbeek ou à Saint-Gilles, où le sol n’est pas encore trop cher en raison d’un sous-investissement chronique. D’un coup, un promoteur vient et sent la possibilité de réaliser un rent gap, comme l’a théorisé le géographe britannique Neil Smith. Le promoteur entrevoit une différence de valeur, une plus-value. Il est attiré…
Neil Smith a montré que c’est surtout dans les quartiers populaires et/ou industriels où il y a la possibilité de changer l’affectation des sols – de terre productive à zone habitable ou économique – qu’il y a moyen de générer un tel rent gap. Avec l’appui massif des pouvoirs publics, de petits promoteurs y jouent souvent le rôle de pionniers pour de plus gros acteurs. Ceux-ci ne se déplacent pas pour rien : eux, il leur faut de la belle visibilité. Les passerelles qui se développent le long du canal (elle tourne la tête et en montre une), ce sont des icônes de cette gentrification. Moi, j’y vois littéralement des flux de capitaux.
Le culte de la propriété
Dans vos conférences gesticulées, vous dézinguez le culte de la propriété. Pourquoi à ce point ?
Quand Aline et moi, on débat de ces questions de logement et de spéculation, de ces signaux envoyés par le monde politique aux promoteurs immobiliers, cela donne lieu à des échanges compliqués. Le logement est une matière sensible. Nous savons bien que, pour une partie de la population, investir dans la brique, c’est se prémunir contre des pensions trop rikiki. Ce qu’on explique alors, c’est que la logique capitaliste est aussi celle qui a détricoté le régime des pensions légales.
La manière actuelle d’appréhender les questions de logement est intimement liée à la notion de propriété privée. On la protège envers et contre tout, indépendamment du type de propriétaire et du nombre de parcelles ou d’immeubles qu’il possède.
Quelle est la responsabilité des médias dans ce processus ?
Ils parlent du logement soit dans les pages « immo », où sont relayées les belles histoires des promoteurs, soit dans les pages misérabilistes. Les médias, comme les partis politiques, entretiennent ce culte de la propriété privée…
… Ils relaient par exemple ce nouveau principe du « premier investissement » – le petit appartement à deux chambres – imaginé par les promoteurs immobiliers pour attirer le chaland et susciter d’autres achats. Ça marche pas mal avec une population qui a « une brique dans le ventre ». Cela permet aux dirigeants politiques de s’exonérer d’une réelle politique du logement.
À notre insu, nous sommes attiré·e·s dans ce système pernicieux où, si on devient propriétaire-bailleur, on se met à louer le plus cher possible pour payer le crédit. On devient les allié·e·s des gros propriétaires et des investisseurs, on en vient à défendre des intérêts qui ne sont pas les nôtres.
Beaucoup de Belges sont propriétaires… Combien ?
À l’échelle du pays, plus de 70 % des adultes.
Vous leur demandez quoi, aux petits propriétaires, à celles ou ceux qui ont un seul bien, qu’ils louent en partie, par exemple ?
Rien. Il y a un lapsus. Nous, quand on parle de la propriété – un concept mal défini –, on parle de la propriété marchande, celle qui vise à posséder plusieurs biens, à les faire fructifier et à en faire un produit comme d’autres. À l’origine de la notion de propriété, il y avait une distinction entre l’usus, le fructus et l’abusus. L’usus, c’est le fait d’utiliser un bien immobilier. C’est ce que fait un propriétaire-occupant, par opposition à un propriétaire-bailleur. Le fructus, c’est le fait d’en tirer profit. L’abusus consiste à en faire ce qu’on en veut, d’en abuser jusqu’à le détruire.
Sur ces questions, nous ne sommes pas dans un rapport moral. Vous ne nous entendrez pas dire que les propriétaires sont des salauds. Dans le langage politique et médiatique, une confusion est maintenue sur ces questions. On s’arrange pour mettre dans le même panier l’appartement d’une grand-mère reçu en héritage et loué à 500 euros, et cette tour Atenor du quartier Nord autour de laquelle les prix flambent. En protégeant tout ça en vrac, les pouvoirs publics se privent de possibles décisions démocratiques et collectives sur l’avenir de nos sols et de nos villes. Ils tombent dans le piège de la spéculation. Ils se refusent des solutions simples permettant que les gens n’aillent pas trop mal.
Il faut faire quoi, pour commencer ?
Au minimum, le gel direct de tous les loyers. Puis, leur baisse. Il faut également du logement social. Un chiffre me fait rêver, venu de France. Dans le secteur du logement dit « très social », l’équivalent de notre logement social, 90 % des bâtiments sont devenus performants sur un plan énergétique. La force du collectif, c’est ça ! À Bruxelles, on a calculé qu’un toit qui lâche représenterait moins de 4 centimes d’investissement par personne. C’est l’illustration d’une solution collective qu’on ne se donne pas.
"La force du collectif"… Ce qui lie Médor et les lieux autogérés où il a choisi de s’installer en décembre pour s’accorder des moments de dons et "de bon", dont nous avons tous bien besoin. Venez nous rejoindre.