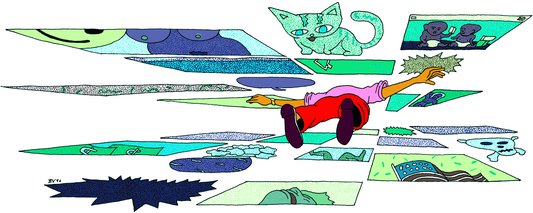Les cerveaux cramés de l’unif
Le meilleur de la presse du Nord
Traduction : Thomas Lecloux
Illustrations (CC BY-ND) : Émilie Gleason
Enquête : Jan Walraven
Publié le

La santé mentale des jeunes chercheurs flamands est inquiétante : un doctorant sur trois souffre de problèmes psychologiques sérieux. Trop nombreux, ils se livrent à une concurrence pour les financements et à une course à la publication. Mais ils rapportent beaucoup aux universités.
Au début de cette année, le Centre d’expertise pour le monitoring de la recherche et du développement de la Communauté flamande (Ecoom) a publié des chiffres retentissants sur la santé mentale des doctorants : pas moins d’un doctorant sur trois rencontre de graves problèmes de santé mentale, et les doctorants courent 2,4 fois plus de risques de connaître ce type de problèmes que les autres personnes hautement qualifiées. Les exigences professionnelles élevées, la répartition hommes-femmes inéquitable dans les groupes de recherche et les conflits entre vie privée et vie professionnelle seraient les principaux facteurs de risque de développer des problèmes mentaux. Les chercheurs qui travaillent avec une bourse temporaire ou sur un projet temporaire seraient plus exposés que les autres, de même que les femmes doctorantes par rapport aux hommes.
Partant de ces constats, Apache a interrogé une vingtaine de chercheurs, doctorants, postdocs et professeurs de différentes disciplines et universités de Flandre. Que tous aient souhaité s’exprimer sous couvert de l’anonymat montre d’emblée à quel point le sujet est sensible. La critique ouverte reste une affaire délicate dans les universités de Flandre.
Publier pour exister
Le centre Ecoom précise ce qu’il entend par exigences professionnelles élevées : la charge de travail et la pression à la publication. Cette pression, les chercheurs scientifiques s’en plaignent depuis des lustres. Les doctorants sont en effet tenus d’obtenir la publication de leurs articles dans des revues scientifiques de renom. À peu près tous nos interlocuteurs reconnaissent cette pression et le stress qu’elle engendre, mais tous n’y voient pas que du négatif. « La culture de la publication n’est pas néfaste en soi, explique un postdoc. Publier, c’est être lu par des experts internationaux et bénéficier de leurs commentaires. Mon doctorat a gagné en qualité grâce à la publication. » Un jeune professeur apporte toutefois un bémol : « Pour les jeunes chercheurs, la publication reste la manière idéale de se faire remarquer et de faire carrière. » Le nombre de publications est souvent déterminant pour l’octroi de bourses de recherche. Plus on a publié, plus on a de chances d’obtenir un projet, et le financement qui l’accompagne.
La concurrence pour les bourses de recherche est très rude et, comme les candidats sont de plus en plus nombreux, les chances d’obtenir un projet sont de plus en plus minces. « Au FWO (le Fonds flamand de la recherche scientifique), les projets de recherche ont environ 13 % de chances d’être sélectionnés, précise un professeur expérimenté. Un taux très faible qui laisse inévitablement des projets remarquables sur la touche. Pour beaucoup d’entre eux, c’est une loterie. Parmi les meilleurs projets soumis, il est très difficile de juger. Le taux de réussite devrait augmenter. »
Le professeur dit comprendre le stress que ressentent les doctorants. « Quoi que l’on fasse, il y a toujours un risque que quelqu’un d’autre soit meilleur. Qu’on travaille tous les soirs et tous les week-ends n’y change rien. D’autant qu’il n’y a pas de limite à la quantité de travail produite, il n’y a pas de nombre maximal de publications. » Dans ce système, le doctorant se sent très coupable pour chaque heure qu’il ou elle passe à ne pas travailler. « Dans un autre secteur, quand on fournit les meilleures prestations, il est presque évident de garder son poste et d’obtenir une promotion. À l’université, ça ne marche pas comme ça, tant les places de postdocs ou de profs sont rares et la concurrence féroce », explique un postdoc de Bruxelles.
Chercheurs de bourses
La pression professionnelle n’est toutefois pas l’apanage des doctorants. « Tout le monde craque », selon un professeur. Pour les postdocs, il s’agit d’obtenir des projets et leurs moyens financiers. Certains ne s’occupent même que de cela au sein de leur groupe de recherche et ne font absolument pas de recherche scientifique. La survie du groupe de recherche dépend de leur capacité à obtenir des bourses. Cela engendre du stress en cas d’échec, mais aussi parfois en cas de succès. « On demande plus de bourses que ce qui est nécessaire ou possible, dans l’espoir d’en obtenir suffisamment. On ne peut prédire ni combien ni lesquelles d’entre elles seront attribuées. Si par hasard on en obtient trop en même temps, il faut renforcer les effectifs, sans quoi l’équipe en place sera surchargée de travail », explique un professeur. « Il arrive souvent qu’on soumette des demandes par pure nécessité financière, indique un autre. Même sans avoir l’expertise adéquate. »
D’autres postdocs consacrent le plus clair de leur temps à l’accompagnement des doctorants. « Disons que j’ai une bourse postdoctorale de trois ans, dit un historien. La première année, je fais ce pour quoi j’ai été engagé. À partir de la deuxième, je dois chercher ce que je veux faire quand ma bourse prendra fin, pour pouvoir consacrer la troisième à envoyer des candidatures et des publications. Au bout du compte, j’aurai réellement fait de la recherche pendant un an. » « Il ne faut cependant pas perdre de vue les points positifs, tempère une doctorante. C’est un travail qui offre énormément de liberté et qui est bien rémunéré. »
Un autre doctorant a fait le choix délibéré de ne pas participer à la course effrénée à la publication. « Mais j’ai pu le faire uniquement parce que je ne cherche pas une carrière académique. » Celui qui veut accéder à l’échelon supérieur, ou simplement poursuivre dans le monde académique après son doctorat, n’a pas ce choix.
Promoteurs sans vacances
Les postdocs et les doctorants savent parfaitement que leur promoteur est probablement soumis à une pression encore plus forte. « Réfléchir assis dans mon fauteuil, c’est terminé depuis belle lurette, confirme un professeur. Je dois courir tout le temps et travailler plus de 70 heures par semaine. Et je culpabilise quand je prends un jour de congé car mes collaborateurs dépendent de moi et de mon efficacité. »
Cette dépendance au promoteur fragilise les doctorants. « Nous étions exploitées par notre promoteur, témoignent deux chercheuses, passées dans le privé. Ici, au moins, le bien-être du personnel compte. » À l’université, déplorent-elles, seule la production importait.
L’accompagnement dont bénéficie le doctorant dépend en grande partie du promoteur et du groupe de recherche qui lui sont attribués. « Pour entamer un doctorat, on est généralement bien accompagné. Le promoteur peut en effet y gagner de l’argent, glisse un postdoc avec cynisme. Je connais beaucoup de doctorants qui ont ensuite été livrés à eux-mêmes. » Les chiffres d’Ecoom montrent l’évolution de la relation entre le promoteur et les doctorants au cours des 15 dernières années. Un professeur accompagne aujourd’hui en moyenne 4,25 chercheurs pré- et postdoctoraux, contre seulement 2,81 en 1999.
« Le prof est chargé de très nombreuses tâches, trop nombreuses pour fournir un excellent travail sur tous les plans, indique un professeur. Il faut donner plus de temps à tout le monde. Et, chose très importante, laisser les profs collaborer. Je travaille systématiquement avec un copromoteur pour que le doctorant ne dépende pas uniquement de moi. »
D’autres dénoncent le copinage et le favoritisme dont bénéficient certains doctorants. « Mon promoteur m’a un jour obligé à citer un autre doctorant, qui n’avait contribué en rien à mes recherches, comme coauteur d’un article », rapporte un doctorant. « Du copinage ? C’est possible, mais je ne l’ai jamais constaté, affirme un jeune professeur. Certains profils et talents sont recherchés. Mais, en même temps, on se plaint de l’évaluation des doctorants sur la base de la quantité de leurs publications et de critères objectifs, au mépris d’autres caractéristiques et qualités. Les deux critiques me paraissent difficilement conciliables. »
Pas de bébé à l’université
Ecoom a constaté un risque accru de problèmes mentaux « quand survient un conflit entre les exigences professionnelles et familiales ». Les femmes y sont globalement plus vulnérables que les hommes. « Vouloir un enfant reste le signe que l’on fait une croix sur son ambition académique », affirme sans détour un postdoc. La plupart de ses collègues féminines que nous avons interrogées sont du même avis. « Pour 90 % des chercheuses de notre labo, tomber enceinte était exclu. »
Pendant le congé de maternité, pas possible de chasser les publications. Même plus tard, il est considéré comme « désavantageux » de devoir s’occuper de ses enfants. Cette réalité concerne toujours principalement les femmes. Toutes les personnes à qui nous avons parlé connaissent des femmes à qui l’on a conseillé de reporter leur désir de maternité. C’est probablement l’exemple le plus extrême de la difficulté à trouver un équilibre entre travail et vie privée. Mais cela vaut aussi pour d’autres aspects de la vie personnelle. « À cause du grand degré d’incertitude que supposent les contrats à court terme, mais aussi de l’expérience à l’étranger que l’on attend de nous, il est difficile de construire quelque chose de stable, que ce soit avec un conjoint, avec des amis ou avec sa famille », explique un postdoc.
Trop de doctorants
En quinze ans, le nombre de chercheurs a pratiquement doublé dans les universités de Flandre, selon les calculs effectués l’an dernier par Ecoom.
« Pour les jeunes chercheurs, les chances de bâtir une carrière à long terme se situent principalement sur le marché de l’emploi non académique », ajoute Ecoom. Pourtant, la plupart des doctorants espèrent pouvoir rester à l’université. « Ces possibilités de carrière limitées font que bon nombre de doctorants bifurquent pendant leur doctorat vers le monde des entreprises, où les perspectives de carrière existent, explique un professeur. Le risque est que ce ne soient pas les meilleurs qui restent dans le monde académique, mais bien ceux qui persévèrent. »
Pourtant, les docteurs qui postulent dans des entreprises sont souvent écartés pour cause de surqualification. « C’est une vision dépassée, explique un chercheur postdoctoral. Les doctorants possèdent des compétences utiles dans beaucoup de secteurs, mais les entreprises n’en sont pas toujours conscientes. Elles ne savent pas en quoi consiste un doctorat et ne savent donc pas comment utiliser un docteur. » Depuis quelques années, les universités proposent des doctoral schools où les doctorants peuvent acquérir d’autres compétences : cours de langues, conseils de candidature, etc. Les avis sont partagés, certains doctorants trouvent ces formations utiles, d’autres y voient une perte de temps totale.
Une dérive rentable
Le nombre excessif de doctorants s’explique principalement par des raisons financières. Les doctorants et postdocs sont en effet payés par leur bourse. L’université ne leur verse pas un salaire, mais une partie mensuelle de la bourse qui leur a été attribuée par le FWO, par exemple. En Belgique, une bourse de doctorat est en outre exonérée d’impôt sur les personnes physiques, ce qui fait, en principe, des doctorants une main-d’œuvre bon marché pour les universités. Un laborantin expérimenté, par exemple, coûte beaucoup plus cher.
Tout comme le nombre de publications, le nombre de doctorats importe pour le calcul des moyens financiers de l’université. Plus une université produit de doctorants, plus elle reçoit d’argent du Fonds spécial de recherche, par exemple. Il existe donc un incitant financier à recruter des doctorants et à leur faire ensuite publier le plus possible.
Un postdoc nous a montré un document qui circulait dans sa faculté indiquant le retour sur investissement d’un doctorat et d’une publication. D’après ce document, un doctorat financé par une bourse du Fonds spécial de recherche (Bijzonder Onderzoeksfonds, BOF) rapporte en moyenne à l’université 41 936,45 euros, répartis sur cinq ans. Les chercheurs en lettres rapportent en moyenne moins à l’université que les chercheurs en sciences exactes ou sociales. « On a le sentiment d’être vus purement comme un investissement financier qui doit rapporter », confie un postdoc d’Anvers.
« Plus encore : le nombre de doctorants est aussi utilisé pour glaner une bonne place dans les classements internationaux, explique un autre. On recrute beaucoup plus et beaucoup plus tôt qu’il y a dix ans. À l’Université de Gand, il existe désormais un honours program pour les étudiants en dernière année de bachelier. À la fin de ce programme, ils reçoivent une lettre du recteur qui leur permettra d’aller à l’étranger ou d’obtenir une bourse de doctorat plus facilement. »
Pratiquement tous nos interlocuteurs jugent souhaitable que l’on tienne aussi compte du nombre de postdocs (et pas seulement de doctorants) dans le calcul des subventions aux universités. Les postdocs restent souvent liés plus longtemps à un groupe de recherche et y assurent une continuité, qui profite aux nouveaux doctorants et à la recherche elle-même. « Le postdoc devient en quelque sorte la mémoire du groupe de recherche, celui qui permet d’éviter de refaire ce qui a déjà été fait. »
chercher pour le privé
La manière dont les pouvoirs publics flamands financent les universités n’a pas comme seule conséquence un excédent de doctorants. Comme en atteste la proportion accrue de chercheurs pré- et postdoctoraux dans les universités, le poids du deuxième flux financier, c’est-à-dire les moyens tirés de fonds publics et de bourses temporaires, augmente de façon importante.
Le premier flux financier est le financement de base, c’est-à-dire les budgets alloués par les pouvoirs publics flamands à la mission d’enseignement. En troisième position vient le financement de la recherche appliquée, qui émane notamment des entreprises. Le quatrième flux financier concerne les partenariats avec le secteur privé.
Les groupes de recherche comptent avant tout sur le deuxième flux. « Notre financement de base est tellement minime qu’il ne couvre pas nos dépenses en photocopies, témoigne un professeur. Je ne pense pas que les pouvoirs publics se rendent compte du volume d’enseignement qui est payé par des fonds alloués à la recherche. Les doctorants aident à dispenser l’enseignement, mais sont payés par les fonds du deuxième flux financier. »
Le manque de financement structurel et la dépendance qui en découle aux subventions de projets créent une concurrence âpre, et son lot d’incertitudes. Les chercheurs doivent se battre pour chaque euro. Tout le monde ou presque reconnaît cependant que le niveau de la recherche scientifique flamande a fait un bond énorme au cours des dernières années, notamment grâce à cette concurrence extrêmement rude.
D’après nos interlocuteurs, la concurrence fait toutefois que l’on choisit plus souvent des thèmes ou des méthodes de recherche accrocheurs, qui rapportent vite des résultats, et donc plus de publications. La recherche scientifique connaît elle aussi ses modes et ses tendances. « On entre dans une dynamique où il est considéré plus pertinent de faire des recherches sur une nouvelle application que sur la problématique de la pauvreté, par exemple. »
Il y a de moins en moins de temps et de place pour la recherche à long terme et la recherche fondamentale, et quand ces recherches sont menées, elles partent de plus en plus souvent d’une question appliquée émanant éventuellement d’une entreprise. « De très nombreuses questions restent ainsi sans réponse », regrette un professeur. Les liens de financement et de collaboration de plus en plus intenses entre l’université et les entreprises limitent la recherche à ce qui est directement rentable économiquement.
Un plus grand financement structurel des groupes de recherche permettrait de contrecarrer cette tendance. Ces groupes auraient alors la possibilité de faire des recherches à court et à plus long terme. « C’est possible de le faire sans jeter la logique d’efficacité aux oubliettes », estime un professeur. La recherche à long terme pourrait par exemple être évaluée moins fréquemment.
Un financement structurel supplémentaire permettrait de planifier à plus long terme, et donc d’offrir plus de certitude aux groupes de recherche et aux personnes qui y travaillent. Ces fonds permettraient de recruter plus de postdocs et de professeurs, lesquels auraient plus de temps pour accompagner un nombre moindre de doctorants. Et avoir plus de temps, c’est ce à quoi tout le monde aspire.
Mais cela va-t-il se produire ? Rien n’est moins sûr. Dans le dernier rapport sur la situation financière de l’enseignement supérieur flamand, le commissariat gouvernemental redoute un impact négatif du mécanisme de financement actuel, fondé sur la concurrence, sur la qualité de la recherche scientifique. Mais le rapport laisse entrevoir peu d’espoir de changement. « Des hausses de budget substantielles semblent improbables dans les années à venir. Si les moyens sont rabotés, la production de savoir pourra être accrue par la concurrence et les universités devront concourir pour les moyens existants. »