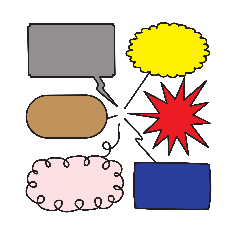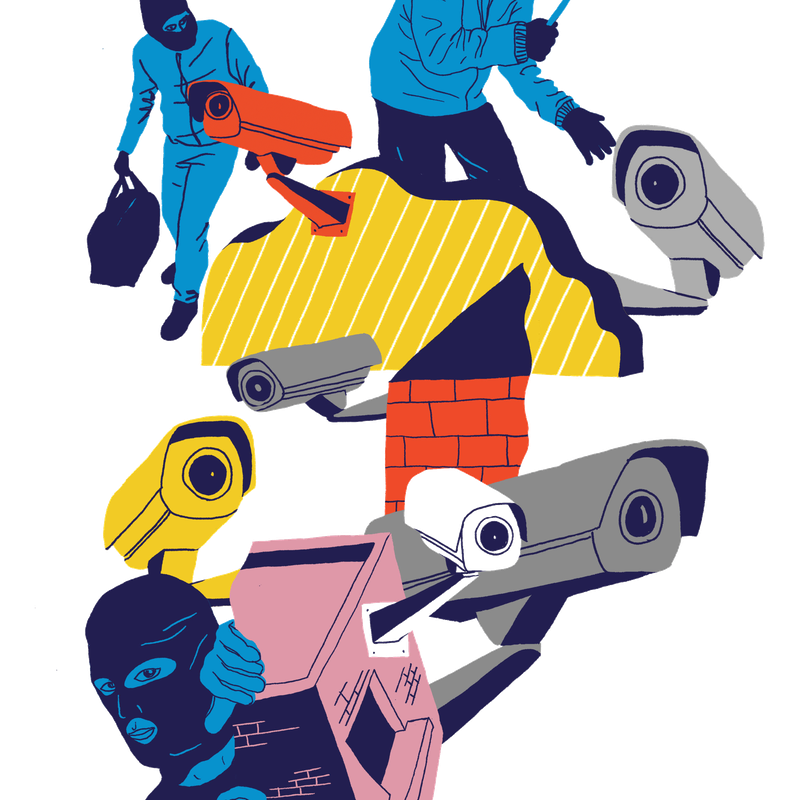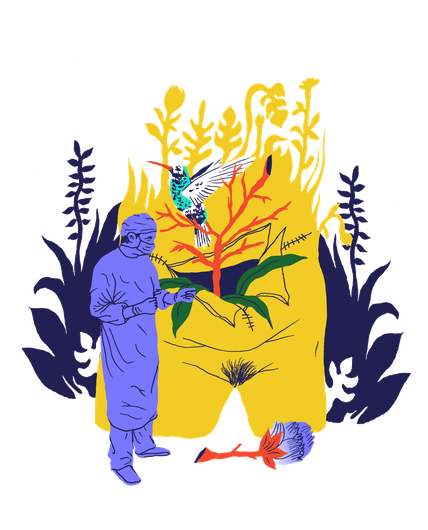Valérie Havart : l’envers des prisons
Textes et photos : Colin Delfosse
Enquête (CC BY-NC-ND) : Chloé Andries & Quentin Noirfalisse
Publié le

Postée à quelques rues de la Grand-Place, la prison de Huy est l’un des plus petits établissements pénitentiaires du pays. Un bâtiment « dans son jus », construit en 1871. Directement à gauche après la porte d’entrée, Valérie Havart, directrice de la prison, nous accueille dans un décor fait de carrelage en damier, papier peint saumoné et huisseries en bois. À 41 ans, cette native d’Oupeye, formée en psychologie et en criminologie, pour qui travailler en prison n’a « jamais été une fin en soi », a déjà pas mal roulé sa bosse dans les geôles du Royaume. En 2004, elle débarque à Andenne, un établissement forteresse de 400 détenus. Dix ans plus tard, elle rejoint l’équipe de direction chargée de préparer l’ouverture de la prison de Marche-en-Famenne, projet innovant pensé de façon plus « ouverte ». De quoi « bousculer » son idée du monde carcéral. En mars 2018, la voilà qui débarque à Huy, son « ambiance familiale » et sa vingtaine de prisonniers de trop par rapport à ses 63 places initiales. Femme de terrain, Valérie Havart raconte son expérience sans discours ampoulé. Son objectif est d’individualiser le parcours du détenu, dans une infrastructure à la force d’inertie implacable. Jour après jour, elle jongle entre demandes de congés pénitentiaires, réinsertion, normes Afsca, réglementations incendie et grèves du personnel.
M La Belgique est le quatrième pays européen en matière de surpopulation carcérale, avec 10 723 détenus pour 9 216 places disponibles. Aucune solution viable ne semble émerger. Pourquoi ne pas tout simplement supprimer la prison ?
V.H.Et me mettre au chômage ? Pas question. J’aime bien mon boulot, moi. Non, je ne pense pas qu’on puisse supprimer la prison en tant que lieu physique pour le moment. La surveillance par bracelet électronique ne va pas à tout le monde. Le système n’est pas encore très efficace et il est difficile à tenir pour les détenus. Si vous avez dix minutes de retard sur l’horaire de rentrée, vous êtes signalé par un programme informatique. Moi je reçois cela, mais je ne connais pas le contexte du retard. Si un détenu a un quart d’heure de retard, puis 23 minutes la semaine d’après, puis une heure une autre fois, je peux ajouter un jour à sa détention. Mais sans éléments pour affiner mon analyse.
M Le bracelet électronique ne convient donc pas à tout le monde ?
V.H.Il y a des gens qu’on met directement sous bracelet électronique pour les courtes peines et pour lesquels nous devons évaluer le processus à distance. Le problème c’est qu’on ne connaît pas ces détenus. Il faudrait surtout un suivi sur place, plus fréquent et régulier. Le bracelet est déjà difficile à mettre en place pour quelqu’un qui a pris six mois, alors imaginez pour quelqu’un qui est condamné à cinq ans ou vingt ans. De plus, la surveillance électronique ne va pas apporter des solutions pour les gens qui n’ont pas la discipline requise ou les personnes vivant dans des milieux précarisés. Le SDF va la faire où, sa surveillance ? Dans un centre que l’on créera, qui ne s’appellera pas prison et où on mettra des lits ?
M Koen Geens, le ministre de la Justice (CD&V), a aussi plaidé pour des mini-prisons, consacrées aux détenus en fin de peine, afin de désengorger les autres centres pénitentiaires. Qu’en pensez-vous ?
V.H.Ça me paraît pas mal. Lors d’un groupe de travail sur la lutte contre la surpopulation, on avait émis l’idée d’avoir des petites maisons pour détenus pour les gens qui ont déjà eu une série de congés pénitentiaires mais n’obtiennent pas de surveillance électronique. En général, on gagnerait à diversifier les structures, à limiter leur taille pour une meilleure atmosphère. Les toutes grosses prisons, où l’on formate les détenus comme des robots, ce n’est plus possible. Aujourd’hui, les plans de reclassement sont individualisés, tout doit être individualisé.
M Une petite prison présente quel avantage ?
V.H.On connaît tout le monde, on maîtrise donc mieux les situations individuelles, ce qui facilite la résolution de problèmes, permet d’anticiper les comportements. Même si parfois la proximité peut enlever un peu de cadre. Cependant, dans une petite prison comme ici, à Huy, même si l’ambiance est beaucoup plus sereine, je ne vois pas d’impact clair sur la récidive : ce sont souvent les mêmes qui reviennent, dont beaucoup sont originaires de la région. Mais je ne suis pas d’accord pour dire que le passage en détention fait retourner en prison. Le milieu dans lequel on a grandi, le contexte de vie, l’environnement social à la sortie, sont des aspects déterminants.
M Faire de grosses prisons, cela a-t-il encore du sens aujourd’hui ?
V.H.Les grosses prisons ont servi à répondre à l’objectif de surpopulation. Aujourd’hui, on en est revenu. Même si Marche, Leuze ou Beveren (ouvertes en 2013 et 2014, NDLR) restent de grosses prisons en matière de capacité, on pense les systèmes avec des unités différenciées, des bâtiments distincts, des structures plus faciles à gérer qui génèrent moins de tension et qui permettent d’individualiser le suivi.
M Que pensez-vous du projet de mégaprison de Haren, qui permettra d’accueillir plus de 1 100 détenus et constitue à coup sûr une réponse actuelle, aux yeux du gouvernement, à la surpopulation ?
V.H.Je serais curieuse de voir les plans. On dirait une prison mammouth, mais il faut voir comme cela va se traduire dans les faits. Trouver un terrain pour une prison, c’est très compliqué, à cause des débats politiques pour choisir la commune, pour savoir combien d’emplois ça va créer. En région bruxelloise, où le taux de population carcérale est très élevé, je peux entendre qu’il y ait besoin de beaucoup de places. Ils devront aussi regrouper plusieurs antennes, il devrait y avoir une partie médicale, un quartier de femmes. Si c’est en site différencié, sur un grand terrain, avec divers bâtiments ou une unité de gestion avec des entités variées, pourquoi pas.
M Vous êtes passée par trois structures pénitentiaires très différentes. Andenne, une grosse prison très « fermée », Marche-en-Famenne, un projet récent où les détenus ont plus de « libertés » au sein de la prison, et maintenant Huy, une vieille mais petite prison. Existe-t-il un fil conducteur dans le système pénitentiaire belge ?
V.H.Dans les projets de l’administration, l’objectif est clairement d’évoluer vers un système de prisons différenciées, pour qu’il puisse y avoir une cohérence dans le parcours de détention d’une personne. Le but, c’est de mettre le détenu au centre du projet, partir de lui, voir de façon individualisée quel pourrait être son trajet de développement en détention, le faire passer d’une prison à l’autre, qui aurait soit une formation qui l’arrange pour son parcours, ou une remise à niveau d’abord si besoin. Tout ça pour assurer une bonne réinsertion. Ça paraît évident de dire ça, mais ce n’est pas encore le cas partout.
M Pourquoi ?
V.H.Les prisons sont de grosses machines, difficiles à faire bouger. Ici par exemple, à Huy, la structure est très petite mais existe depuis tellement longtemps, les habitudes y sont tellement ancrées, que la résistance au changement est importante. D’autres prisons présentent aussi une résistance au changement, pour d’autres raisons. Prenons Andenne, beaucoup plus récente que Huy (1997) : elle est tellement grande (400 détenus contre 80 à Huy) qu’il est très difficile de la faire évoluer. On ne peut pas bouleverser d’un coup la prison : le risque de déstabiliser l’établissement est trop fort.

M Pourtant, cette volonté de mettre le détenu au centre, c’est l’objectif de la loi de principe de… 2005, déjà.
V.H.Cette loi de principe assure les droits de base des détenus. Elle pose toutes les règles de la détention, du droit de visite au droit de préau d’une heure par jour pour tous. Avant cela, il faut rappeler qu’on avait un règlement général des prisons qui datait du début du siècle dernier ! Il n’était plus du tout en phase avec l’évolution des lois et de la société. L’objectif était d’uniformiser les droits de base. Ce texte a été suivi de la loi sur le statut externe, qui définit comment on obtient les permissions de sortie, les libérations, etc. À mes yeux, ces deux lois forment un tout intéressant. Si on veut libérer, il faut fixer les conditions de cette liberté et préparer les choses en amont. On essaye d’aller vers un trajet de détention qui forme un tout entre l’intérieur de la prison et l’extérieur, et augmente les chances de réinsertion. Après, chaque établissement propose des projets en fonction de ses possibilités.
M Par exemple ?
V.H.La prison d’Andenne est une grosse maison de peine (pour les condamnés), les visites y sont possibles tous les jours et un des deux jours du week-end est prévu pour les visites familiales. À Huy, les tailles des salles de visite, les règles qui diffèrent entre prévenus et condamnés (Huy est une maison d’arrêt et de peine) font que les visites ne sont possibles que trois jours par semaine. L’infrastructure impose d’emblée des différences entre prisons.
M Mettre le détenu au centre, c’est aussi tenter de ne pas le couper de sa famille. Au Canada, il y a ce qu’on appelle les « visites familiales privées », qui permettent de vivre avec sa femme, ses enfants, dans une infrastructure adaptée, sur un laps de temps plus long que les « visites hors surveillance » belges. C’est envisageable selon vous ?
V.H.Quand j’ai commencé, la visite hors surveillance n’existait pas. Aujourd’hui, cela reste juste des visites de deux à trois heures, où l’on se retrouve avec sa compagne, son compagnon, ce n’est pas encore bien long. À Lantin, il y a eu des expériences de petits appartements, mais, en Belgique, on n’a pas encore vraiment avancé sur cette question. Il est pourtant essentiel de trouver un moyen de maintenir du lien familial. Les dossiers qui ont le plus de probabilité de bien évoluer, une fois la peine terminée, c’est ceux où il y a un milieu de vie cadrant, avec une compagne et des gens sur qui on peut compter. Le simple fait d’avoir un travail ou une formation ne suffira pas.
M Le plus gros changement pour vous a sûrement été le passage d’Andenne, prison très sécurisée, à Marche-en-Famenne, projet qui se veut plus « ouvert ».
V.H.Andenne était considérée lors de son ouverture comme une des prisons les plus sécurisées, accueillant des profils plus compliqués et 400 détenus. La rigidité de la structure est donc logique. J’y suis restée neuf ans avant de participer à la création de la prison de Marche, un projet tout à fait différent, qui m’a permis de mettre mes pratiques en question.
M Qu’est-ce qui vous a le plus bousculée dans votre « idée » de la prison ?
V.H.Habituellement, avant d’entrer dans une aile, il y a un sas, une grille, un sas, un no man’s land, puis une deuxième grille. À Marche, il y a une seule grille, ouverte toute la journée. En sortant d’Andenne, prison hyper-compartimentée, c’était pas très rassurant au début. À Marche, les déplacements sont facilités car tous les services sont rassemblés autour du centre cellulaire. L’idée était que le détenu puisse se responsabiliser, qu’il puisse aller en salle de sport, au service médical, en formation, à la chapelle de façon fluide. On a mis en place un système de contrôle social pour chaque aile. On disait aux détenus qu’ils ne pouvaient pas dépasser telle ligne. Ils pouvaient s’autoréguler entre eux.
M Le travail et la formation en prison sont souvent mis en avant pour lutter contre la récidive, mais aussi donner de l’utilité à la détention. À Marche-en-Famenne, le privé a été intégré au processus. Comment cela s’est-il passé ?
V.H.Contrairement à Huy, où l’essentiel du travail est celui de servants (internes à la prison, NDLR), la prison de Marche fonctionne selon un partenariat public-privé. Certains postes sont couverts par des services extérieurs. Sodexo se charge par exemple de la cuisine, et ce sont les détenus qui préparent la nourriture des autres détenus sous l’autorité d’un chef extérieur.

M N’est-ce pas du pain bénit pour la société qui profite de cette main-d’œuvre ?
V.H.Ils en tirent un avantage, c’est sûr, mais nous aussi. Nous avions le bénéfice de leur infrastructure, l’aspect hyperprofessionnel quant aux normes sanitaires et les détenus apprennent autre chose, c’est une formation qualifiante et ils travaillent avec une personne extérieure : c’est une véritable bouffée d’oxygène pour le détenu mais aussi un avantage pour la réinsertion.
M Pourriez-vous envisager que l’on privatise des services tels que la surveillance des détenus en prison ?
V.H.J’ai déjà visité plusieurs fois la prison d’Everberg, où l’on avait des agents de surveillance qui n’assuraient que la surveillance et des éducateurs qui ne s’occupaient que des tâches d’éducateurs. Les surveillants avaient le plus mauvais rôle, celui de punir. Si l’on privatise, en spécialisant les tâches, j’ai peur qu’il y ait une perte d’humanité. Le métier est riche, en termes de contacts, de gestion des équipes et des problèmes rencontrés par les détenus. J’imagine mal un service de gardiennage faire le vigile au milieu de tout cela. Qui va répondre aux questions incessantes, aux problèmes de comptabilité, aux soucis des détenus, qui trouvent déjà souvent qu’on tarde à amener des réponses ? Qui sera le relais ?
M Répondre aux questions, gérer la comptabilité, les demandes des détenus, du personnel, c’est donc cela votre quotidien ?
V.H.On court après le temps ici. L’évolution du droit nous donne sans cesse de nouvelles responsabilités et obligations très précises, pour lesquelles on n’est pas forcément formés. On manque parfois de temps pour digérer les réglementations du travail, les normes Afsca ou de sécurité électrique, les plans d’urgence. Dans une petite équipe comme à Huy, nous sommes tiraillés entre les priorités. Si je travaille sur la structuration du service médical, l’impact pour le détenu à long terme sera positif, mais, pendant ce temps, je ne fais pas le suivi des dossiers des détenus. Certains jours, je ne suis pas en mesure de lire le courrier des détenus.
M Vous manquez de moyens face à cette charge de travail ?
V.H.Nous manquons de temps. Prenons l’exemple du dernier mouvement de grève (en juin et juillet derniers, NDLR). Pour bien informer le personnel, on devrait prendre le temps d’étudier à fond ce qui est proposé. Mais c’est un moment d’urgence où l’on a, justement, moins de personnel, donc encore moins de temps.
M La grève a notamment porté sur le service minimum, et elle a été moins suivie à Huy qu’ailleurs. Quelle est votre position dans ce débat ?
V.H.Je comprends que les gardiens se sentent touchés dans un droit fondamental, qui est celui de faire grève. Mais comme dans un hôpital, ici, nous travaillons avec de l’humain, et ces besoins humains ne s’arrêtent pas subitement. Des mesures comme celle de réquisitionner du personnel pour assurer le service minimum s’appliqueraient très rarement. En effet, très souvent, lors d’un mouvement de grève, les travailleurs volontaires (les cuisiniers ou les assistants pénitentiaires, hauts gradés qui chapeautent la surveillance) suffisent à assurer le service minimum. À Marche, toutefois, ça nous est déjà arrivé, en tant que directeurs, d’aller faire des machines, de servir à manger, d’apporter le tabac aux détenus.
M Face aux problématiques pénitentiaires, le monde médiatique réagit souvent au quart de tour. Comment ces réactions à chaud influencent-elles votre travail à long terme ?
V.H.C’est vrai que certains médias préfèrent souvent une évasion spectaculaire à un concert de détenus qui se passe bien. Mais cette couverture négative a un impact direct sur l’opinion publique, qui est un levier énorme sur le monde politique. Quand on me demande ce que je fais comme métier, je ne vais pas répondre à n’importe qui. Pour quoi faire ? M’entendre dire que la peine de mort, y a que ça de vrai ? Qu’on devrait mettre les détenus au pain sec et à l’eau ? Voilà ce qu’on entend chez énormément de gens. En tant que directeurs de prison, on a un devoir d’éducation, mais on touche qui, par rapport aux médias ?
M Lorsque vous êtes entrée dans l’administration pénitentiaire, vous n’étiez pas beaucoup de femmes. Comment vous êtes-vous imposée dans ce milieu ?
V.H.Au début, j’ai surtout écouté, demandé des conseils, au fil des situations que je rencontrais. Ce n’était pas très utile de brandir mon index et de dire à un gros castard qui « délinque » depuis trente ans : « Ce n’est pas bien, Monsieur. » On s’impose avec sa personnalité, sa pratique, la fiabilité qu’on a aux yeux des gens. Il faut répondre aux questions sans fuir.
M Comment a évolué la place des femmes, à vos yeux ?
V.H.Ces dix dernières années, les femmes se sont fait leur place en prison. Aujourd’hui, elles sont nombreuses à occuper des postes de direction mais aussi de gardiennes. Cela contrebalance bien le fait que les assistants pénitentiaires sont souvent des hommes. Après, sous couvert d’humour, j’ai déjà entendu des remarques du type : « Depuis que les femmes sont entrées dans la prison, y a plus rien qui va. » Pas parmi les détenus, mais au sein du personnel. Pourtant, je peux vous dire qu’une femme aura parfois davantage de compétences pour dégonfler un conflit avec la parole. Et quand ça s’emballe, certaines femmes interviennent mieux que des hommes. Il y a des hommes qui ont peur, aussi.