École numérique : ombres au tableau
Enquête (CC BY-SA) : Quentin Noirfalisse
Publié le

Avec ses outils interactifs, l’école numérique nous a promis des jours merveilleux. Alors, les pouvoirs publics et les établissements ont investi. Reste deux détails : ces outils sont-ils vraiment efficaces ? Et, au fait, c’est quoi l’apprentissage du numérique ?
8h 55, un matin de décembre. Jonathan Valenzano ouvre la porte d’un local de l’Athénée royal Liège Atlas, vaste institution mélangeant général et technique de qualification, plantée sur le quai Saint-Léonard, en bord de Meuse. Au mur, un tableau blanc interactif (TBI) de deux mètres de diagonale. Dans une armoire, une batterie d’iPad pro. À 28 ans, Jonathan, professeur de mathématiques, fait office de meilleur abonné à la seule cyberclasse de l’école – et de geek patenté auprès de ses collègues. « On n’a pas acheté un tableau tactile, pour éviter que les élèves ne le touchent par inadvertance en entrant dans la classe et l’abîment. »
Point par point, Jonathan montre comment, par exemple, il se sert du tableau pour faire des exercices de vrai-faux en connexion directe avec les tablettes des élèves. Pour les fonctions de base, le logiciel fourni avec le TBI, ActivInspire, suffit. « Si je veux aller plus loin en mathématiques, il me faudra un autre logiciel, GeoGebra pour les créations géométriques. Le TBI demande de bien préparer le cours. J’ai moins de place pour l’improvisation : si j’explique un calcul étape par étape et qu’un élève demande une étape en plus, je vais être coincé : ce sera plus simple d’écrire en direct. »
Jonathan est convaincu des potentialités du numérique pour se « détacher du format papier, trop rigide ». Mais il ne s’ébahit pas trop devant son appareil. À peine avait-il lancé le TBI qu’il prévenait : le gros inconvénient, c’est le projecteur, qu’il faut entretenir, la lampe qu’il faut parfois remplacer. Importer une vidéo dans le programme va l’alourdir considérablement, donc une connexion internet est nécessaire. Et puis, il y a l’usure. Pas tellement celle du tableau. Celle des élèves. « Au début, avec le tableau et les tablettes, ils sont tout excités. Ils touchent à tout. Puis ça devient banal, et c’est là qu’il faut mélanger, innover, varier les méthodes. »
Or, pour varier, il faut être formé. Le manuel d’utilisation d’ActivInspire fait 4 000 pages, rappelle Jonathan, qui estime, avec son bagage, se servir du logiciel à « 60 % de ses capacités ». Et ses collègues ? Certains se sont rendu compte que les fonctions de base n’étaient pas si compliquées à utiliser. D’autres se sont montrés réticents, « en partie à cause de la charge de travail à la maison. Ils disent : je vais juste projeter et écrire un peu dessus. Mais alors là, c’est plus un tableau interactif. Tout le monde passe par là. Quand ils se sentiront à l’aise, ça ira mieux, mais, s’il leur faut deux ans pour l’utiliser, le logiciel aura changé et ils risquent d’avoir oublié les notions de base ».
Jonathan attend depuis six mois l’arrivée d’un lot de tablettes, fournies par la Région wallonne, pour une deuxième classe numérique. Trois professeurs, sur les cent que compte l’établissement, sont formés à leur utilisation.
Cyberclasses en panne
En Belgique francophone, l’équipement des écoles a pris une longueur d’avance sur l’intégration du numérique dans les programmes de cours et de formation de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dès la fin des années nonante, la Région wallonne (qui est compétente pour l’équipement des écoles) a lancé les plans Cyberécoles (1997-2000) et Cyberclasse (2006-2012, budget : 85 millions d’euros), installant notamment 40 000 ordinateurs dans l’enseignement obligatoire et de promotion sociale. La brochure du Service public Wallonie Le numérique en actions, parue fin 2016, relève que ce matériel est « peu, voire pas utilisé par les enseignants, qui ne sont pas suffisamment formés à son usage pédagogique ».
Les cyberclasses déçoivent le pouvoir organisateur qui les a mises en place. « On a mis 2 900 labos dans 3 300 écoles, explique Sébastien Reinders, expert en technologie éducative à l’Agence wallonne du numérique. Et il y en a très peu qui tournent au rythme où on l’espère. Ça marche bien là où la direction a investi pour affecter quelqu’un réservé au labo. On a 30 ou 40 % de bonnes pratiques, puis on a des écoles où ça n’est même pas utilisé. »
Après avoir tenté l’équipement de masse, la Région se lance, en 2012, dans un nouveau projet, École numérique, où des professeurs peuvent soumettre une demande d’équipement à condition d’avoir développé un projet pédagogique précis. Après quatre appels, près de 800 initiatives (sur plus de 2 000 propositions) ont été sélectionnées, menant à la distribution de milliers de tablettes, de centaines de tableaux interactifs, mais aussi d’ordinateurs, d’appareils photo ou de Thymio, petits robots conçus par l’Université de Lausanne qui permettent d’initier à l’informatique en programmant leurs comportements. Un accompagnement a été mis en place pour chaque projet, ainsi que des formations de professeurs à l’utilisation de l’outil.
« C’est un budget qui représente dix millions d’euros par an, environ, explique Sébastien Reinders. Mais attention : l’apport de la Région n’est que portion congrue dans l’équipement des écoles. Nous, nous sommes surtout là pour agir comme levier, pour les encourager à intégrer du numérique. » Le gros de l’équipement est donc payé directement par les écoles via les subsides de fonctionnement venus de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, parfois, leurs fonds propres.
Tableaux blancs peu interactifs
En Wallonie, deux sociétés se taillent une large part de la vente d’équipements numériques éducatifs : Défilangues à Jumet et ESI à Verviers. Parmi leurs produits phares, ces revendeurs comptent les tableaux et projecteurs interactifs. Défilangues en a vendu près de 7 000 et ESI entre 5 000 et 6 000. Les prix oscillent, selon Sophie Wanufel, formatrice en TBI chez Défilangues, entre 2 800 € et 3 800 € pour un tableau interactif.
À ce prix, un tel outillage dans la classe ne garantit pas l’interactivité d’un cours. Après neuf ans au contact des TBI, Sophie Wanufel a apprivoisé le matériel. Et connaît ce qu’il ne peut pas faire. « Ce n’est pas le tableau qui est interactif, c’est le professeur. Tout dépend de l’utilisation qu’on en fera, et de ce qui sera prôné par la direction. Mettre un TBI dans une salle polyvalente n’est pas forcément une bonne idée, car cela ne motive pas les professeurs à s’investir. Ce seront toujours les mêmes enseignants qui l’utiliseront. » Bien utilisé ou non, le tableau s’est positionné comme argument marketing. « Les écoles aiment montrer qu’elles disposent de ce genre d’équipements. Très souvent, après qu’un TBI a été installé, une photo se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur la page d’accueil du site de l’école. »
Au Québec, où l’on a équipé massivement les classes, une enquête auprès de 11 000 élèves et 1 000 enseignants montre qu’à peine 1,4 % des professeurs se sert du matériel informatique de façon interactive. Sophie Wanufel confirme : « Le risque, c’est que le prof se plonge dans une démonstration de ce qu’il a préparé, à la maison, et que tout cela devienne fort statique. » Plusieurs enseignants contactés par Médor nous ont confirmé l’utilisation du TBI avant tout comme un simple projecteur dans leurs écoles. Heureusement, la Fédération Wallonie-Bruxelles n’a pas imité le Québec, en imposant son usage de façon unilatérale à une grande partie du corps enseignant.
Dans son rôle d’équipementier, la Région wallonne a donc préféré les options multiples. Sébastien Reinders insiste, avec un sourire déterminé : il ne veut pas que le débat se focalise sur les tableaux interactifs, qu’il assimile à une technologie du XXe siècle en passe de disparaître, même si leurs chiffres de vente sont, selon Défilangues, encore en augmentation. « Si ça ne tenait qu’à moi, j’enlèverais les tableaux interactifs. Il n’y a que quelques profs qui en font un bon usage. Un projecteur avec un ordinateur et une souris, c’est aussi bien. »
Le prof « coach d’apprentissage »
En janvier 2018, la Région wallonne a lancé un nouvel appel à projets dans le cadre d’École numérique. Rien qu’au vu des 700 projets recalés lors des précédents appels (mais jugés comme étant presque « déjà prêts » par Sébastien Reinders), les candidats ne manqueront pas.
Julie Henry a participé à l’évaluation des projets École numérique, quand elle travaillait au CRIFA, un centre de recherche de l’Université de Liège, qui se spécialise dans la formation et la pédagogie à travers les technologies de l’information et de la communication (TIC). Son travail de formatrice, notamment en utilisation de TBI et tablettes, a touché plus de 800 enseignants. Aujourd’hui, elle est chercheuse en enseignement du numérique à l’Université de Namur. Avec le recul, elle regarde les projets École numérique avec circonspection.
« On a placé beaucoup de matériel sans que cela mène à grand-chose. Les projets ont été mis en place un an ou deux, puis les professeurs partaient souvent dans une autre école. Parfois, on allait encadrer un projet où le matériel était encore dans les caisses. On a essayé, au niveau de la recherche, de faire des retours sur ces expériences, mais nous allons trop lentement pour l’avancée que la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles désirent. »
Côté Région, on ne joue pas la politique de l’autruche : « Il y a des écoles qui remplissent des projets en dernière minute et pensent que nous leur offrons un Win for Life en équipement. Ce n’est évidemment pas le cas, explique Sébastien Reinders, qui précise que le nouvel appel, pour 2018, sera réservé à des écoles qui n’ont pas encore bénéficié de matériel et qu’ils se sont mis à soutenir des expériences plus axées sur la programmation. Notre mission est plutôt de mettre les enseignants en mouvement, afin qu’ils changent de posture et deviennent des “coachs d’apprentissage”, qu’ils fassent de l’enseignement coopératif. Pour y parvenir, le matériel est une condition absolument nécessaire mais tout à fait insuffisante. Il faut surtout de l’accompagnement, de l’apprentissage, de la formation. »
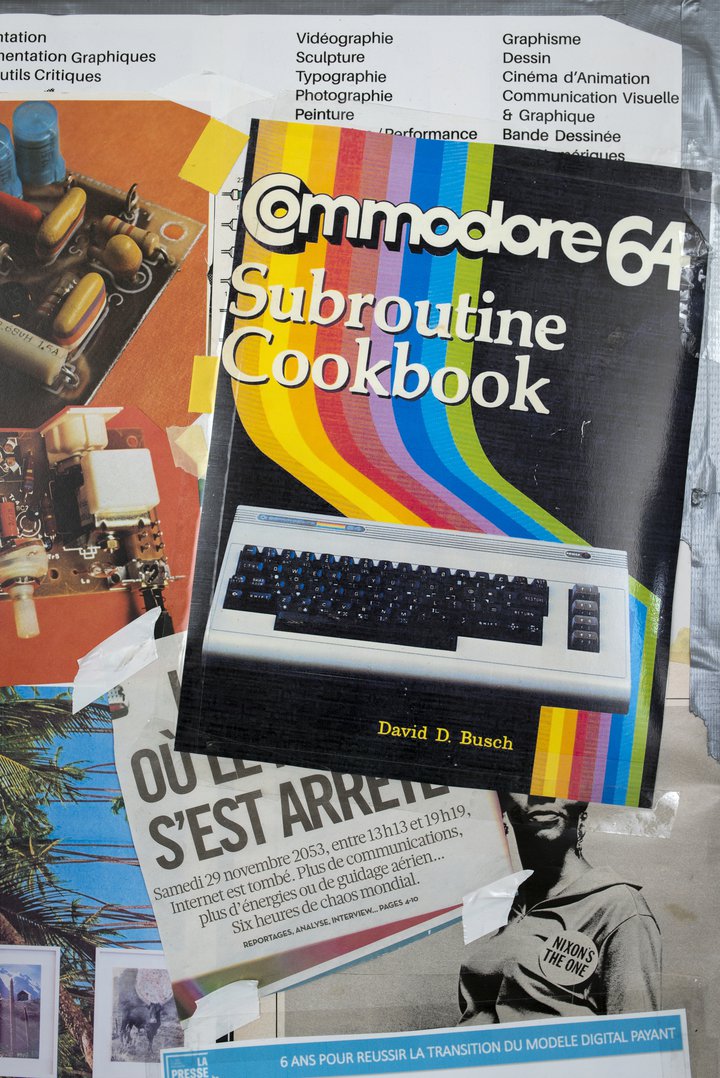
Tandems boiteux
Des projets s’installent toutefois sur le long terme. Sandrine Geuquet, enseignante à l’Athénée royal d’Ans, a été un des moteurs du numérique dans son école. En 2011, Apple, qui avait fourni ses ordinateurs à la cyberclasse, les a relancés pour équiper l’athénée en tablettes en tant qu’école-test. Depuis, le numérique s’est intégré dans l’établissement. Une des raisons de cette réussite, c’est Hervé. « Quand on l’a engagé comme responsable informatique, tout a changé. Il a permis aux professeurs qui étaient mal à l’aise avec la technologie de s’appuyer sur quelqu’un. »
Avec ou sans un « Hervé », toutes les écoles devront marcher dans les pas de l’Athénée royal d’Ans. « D’ici trois ans, les directions d’école devront intégrer une stratégie numérique dans leur plan de pilotage, rappelle Sébastien Reinders. Quand les projets “École numérique” capotent, c’est trop souvent parce qu’ils ont été portés par des individus et non par une direction, ce qui a impliqué un manque de vision à long terme. Acheter du matériel, c’est plus facile que de bâtir un programme. »
Pour épauler ces stratégies, la Région wallonne a lancé des projets « tandems » qui associent des sections pédagogiques du supérieur avec des écoles primaires ou secondaires. Objectif : produire de la recherche sur les expériences d’enseignement numérique produites en classe. Sur papier, l’idée était bonne. Julie Henry doit, avec l’Université de Namur, observer en quoi du matériel pour apprendre la programmation a une incidence sur les cours de maths et de français (notamment par la réflexion logique que cela implique). « Hélas, le budget proposé à l’université est de 11 000 euros pour trois ans. Cela représente vingt jours de recherche dans cinq écoles. » Soit environ un jour par école par an : efficacité garantie… La Région wallonne n’organisera pas un nouvel appel à projets « tandems » en 2018, préférant évaluer d’abord la version 2017.
Doutes sur le bénéfice
Est-il vraiment plus efficace d’apprendre via les outils numériques ? Un rapport PISA de l’OCDE jetait en 2015 une ombre au tableau : « Les pays qui ont consenti d’importants investissements dans le domaine de l’éducation n’ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences. » Le rapport embrayait en soulignant que les nouvelles technologies ne contribuaient pas non plus à combler les écarts de compétences entre élèves favorisés et défavorisés.
En France, où un plan national doté d’un milliard d’euros, a été lancé en 2015, avec une volonté d’équiper tous azimuts, de nombreuses voix se sont élevées contre une politique d’introduction à marche forcée du numérique. En plus des appels et cartes blanches de professeurs bien décidés à ne pas laisser les marchands de technologie dicter la vie scolaire, le philosophe des sciences cognitives Roberto Casati résumait l’enjeu dans une interview à Bastamag : « L’une des missions de l’école est de former au numérique. Cela ne signifie certainement pas changer la pédagogie et la faire virer au numérique ! Cela signifie expliquer ce qu’est un ordinateur, comment fonctionnent les systèmes de recommandations et de recherche comme Google. Paradoxalement, pour comprendre le numérique, un cours de statistiques serait plus utile que de transporter une tablette dans son cartable. » Dans son livre Contre le colonialisme numérique, le philosophe, qui est loin d’être un anti-numérique, mettait pourtant en garde : « Le temps de l’innovation technologique est incompatible avec le temps de l’apprentissage. […] L’école sera toujours en retard technologique sur la société industrielle. »
Pacte 1.0
Le Pacte d’excellence, socle tant attendu de notre enseignement pour les générations futures, a-t-il tenu compte de cet avertissement émis en 2013 ? Difficile de répondre définitivement, alors que les travaux sont toujours en cours.
Aujourd’hui, tous les yeux sont rivés sur la réforme du tronc commun (un enseignement obligatoire pour tous de 6 à 15 ans, qui mêlerait formation générale, polytechnique, sportive, artistique et culturelle). Au niveau numérique, le groupe de travail responsable de ce tronc commun a écrit, dans son rapport d’avril 2017, qu’« un réel équilibre et une interaction féconde sont à trouver entre l’éducation par [le] et au numérique ».
Que veut dire ce jargon pédagogique ? Que le Pacte va probablement opter pour deux formes d’approche du numérique. « Éducation PAR le numérique », c’est intégrer les équipements numériques (tablettes, TBI, ordinateurs) dans les pratiques pédagogiques, à travers plusieurs ou tous les cours. Le groupe souligne bien, tout comme notre enquête, que l’efficacité de ces outils fait « encore l’objet de controverses ». « Éducation AU numérique », ensuite, c’est, selon le Pacte, « permettre de développer des comportements adéquats face aux nouvelles technologies. » Concrètement, il s’agit par exemple d’apprendre à utiliser intelligemment un moteur de recherche ou à faire un usage réfléchi des réseaux sociaux. « Il s’agit aussi de développer une vision éthique et critique face aux outils numériques », complète Bruno De Lièvre, professeur en technologie éducative à l’Université de Mons, qui a piloté le groupe de travail sur le numérique du Pacte.
Le rapport sur le tronc commun ajoute toutefois quelque chose d’important. Il faut « aller au-delà de la seule littératie numérique destinée aux élèves en tant qu’usagers et de les initier (à partir de la fin du primaire à tout le moins) aux sciences informatiques ou à la pensée informatique ».
Quand il a lu ce paragraphe, Olivier Goletti a eu l’impression de ne pas avoir travaillé pour rien. Cet informaticien à l’Université catholique de Louvain est membre du groupe de travail SI2, Sciences informatiques pour le secondaire inférieur. Cet ensemble de chercheurs en informatique et en pédagogie vise à introduire la science informatique dans l’enseignement obligatoire. « Les sciences informatiques, ce n’est pas l’utilisation des outils numériques, c’est la compréhension du fonctionnement d’un ordinateur et la logique qui est derrière, explique Olivier Goletti. Qu’est-ce qu’un algorithme ? Comment un navigateur internet charge-t-il une page ? »
Aujourd’hui, les étudiants n’ont que d’infimes chances d’être confrontés à ce type d’enseignement. « Rien n’est obligatoire. En 1re et 2e secondaire, l’initiation à l’informatique est un choix d’école, et quand elle a lieu, c’est souvent pour reproduire une capture d’écran d’un document dans Word », complète Goletti.
Pour SI2, il est donc nécessaire de mettre les mains dans le cambouis, de s’inscrire dans la logique de « programmer plutôt qu’être programmé » et de s’initier à la pensée informatique (voir encadré). Mais aujourd’hui, Goletti et SI2 déchantent au vu des dernières évolutions des travaux du Pacte. « Les personnes qui doivent réfléchir à des activités pédagogiques concrètes sont maintenant dans une dimension “numérique” au sens plus large, notamment à travers l’utilisation transversale d’outils en classe mais pas dans un apprentissage des sciences informatiques », déplore Goletti.
L’orientation est-elle irréversible ? Les référentiels d’enseignement sont en train d’être rédigés et doivent être adoptés par le gouvernement de la FWB en 2019. L’enjeu dépasse à coup sûr le simple cadre d’apprendre à utiliser les outils et logiciels existants, voués à « l’obsolescence rapide », selon Casati. Il s’agit plutôt de former l’élève à ce qui reste stable dans un univers technologique en perpétuelle mutation. Établir un pont avec les machines, autre que celui de la simple consommation des services qu’elles ont à nous offrir. Les douze mois qui arrivent seront capitaux pour bâtir la connexion entre école et numérique. Si possible en très haut débit.





