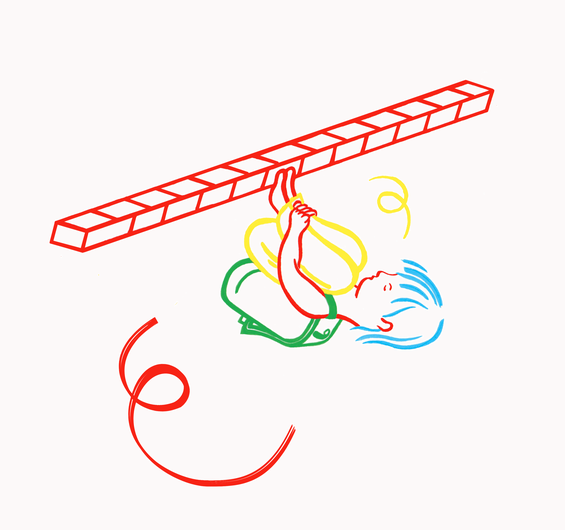Nous, au fond de la classe
Textes (CC BY-NC-ND) : Eric RavennWalravens
Publié le

Ils s’appellent Christine, Dominique, Fabian, Jojo, Johnny, Monique, Sébastien. La vie ne leur a pas fait de cadeau. L’école non plus. Oubliés au fond de la classe, ignorés des professeurs, ils ont pensé qu’ils valaient moins que les autres. Ils auraient rêvé que l’école leur donne confiance. Mais elle avait autre chose à faire que s’occuper d’eux.
Mardi 10 mars 2020, à Namur, dans un local exigu du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), nous nous serrons autour d’une table, sans nous connaître encore tous. On ne se serre pas la main, coronavirus oblige, on ne sait pas encore que dans quelques jours, on sera totalement confinés.
Il y a Christine, Dominique, Jojo, Johnny, Monique, Sébastien, Fabian, réunis à l’initiative du RWLP et des Transform’acteurs, un groupe d’alphabétisation affilié à l’asbl Lire et Ecrire. Il y a aussi Christine Mahy, la secrétaire-générale du RWLP. Et il y a deux collaborateurs de Médor, venus entendre les récits de leurs parcours scolaires accidentés. Comprendre à travers eux une certaine fabrique belge des inégalités.
Le temps d’une après-midi, on se parle, on se raconte les histoires. On explique ces petits abandons, qui ont eu de grandes conséquences. On répète les mots qui ont blessé, laissé des marques profondes dans l’estime de soi. Les mâchoires se crispent encore à leur évocation. On parle d’une école qui n’a pas su, pas voulu prendre le temps. Tous parlent du fond de la classe, où ils ont végété, espéré en vain un peu d’attention. On évoque aussi ces rares professeurs qui ont fait preuve de patience, et dont le souvenir émeut encore, des décennies plus tard. On dit encore la soif d’apprendre, malgré les écueils, et qui a parfois fini par payer, avec l’aide d’associations d’alphabétisation.
Quelques fragments de ces échanges sont retranscrits ci-dessous.
« Tu n’as qu’à regarder dans le dictionnaire »
Jojo brûle de parler la première. L’école, ça fait longtemps qu’elle l’a quittée, mais elle en a encore gros sur le cœur. Ses mots se bousculent dans l’urgence de raconter.
Quand j’ai commencé à aller à l’école, déjà en arrivant, on me regardait de haut en bas, on me maltraitait d’illettrée. Ce mot-là, je ne savais pas ce qu’il voulait dire. En rentrant chez moi, je demande à maman. « Je n’ai pas le temps de t’expliquer. Tu n’as qu’à regarder dans le dictionnaire. »
En secondaire professionnelle, son retard la pénalise. Il y avait de la restauration, de la couture, de l’écriture. Moi je sais bien coudre. Je sais bien faire la cuisine. Mais l’écriture toujours pas. L’enseignante n’a pas le temps de s’occuper de ses difficultés. Je me retrouvais à dessiner. Ben oui, puisqu’elle ne voulait pas m’apprendre à lire, ni écrire.
A 14 ans, ses difficultés d’apprentissage trouvent une explication : une dyslexie est diagnostiquée. Cela ne résout pas ses problèmes. Je suis toujours restée dans la restauration, mais une recette, il ne faut pas me la demander, je ne saurais pas la faire. Je suis une bonne cuisinière, mais sans recette. Parce que je ne sais toujours pas lire, ni écrire.
Aujourd’hui, elle vit avec le stigmate. « Illettrée », cela vient de la bouche de mes propres enfants. J’ai tout le temps vécu avec ce mot-là. « Tu es incapable, tu ne sais pas nous apprendre à lire. » J’ai été tout le temps rabaissée par mes enfants.
Elle regrette que l’école n’ait pas pu la tirer vers le haut. Pourquoi on n’a pas mis un faible avec un fort ? C’est toujours la question que je me pose. Si on avait mis un fort et un faible ensemble, ils auraient pu s’aider.
« On ne va pas encore te réexpliquer »
Sébastien a passé une partie de son enfance à l’hôpital Brugmann, à Bruxelles, où il a subi des opérations médicales. Il y avait une étude. On me donnait des devoirs, et je les faisais à l’hôpital. J’avais des difficultés en tout. Je ne savais pas vraiment le français, cela a créé des difficultés en tout.
En secondaire, il est placé à Reumonjoie, une école professionnelle d’enseignement spécialisé. A cause de problèmes de famille, mais je ne vais pas vous les raconter, parce que c’était vraiment grave aussi. Ses difficultés en français et dans d’autres matières persistent ; sa santé continue de l’éloigner de l’école, qui ne lui apporte aucun soutien particulier.
Les phrases entendues alors le marquent encore. « Tu ne dois pas être absent. On ne va pas encore te réexpliquer, autrement cela va freiner tous les autres. » Il abandonne après avoir triplé sa sixième secondaire.
Il débarque, sans diplôme, sur le marché de l’emploi. Le Forem l’envoie à Lire et Ecrire. Quand on me dit ça, je suis un peu choqué. Je n’aime pas d’y aller. J’ai laissé du temps, et pour finir j’y suis allé quand même. Dans un cadre associatif plus bienveillant, toutefois, il engrange enfin des apprentissages, et surtout de la confiance en lui. Monter des saynètes, sur base de son vécu personnel, y a contribué. « On est fier de le montrer à tout le monde. »
« Votre fille ne saurait pas rester ici »
Monique raconte sa vie avec la lucidité et le recul de ses 57 ans. Une déficience intellectuelle, liée à une méningite mal soignée, l’a éloignée de l’enseignement ordinaire dès ses six ans. Les professeurs ont convoqué mes parents et ont dit : « Votre fille ne saurait pas rester ici, il faut la mettre en spécialisé » .
En secondaire, elle ne sait toujours ni lire, ni écrire. Ils me mettaient derrière puisque je ne savais pas suivre. Avec le soutien de psychologues et de thérapeutes, elle commence néanmoins à faire quelques progrès. Mais à 16 ans, elle est envoyée en stage en atelier protégé. Puis elle est engagée par l’entreprise. Elle y restera dix ans. Je portais des caisses lourdes, j’y ai laissé ma santé. Ce n’est pas ce que je voulais. Je voulais être puéricultrice.
Monique a eu une fille, qui a aujourd’hui 25 ans. Comme elle, sa fille a vécu un parcours de relégation scolaire. Bringuebalée entre les écoles, envoyée dans le spécialisé, elle a été rejetée chaque fois par les professeurs. C’est le sort de beaucoup d’enfants de parents qui ont fréquenté l’enseignement spécialisé. Ses formations n’ont tourné à rien. Elle a fait des stages, mais ça n’a tourné à rien non plus. Je me retrouve avec ma fille qui n’a pas d’études, pas de travail et qui ne gagne rien.
« J’aurais voulu que le professeur m’aide beaucoup plus »
Il a beau avoir près de 60 ans, Dominique se souvient avec netteté de sa quatrième primaire, marquée au fer rouge dans sa mémoire. Jusque là, son parcours scolaire s’était déroulé sans accroc, mais en quatrième, ça cale. Une classe trop nombreuse, un professeur qui n’avait pas de temps à lui consacrer, des crises d’épilepsie violentes et des difficultés en maths et en sciences… En histoire et français, j’avais plus de facilités. Mais elles ne suffisent pas à lui faire réussir. J’aurais bien voulu que le professeur m’aide beaucoup plus. Cette aide, elle n’est pas venue, au contraire. Quand on rentrait chez soi, on avait beaucoup trop de devoirs. Dominique triple sa quatrième, sans que cela lui permette de se reprendre.
Il se souvient du manque de soutien des professeurs, qui aggravait un climat d’exclusion. A un moment, j’avais l’impression que j’étais un numéro par rapport aux autres élèves. Déjà, je subissais du fait de ma taille, parce que j’étais le plus petit de la classe, les quolibets des autres élèves. Mais en plus de ça, on renforçait cette exclusion par l’attitude des profs vis-à-vis de l’élève.
Il lui a fallu des années pour retrouver en lui des ressources, pour oser s’exprimer, critiquer à voix haute le manque d’attention reçue. Aujourd’hui, Dominique se présente comme un militant.
« On me laissait toujours dans le fond de la classe »
Quand il était petit, Fabian ne réussissait pas à l’école, sans que cela semble gêner personne. J’avais des difficultés à suivre. Je redoublais, je redoublais, je redoublais. Les professeurs ne s’occupaient pas de moi. J’étais toujours au fond de la classe. Je ne rouspétais jamais. On m’envoyait à la librairie, faire des photocopies… Il navigue d’échec en nouvelle école, de l’enseignement ordinaire au spécialisé. C’était bien, mais à refaire, je ne le referais plus. Un nouveau détour le ramène dans l’ordinaire. Je me disais, on va m’apprendre plus, mais non. On me laissait toujours sur le côté, derrière, dans le fond de la classe. Alors, je dessinais, en cours. Qu’est-ce que tu voulais que je fasse ?
A l’adolescence, il commence à se faire remarquer. Aux mauvaises notes, il ajoute les punitions, les sanctions. Les punitions, ils ont arrêté avant moi, hein. Je devais copier, mais je ne copiais jamais. Ils me mettaient à genoux avec deux dictionnaires aux mains, à regarder le mur. Peine perdue, Fabian a la tête dure. Je n’ai jamais fait mes devoirs, je ne montrais jamais les punitions (à mes parents). Je signais le journal de classe moi-même, ou mon frère. Il en rigole encore.
« Je me suis dit : moi dans la vie, je suis quelqu’un de moyen »
Les premiers souvenirs d’école de Johnny ont le goût de l’humiliation. Je me souviens que j’étais habillé avec des pantalons en tergal, pattes d’eph’, et que les autres étaient en jeans. J’étais avec mes cousins qui étaient mal habillés aussi. Il y avait de la violence envers nous, et moi j’avais de la violence envers eux, évidemment.
Humiliation entre élèves, humiliation en classe aussi. Je me souviens d’un truc que j’adorais faire, c’était une rédaction. J’étais tout content parce que j’avais une super rédaction, et la prof m’a souligné vingt fautes en rouge, complètement nul. Je me souviens que je me disais : mais pourquoi est-ce qu’elle n’a pas été voir le texte qui était derrière ? Je me souviens de cette frustration.
Tous les professeurs n’étaient pas de la même trempe. J’avais une prof qui s’est un peu attachée à moi et qui m’a soutenu, mais elle a eu un accident de voiture et elle est décédée. C’était peut-être mon premier amour, elle faisait attention à moi, elle me révélait à moi.
Au moment de passer en secondaire, un test d’orientation l’envoie en technique. Je me suis dit : moi, dans la vie, je serai quelqu’un de moyen. Une humiliation de plus. Après, je suis allé en professionnelle, j’ai rencontré des petits voyous, je me suis identifié à celui qui fout le bordel, je ne savais pas exister autrement.
Adulte, illettré, il enchaîne les déconvenues, jusqu’à ce qu’un stage en maison de jeunes lui redonne l’espoir en ses capacités. Je pouvais faire quelque chose pour les autres. A l’association Alpha 5000, j’ai commencé à découvrir la langue française. Ma prof a été très patiente. J’ai commencé à avoir confiance en moi.
Quand Johnny parle de cette révélation tardive, il est habité. Une flamme brille dans ses yeux. A table, tout le monde l’écoute religieusement. Josiane, les yeux humides, serre son mouchoir entre ses mains. Il soupire : Si on avait fait ça avant, aller chercher les capacités des enfants…
Aujourd’hui, il travaille comme expert du vécu à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI). A ce poste, il guide les personnes fragilisées à travers les démarches administratives. Aujourd’hui, je suis très bon pour les rapports, j’ai les mêmes capacités. Mon correcteur orthographique me sert bien. Il sourit.
« En cours de français, on lisait des cartes routières »
Christine avait soif d’école. Elle ne l’a pourtant jamais vraiment fréquentée. Ma maman était malade. Je devais m’occuper de mes frères. Un jour, en cachette, elle rejoint ses cousines sur le chemin des écolières.
Ils m’ont mis près du radiateur avec un livre illustré. Je devais le raconter à toute la classe. Mais je ne savais pas lire, je me sentais rejetée dans le fond de la classe avec un livre que je ne savais pas déchiffrer.
Rappelée par sa mère, rejetée par l’école, elle cesse de la fréquenter. C’est à la coiffeuse du quartier qu’elle doit ses premiers apprentissages. Elle me faisait des chignons. Quand elle n’avait pas de clients, elle m’apprenait à lire à et écrire. Elle était très patiente.
Au décès de sa mère, elle se retrouve dans un orphelinat, chez les sœurs. Mais rien n’était prévu pour les apprentissages. Ce que j’avais appris avec la coiffeuse, tout a disparu. Son parcours scolaire accidenté l’amène à passer par différentes écoles, avec au ventre la rage d’apprendre à lire et écrire. Mais à l’Institut Médico-Pédagogique de Bouge, ce n’est pas à l’ordre du jour. En cours de français, on lisait des cartes routières.
A l’issue de sa scolarité, Christine ne sait toujours pas lire, ni écrire, elle qui le désirait depuis sa prime enfance. Ce n’est que bien plus tard, grâce à des associations d’alphabétisation, notamment le groupe « Y a pas d’âge » de Lire et Écrire, qu’elle y parvient.
A 52 ans, elle entreprend l’écriture de son livre, une autobiographie, réalisée avec l’aide de Marie-Claire, écrivaine publique. Elle consigne ses souvenirs, méticuleusement. Dans chaque endroit où j’allais, il y avait toujours un crayon dans un tiroir. Le livre est achevé depuis peu, imprimé. Elle en donne une copie avec fierté. Cela fait cinq ans que je suis sur ce livre, c’est un chef d’ œuvre que je veux partager. Elle annonce déjà : il y aura une suite.