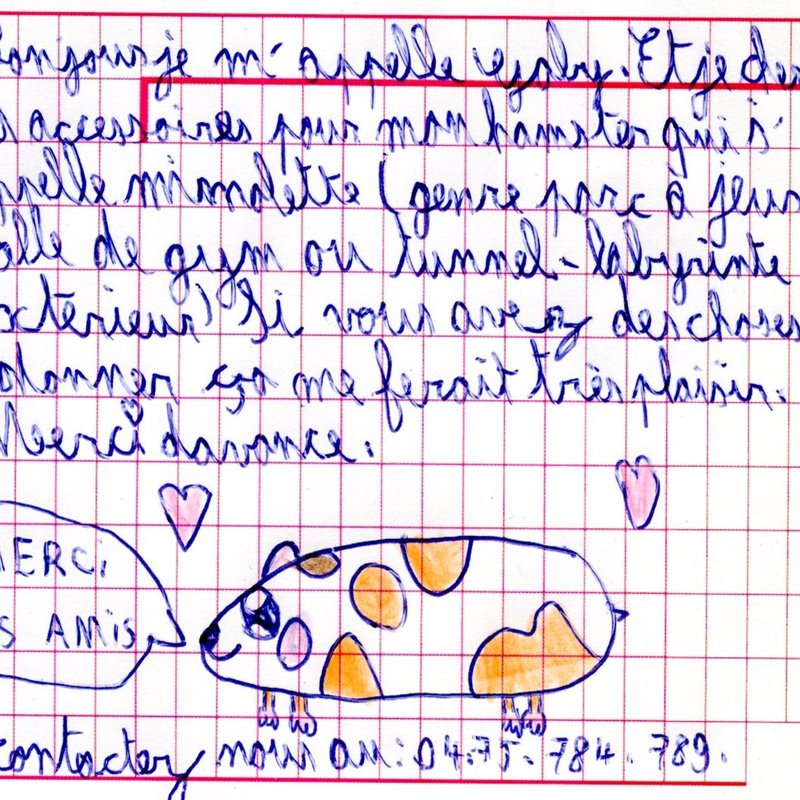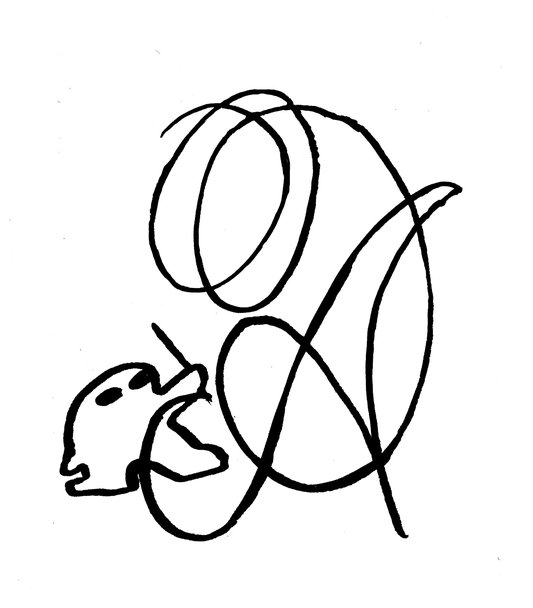Quand les journalistes mentent
Caméra cachée ou infiltration, la technique « undercover » fascine et révulse. Selon les règles de la profession, elle doit être une exception. Mais les journalistes masqués se multiplient. Cette pratique se serait-elle doucement banalisée ? Et à partir de quand le journaliste abuse-t-il ?
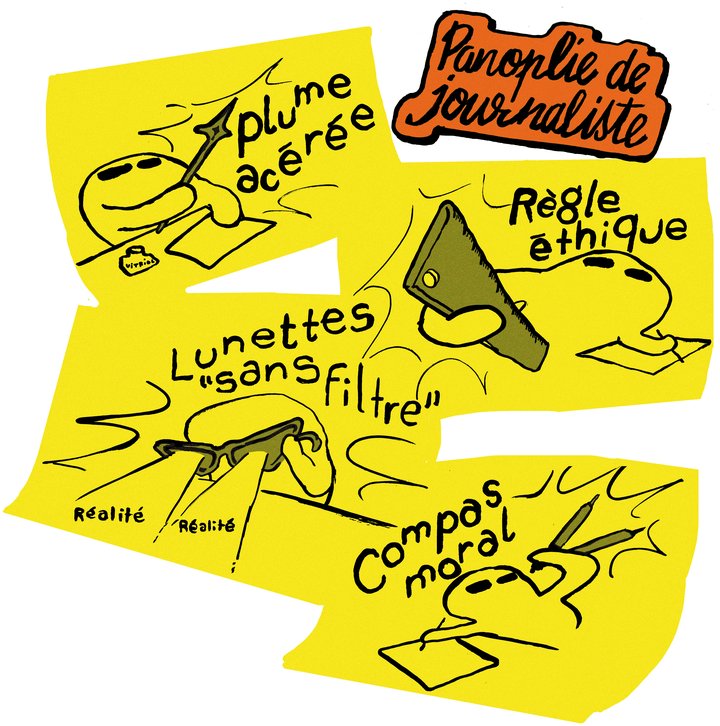
Jonas Marko et Ayrton Jacquemin sont en chemin. Ils se rendent à leur premier rendez-vous avec le groupe d’extrême droite Nation. La tension gagne le duo de journalistes. « En lançant l’enquête, il y a une forme d’allégresse. Puis tu vas à ta première rencontre, tu es dans la voiture et cela devient très concret. » Ayrton Jacquemin reçoit un appel : c’est le chef de la jeunesse Nation… qui le questionne sur ses convictions « nationalistes ». Le journaliste se compose un personnage, à l’improviste. À l’arrivée du duo d’infiltrés, cinq types version « militaire » sortent d’une voiture… C’est parti pour une enquête « undercover » (publiée dans le Médor n°38, mars 2025).
Mais de quoi parle-t-on ?
La technique « sous couverture » consiste à ne pas dévoiler son identité de journaliste. Éventuellement à en endosser une autre. Elle peut se décliner en une caméra cachée d’une demi-heure ou une infiltration de deux ans.
Elle est surtout une exception. La règle déontologique veut que le ou la journaliste annonce toujours son identité professionnelle. Avancer masqué peut relever de la faute professionnelle. Pourtant, dans de rares cas, on peut mentir… Mais quand ?
En Belgique, la réponse se trouve dans l’article 17 du Code de déontologie journalistique.
La dissimulation de sa qualité de journaliste, la tromperie sur le but de son intervention ou l’usage d’une fausse identité sont considérés comme méthodes déloyales sauf si quatre conditions sont rencontrées :
- l’information recherchée est d’intérêt général et revêt de l’importance pour la société ;
- les méthodes utilisées sont validées par la rédaction en chef. Ce point évite les méthodes de cow-boys impulsifs puisque le média doit penser la pratique en amont ;
- les risques encourus par les journalistes et par des tiers restent proportionnés au résultat recherché ;
- il est impossible de se procurer l’information par d’autres moyens.
Plaintes fondées
Aujourd’hui, l’« undercover » fascine… tout comme elle inquiète. « Il y a de plus en plus une tendance à recourir à ce dispositif, explique Muriel Hanot, secrétaire générale du Conseil de déontologie journalistique, l’instance qui reçoit notamment les plaintes sur les pratiques de journalistes. On le voit dans les questions d’informations qui nous sont adressées. Or cela doit rester l’exception. » En janvier 2025, une plainte pour pratique déloyale de caméra cachée a été jugée fondée par le Conseil de déontologie journalistique et médiation (CDJM) en France. En mai dernier, la Belgique a connu une plainte et une conclusion similaires.
Elle concernait l’émission #Investigation (RTBF). Le reportage mentionnait les pratiques des dentistes et la séquence incriminée était une caméra cachée, racontant un détartrage d’une durée de 15 minutes chez une dentiste non conventionnée, pour un tarif de 130 euros. Le visage des personnes était flouté, le cabinet dentaire n’était pas identifiable, mais la dentiste s’est plainte. Des proches l’ont reconnue. Or l’accusation est grave. Car en déclarant à l’INAMI un examen des gencives fictif, cette dentiste aurait commis une fraude (ce qu’elle conteste).
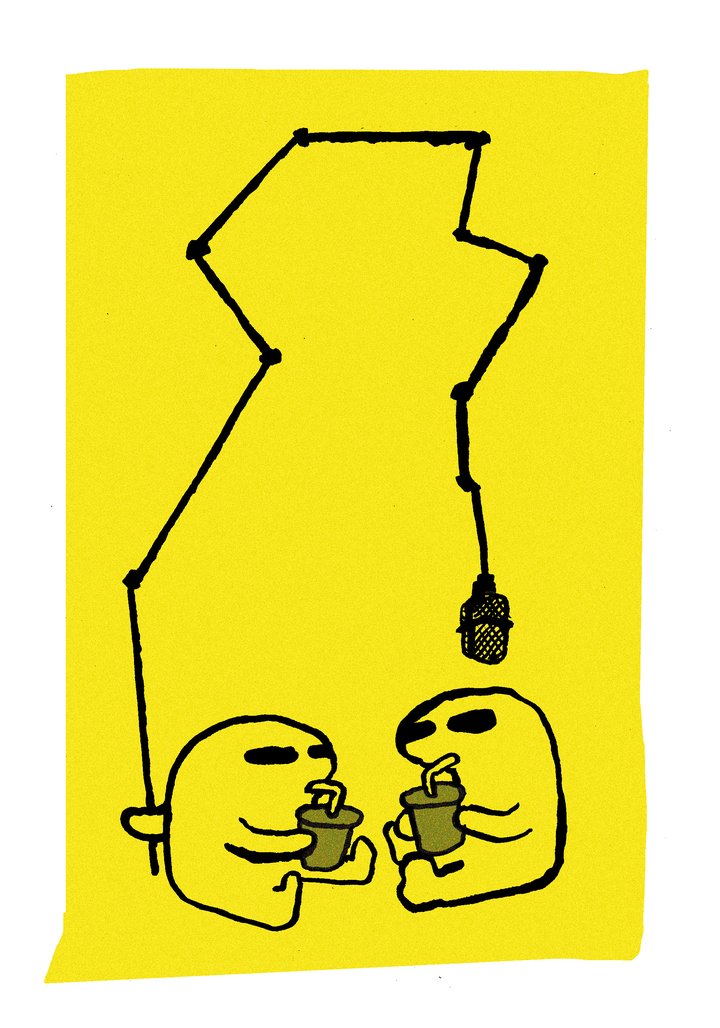
Et si la qualité de l’enquête n’est pas remise en question, si elle est d’intérêt public, le CDJ estime que la RTBF a tiré un peu vite la carte « caméra cachée », sans avoir épuisé les autres possibilités d’enquête. Mais lesquelles ? « Par exemple en interviewant la patientèle des cabinets en cause en sortie de consultation. » La pilule est difficile à avaler du côté Reyers… « Nous n’avons pas été suivis dans nos arguments, on respecte la décision, car la RTBF soutient la raison d’être du CDJ, explique Justine Katz, l’éditrice en chef du magazine. Mais on trouve l’avis particulièrement dur. »
Outre le fait d’avoir recouru trop rapidement à la caméra cachée, sa diffusion a également été pointée par le CDJ. « Le journaliste aurait simplement pu rapporter ce qu’il avait vécu. L’image n’apporte rien », précise Muriel Hanot, secrétaire générale du CDJ.
« La caméra permet de montrer et de démontrer nos constats. Ce n’est pas de la spectacularisation, explique Justine Katz. L’écriture audiovisuelle a ses spécificités. Comment faire sans images ? »
Double filtre
Les médias dégaineraient trop rapidement la caméra cachée ? Justine Katz sort ses comptes pour les cinq ans d’existence de #Investigation : « Nous avons réalisé 150 enquêtes en interne. 23 ont utilisé la caméra cachée. Ce n’est pas une méthode systématique. » Et avant de l’utiliser, un double filtre est posé. Le journaliste doit discuter en équipe élargie (#Investigation), équipe qui en réfère ensuite à la direction du pôle information. Une fois la décision arrêtée, un mail formalise l’autorisation exceptionnelle. « Et après, la pertinence de diffusion est encore discutée », avance Justine Katz.
« L’exception doit sans cesse être réfléchie, cadrée par la rédaction, prévient Muriel Hanot. C’est aussi une question de perception de la profession. Si à tout moment on peut être filmé, le contrat de confiance avec les journalistes sera mis à mal. »
Même s’il a eu recours plusieurs fois à la technique (notamment pour Flic, l’infiltration dans un commissariat), le journaliste français Valentin Gendrot confirme : « L’undercover ne peut pas s’activer à tout moment. Aujourd’hui, je considère que cette technique est particulièrement pertinente quand il s’agit de raconter des lieux de pouvoir. »
Des vies au plus près
D’une infiltration dans un hôpital psychiatrique (10 jours dans un asile de Nellie Bly, 1887) au quotidien dans un hôpital (Les Linges de la nuit de Madeleine Riffaud) ou dans un abattoir (Steak machine de Geoffrey Le Guilcher) en passant par la vie d’un homme (Self-made man de Norah Vincent), l’undercover scrute les autres vies au plus près. Mais pas complètement. Un pied dedans, un pied dehors. « Ce pas de côté » permet d’observer, de partager sans être complètement « une des leurs ». « J’ai de l’argent sur mon compte, un travail. Être pauvre, c’est vivre sur des sables mouvants. Et ça, je ne le connaîtrai pas, estime la journaliste Florence Aubenas, qui a enchaîné les petits boulots fournis par le Pôle Emploi pendant six mois pour son livre Le quai de Ouistreham. Mais on peut décrire le fonctionnement d’une société. Ce sont des petits riens, une expression, quatre haussements de sourcils. Le plus souvent, l’undercover n’est pas une grande révélation, c’est le travail sur une vie quotidienne. »
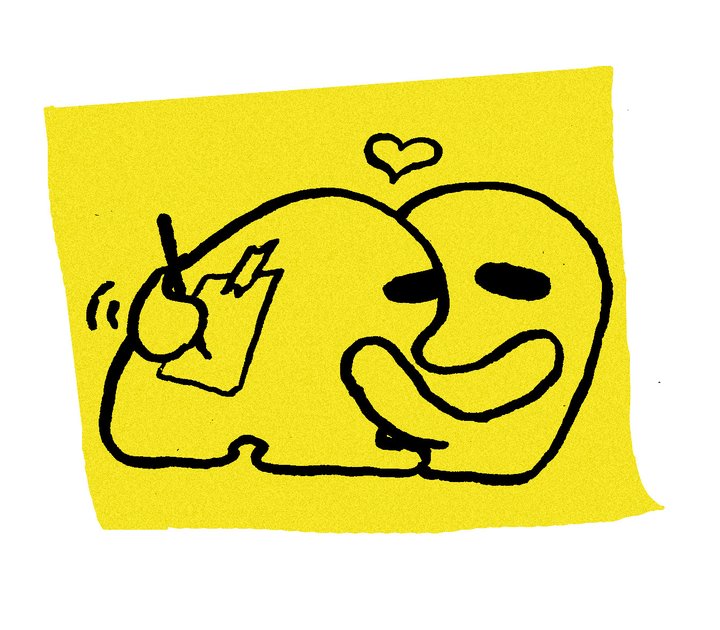
Ainsi, Christophe Charlot a multiplié les petits jobs de l’économie collaborative, sans annoncer son identité de journaliste. L’expérience a donné « UbersizeMe », publié dans le Trends-Tendance. « C’est du journalisme expérientiel, avance-t-il. Cela crédibilise le sujet. Mais ne pas se dévoiler ne signifie pas éviter tous les biais. » Christophe Charlot s’est inscrit sur des plateformes de services « bricolage » ou « cuisine ». Là, les participants s’y retrouvent parce qu’ils ont des facilités pour préparer une quiche ou monter un meuble. Mais pour Christophe, « le bricolage ou la cuisine n’étaient pas forcément ses points forts, ce qui a influencé l’expérience ».
Chercher la limite
L’improvisation est assez répandue parmi les journalistes qui se sont frottés à l’undercover. Pour son enquête sur Nation, Ayrton Jacquemin s’invente un personnage dans la voiture parce qu’« on n’avait pas de plan d’attaque ». Christophe Charlot, lui, se souvient d’une expérience très fluide, « sans grande préparation ». Se mettre dans la peau d’un personnage n’est pourtant pas sans conséquence. Entre se taire, mentir, trahir, la frontière est ténue.
Florence Aubenas se souvient que « les périls et questions sont venus en cheminant. Je rencontrais des personnes chaleureuses et j’ai pris peur. Je me suis rendu compte que ce n’était pas juste un bon petit truc. Cela concerne les autres aussi. Cela m’a semblé plus grave chemin faisant. J’ai mesuré l’abîme sous mes pieds ».
L’abîme en question prend corps dans une question : jusqu’où aller ?
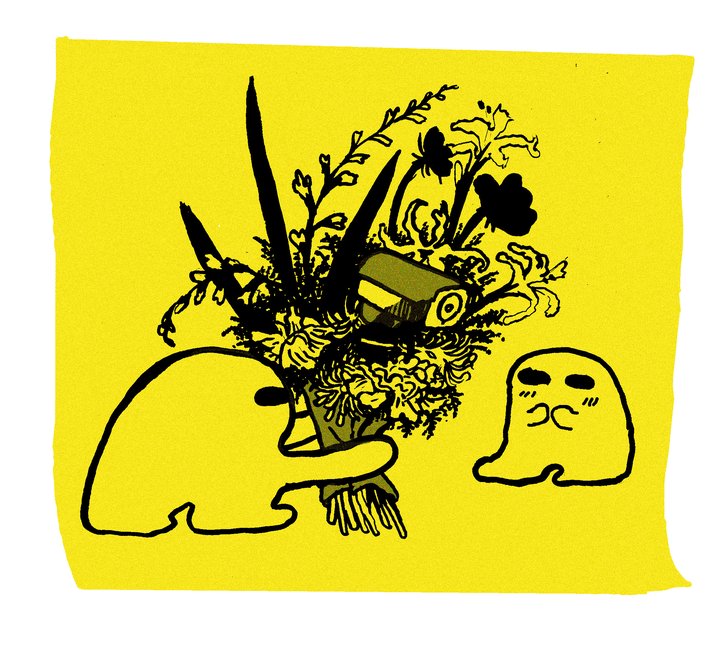
Les limites s’installent au fur et à mesure de l’expérience. « Tu fais un brainstorm avec l’extrême droite. Tu n’as pas envie de leur donner de bonnes idées, mais en même temps, tu ne peux pas rester silencieux tout le temps », s’interroge Jonas Marko. « À partir de quand tu participes au mouvement ? » Le duo a trouvé la solution : « On a joué beaucoup sur la carte de la timidité. » Jonas Marko ajoute : « Je ne me serais pas pardonné de prononcer certains mots. C’était ma limite. »
Pour Valentin Gaudrot, celle-ci s’arrêtera quand il devra couvrir une bavure lors de son infiltration dans un commissariat à Paris. Ce qu’il refusera de faire. Florence Aubenas s’est interdit d’aller dans l’intimité de ses compagnes de ménage. Ted Conover – qui s’est glissé dans la peau d’un gardien de prison aux USA – a décliné l’invitation à dîner d’un collègue. Ces deux journalistes refusent les propositions qui les amèneraient à passer la porte d’un domicile privé.
Ted Conover ajoute un critère : « Ne pas envahir un espace thérapeutique. » Ne pas intégrer des groupes d’entraide où des personnes en souffrance confient leur vulnérabilité dans des cercles d’initiés. Pour lui, l’undercover est « la flèche nucléaire dans le carquois du journaliste ». L’arme fascine, au point qu’une émission allemande porte le nom du journaliste Günter Wallraff, maître du genre et auteur d’un livre de référence (Tête de Turc, 1985). Et 138 ans après sa publication, le reportage de Nellie Bly est encore lu.
Mais Ted Conover invite à la prudence avant d’activer cette pratique. « Mentir est une stratégie terrible pour construire des relations. » On ne joue pas avec le nucléaire.