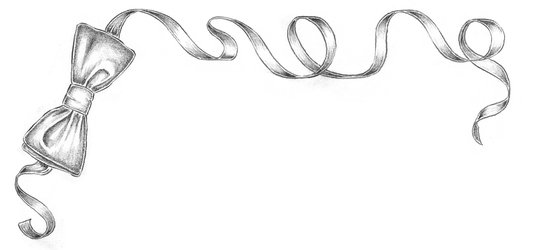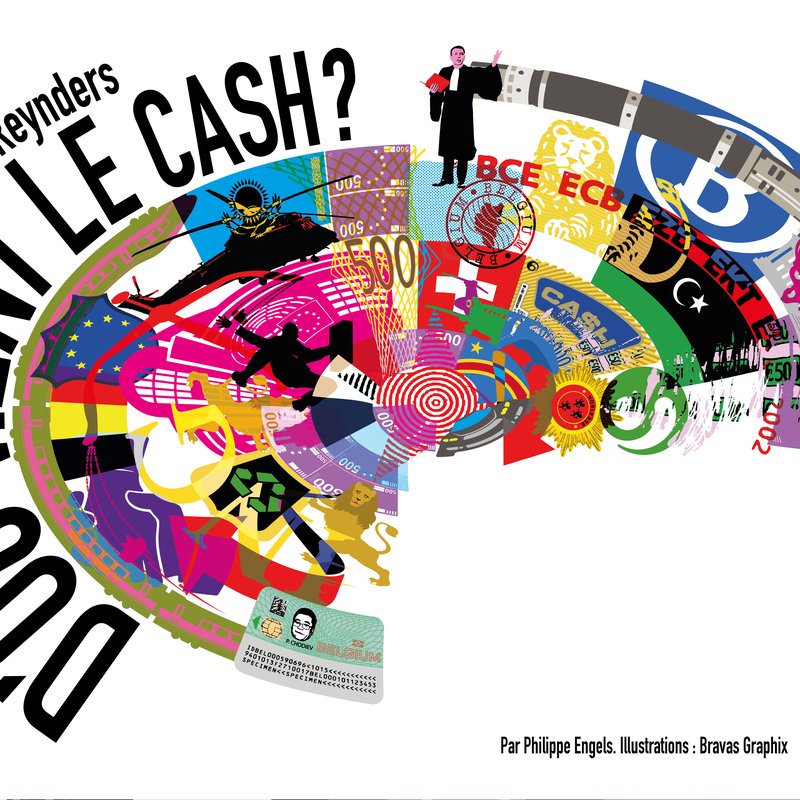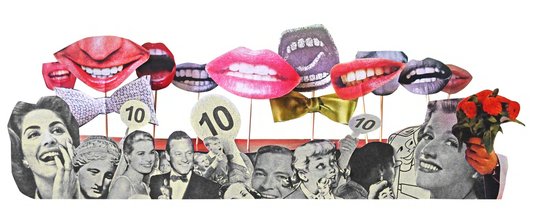Marchands de misère
Le business des maisons de repos « pirates »
Bientôt dix ans après l’affaire du « home de la honte » à Charleroi, la famille Rodriguez-Boulatiour continue d’exploiter dix maisons de repos ou d’accueil à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Médor a réuni des documents et des témoignages qui laissent penser que plusieurs auraient dû fermer leurs portes.

Jeudi 6 octobre 2016. La police débarque dans un home non agréé de Gosselies, une entité de Charleroi. Des plaintes pour maltraitance ont été enregistrées depuis l’ouverture de la Résidence Massimo, trois ans plus tôt. La perquisition est trash. Il y a des rats dans la maison de repos. L’odeur y est épouvantable. Certaines chambres sont privées d’eau chaude depuis une panne de chaudière en décembre 2014.
Ce jour-là, cinq des 46 résidents doivent être hospitalisés, onze autres sont dirigés vers des institutions psychiatriques. Le « home de la honte » est fermé sur-le-champ. Pour l’essentiel, ses occupants sont des personnes précarisées dont les allocations sociales sont captées à la source par le couple de gérants. Des SDF, des gens au stade avancé de la maladie de Parkinson, d’Alzheimer ou atteints de démence, des pensionnés démunis, des personnes ayant un handicap physique ou mental, des victimes d’addictions et en grande détresse psychologique ou psychiatrique. Livrés à eux-mêmes. Privés de repas quand les tenanciers sont en vacances et que les deux infirmiers de nationalité indienne, chargés à la fois des soins et du nettoyage, se montrent incapables de faire tourner la boutique. Une image a marqué les esprits durant l’enquête judiciaire : une résidente à mobilité réduite dormait tout contre un homme atteint d’un cancer du poumon ; elle le savait mourant et pensait le protéger.
Le jugement prononcé devant le tribunal correctionnel de Charleroi, le 2 septembre 2020, a acté « l’extrême gravité des faits », commis contre des personnes en situation de vulnérabilité et que « la société se doit de protéger ». Il a pointé le mépris affiché pour les victimes, ruinées pour certaines, tandis que les prévenus maintenaient « un train de vie luxueux durant des années en se servant de plantureuses rémunérations ». Le principal responsable, l’amateur de belles bagnoles Oscar Concepción Rodriguez, 52 ans, à l’heure du verdict, a écopé de cinq ans de prison, dont la moitié ferme.
À l’affût
La sœur aînée d’Oscar Rodriguez, Maria Esther Concepción Rodriguez, s’en est bien tirée lors de ce procès retentissant. Inculpée pour faux en écriture, abus de confiance et de biens sociaux ainsi que pratiques de marchand de sommeil, via l’asbl créée en famille, elle a échappé à toute sanction. Aux yeux de la justice, Esther Rodriguez a seulement voulu donner sa chance à un frérot dans la conduite de ses affaires. C’est Oscar qui aurait dysfonctionné. Pas elle. Le jugement mentionne que la sœur aînée reconnaît juste « avoir prospecté auprès des services sociaux pour remplir la Résidence Massimo ». Une pompe à aspirer la misère.
En 2016 et 2017, les journalistes Sandrine Warsztacki et Jean-Christophe Adnet ont été les premiers à attirer l’attention sur un business à grande échelle, monté, organisé et entretenu par Esther Rodriguez. « Le home Massimo serait-il la partie émergée d’une plus vaste filière ? », interrogeait la première dans le magazine Alter Échos, le 12 octobre 2016. À la RTBF, le second avait filmé les mêmes maisons de « Madame Esther ». « On y parle de violence, de manque de soins et de malnutrition », avançait-il.
Malgré ça, aucune des maisons bruxelloises ciblées n’a dû fermer, de 2016 à aujourd’hui. L’enquête qu’a menée Médor durant un an pose une double question. Esther Rodriguez et des membres de sa famille ont-ils continué d’exploiter des homes, résidences ou maisons d’accueil dans des conditions indignes ? Les pouvoirs publics ont-ils réalisé les contrôles nécessaires ?
Brutal ennui
Auderghem, printemps 2024. Dans la seule pièce commune qu’ont à se partager les 37 pensionnaires de la Résidence Bruyères II, tout près de la station de métro Demey, le chant d’un résident est à la fois irritant et interpellant : « Qu’est-c’ qu’on s’emmerde ici. Qu’est-c’ qu’on s’emmerde ici ! ! » Il est 18 heures. Il y a une seule infirmière dans la maison, mais elle paraît retranchée derrière un bureau, au sous-sol, près des cuisines et d’une buanderie obsolète. Trois résidents qui regardent la télé interviennent. « Ferme-la ! » La voix pousse quelques ricanements. C’est tendu. C’est fréquent. Mais pas de violence physique, cette fois.
Affalé sur une chaise, le corps coupé en deux, Victor lève péniblement la tête. Il a capté le coup de stress après tout le monde. Lui aussi s’ennuie. Incapable de se mêler à la seule activité quotidienne proposée par la direction, chaque jour à 14 heures (bowling avec quilles en plastique, Puissance 4 ou Uno), il semble seul au monde. La télé, ça fait longtemps qu’il ne peut y connecter son esprit. Jamais une visite. Aucun suivi médical ou psychologique digne de ce nom. C’est le mec que chacun.e cherche à éviter. Il cumulerait un cancer du poumon avec une maladie neurologique très impactante. Dans les couloirs et en rue, il se contorsionne dès qu’il croise quelqu’un : « Cigarette, cigarette », souffle-t-il, montrant avec le bras qu’il lui faut d’urgence un truc à se caler au bec, même un mégot.
Jonas a failli devenir fou avant l’heure en cohabitant avec lui. Lui aussi est « un cas » aux Bruyères. À 45 ans, il a pris l’ascenseur social de haut en bas sans voir passer les étages. Cadre en entreprise, payé 6 000 euros brut, marié, père de trois enfants — puis fracassé par une dépression devenue insupportable. Il a fini à la dérive, petit bateau perdu dans les rues d’Auderghem. Le truc qui n’arrive qu’aux autres. Esther Rodriguez, qui dirige l’établissement depuis janvier 2013, l’a recueilli, lui a offert un toit. Mais depuis qu’il est là, privé d’argent de poche – ses allocations passent en direct de la mutuelle à la résidence –, la déglingue se confirme. Dormir, boire, fumer, s’accrocher aux branches du petit square en face de la résidence en cherchant un bout de conversation avec une âme inconnue. Nous l’avons vu en état de raisonner, de tracer une route fictive vers un retour à la civilisation, d’imaginer occuper un petit studio à 700 ou 800 euros dans le quartier. Mais un an après son admission, Jonas a sombré. La manche du matin au soir aux abords du Carrefour voisin. Le retour atomisé par la bière forte. La perte des derniers repères.
La peur d’être jetés
Aux valves des Bruyères II, Esther Rodriguez la joue cash. Si on agrège bien les prix à la journée, c’est 2 065 euros par personne par mois en chambre double. D’accord, il est difficile de trouver moins cher. Mais ici, il n’y a pas d’eau chaude en permanence. Le fumoir est dégueulasse. Les receveurs de douches comportent des traces de moisissure. Le mobilier est celui d’un home des années 1980. Et puis, il y a ces deux membres du personnel craints par plusieurs pensionnaires – ils parlent tout bas, car ils redoutent d’être envoyés « à Overijse » si la patronne les entend. L’un peut se montrer menaçant lorsqu’ils refusent de se laver dans ces conditions, d’aider à nettoyer leur chambre ou de descendre prendre leurs repas. « L’autre nous insultait, dit une résidente. Il nous balançait des coussins, il nous poussait si on n’obéissait pas à ses ordres. » Finalement, il a dû partir. En juillet 2022, la justice a été saisie d’une plainte pour maltraitance. Un papy de 87 ans s’était retrouvé à l’hôpital avec le visage bleu et en sang. Sa famille estimait qu’il ne pouvait s’agir d’une simple chute. Habitant la région de Chimay, elle reprochait aussi à la direction le long délai de trois jours avant d’être avertie de l’accident.
Sans expérience
Esther Rodriguez s’est lancée dans la gestion de homes, résidences-services et maisons d’accueil en 1998. Elle en a très vite partagé la responsabilité avec ses trois enfants, Yasmina, Hakim et Nabil Boulatiour, lesquels ont été plongés dans le bain dès 19, 20 et 24 ans, ainsi qu’avec d’autres membres de la famille.
Aujourd’hui, notre enquête établit que le clan Rodriguez-Boulatiour contrôle un total de 10 établissements, répartis dans les trois régions du pays. « Non, ce n’est pas vrai, nous a dit Hakim Boulatiour quand nous avons voulu lui parler. Mais je ne suis pas intéressé de parler à un journaliste. Ma mère, non plus. Nous avons eu une mauvaise expérience. » Selon nos calculs et au moment de boucler cette enquête, en mai 2025, environ 400 personnes étaient logées par cette famille. Un mélange de profils qui résulte de la volonté exprimée par le clan familial de s’ouvrir aux maladies neurologiques graves et d’inclure un public socialement très précarisé.
À Bruxelles, les Résidences Bruyères II et Michèle, à Laeken, sont un peu la vitrine du « groupe ». Aucune n’a toutefois été agréée par la Commission communautaire française (Cocof), qui gère les matières francophones de santé dans la capitale. « S’il n’y a pas d’agréation, il n’y a pas de contrôle », reconnaissent les autorités de régulation. Sous-entendu : nous sommes impuissants. Ce vide juridique et politique relatif à de telles maisons « pirates » est éclatant depuis quelques décennies. En vertu d’une ordonnance finalement adoptée en 2018, elles doivent aujourd’hui obtenir un agrément ou fermer, mais rien n’est prévu pour sanctionner celles qui ne sont pas en règle, et cela malgré les plaintes, les signaux d’alerte tirés dans les milieux associatifs et l’affaire Massimo.
Une maison de fous
Woluwe-Saint-Pierre, automne 2024. Ici, c’est pire encore qu’à Auderghem. La maison d’accueil située au début de l’avenue du Putdael est une énigme dans ce quartier de villas cossues niché entre le parc de Woluwe et la forêt de Soignes. Un bâtiment haut de quatre étages paraît à l’étroit entre les services consulaires de l’ambassade d’Iran et les premières maisons de l’avenue. Les lieux sont forcément arborés. Mais pour les occupants de la Résidence de la Forêt, identifiée par une plaque bancale, il n’y a pas un brin d’herbe pour se dégourdir les jambes. Les fenêtres sont occultées par des tentures disparates. De l’extérieur, l’immeuble semble à l’abandon malgré les caméras de surveillance. Son entrée est à 50 mètres de la voirie, éloignée des regards.

Selon le projet d’établissement qu’Esther Rodriguez et son fils Hakim ont présenté en 2011 à la commune, il s’agit d’« héberger, soigner et encadrer » des personnes de 18 à 60 ans ayant des difficultés sociales ou médicales à vivre seules. Sur le papier, un « projet individuel de réinsertion sociale » est convenu avec la direction. Dans les faits, un cadenas est posé sur les grilles de la résidence, chaque soir à 22 heures. La journée, des occupants souvent seuls s’en extraient pour se rendre aux arrêts de tram et de bus de l’avenue de Tervuren. De jeunes Africains s’exprimant en anglais, dont un en fauteuil roulant. Des quinquas à la recherche d’un mégot abandonné au sol. Un « tox » qui s’énerve à la troisième question. Un ado qui parle d’« une maison de fous ». Et William, dont le retard mental est assez vite perceptible : « Oui, ça va, on est quand même bien ici. La nourriture est bonne. J’ai la télé dans ma chambre. On ne frappe pas comme à Forest. » William veut parler de la Résidence Duden (établie sur le territoire de Forest, même si la famille Rodriguez-Boulatiour l’a fictivement localisée à Schaerbeek), dont le projet d’établissement est comparable.
Dès 2012, selon des documents, témoignages et plaintes que nous avons rassemblés, les autorités communales de Woluwe-Saint-Pierre s’inquiètent des conditions de vie dans la Résidence de la Forêt. Le nouveau bourgmestre Benoît Cerexhe (ex-ministre cdH, aujourd’hui Engagés) vient d’être élu. Cela fait seulement un an que les Rodriguez/Boulatiour ont ouvert la résidence, dans une ancienne maison de repos insalubre. Les premiers rapports administratifs pointent déjà ceci : des chambres de moins de 9 m2, une odeur nauséabonde, des coins sanitaires insalubres, du vinyle vétuste au sol, rien de prévu pour les personnes à mobilité réduite. « Peut-on accepter des espaces de vie si restreints et rudimentaires dans un bâtiment vétuste […] ? Est-ce que l’encadrement professionnel actuel est suffisant par rapport aux missions et aux buts que la résidence s’est fixés ? », se demande alors la commune. Mais la maison d’accueil reste ouverte : Woluwe-Saint-Pierre se dit « en manque de places d’accueil d’urgence » pour une population « hautement fragilisée ».
Que faire avec les rejetés des CPAS, celles ou ceux qui ne trouvent pas de place dans les hôpitaux psychiatriques, les anciens prisonniers, les victimes d’addiction abandonnées dans nos rues ? Cette question éthique nous a accompagnés durant cette année d’enquête.
Les pieds qui collent
En juillet 2017, l’administration communale revient sur place et établit un nouveau rapport alarmiste. Le médecin présent lors de cette visite surprise apparaît « peu responsable », « désagréable » et « malpoli ». Il faut dire que ce toubib de 74 ans a subi la perquisition à la Résidence Massimo à Gosselies, dont il était l’un des administrateurs. À la Forêt, rien n’a changé en cinq ans. Aucune traçabilité des aliments servis, pas de respect des règles d’hygiène. Un bâtiment sale, « où on ne sait pas où et comment une personne à mobilité réduite peut prendre une douche », relève l’administration. Mais, cette fois encore, la résidence de l’avenue du Putdael reste ouverte.
On arrive alors au début de 2022. Dix ans de statu quo et de négligences. L’ami d’un résident témoigne. Il nous montre des clichés. Des fils et des prises électriques trop près des réchauds, des poubelles qui traînent, des toilettes sans portes, des matelas de 5 cm, de l’humidité dans les murs et toujours ce vieux vinyle inflammable. « Les résidents étaient vraiment obligés de se débrouiller. C’est l’une d’entre eux qui faisait la lessive pour tout le monde, en échange d’un fruit. La pharmacie n’était jamais fermée et les infirmiers débordés se faisaient aider par les occupants pour la distribution des médicaments. À plusieurs reprises, en janvier et février 2022, il n’y avait rien dans les assiettes, le soir », poursuit notre témoin. « J’avais les pieds qui collaient au sol. J’étais content de pouvoir quitter les lieux », dit un policier.

Un document établi par ce résident en colère détaille, photos à l’appui, le contenu des repas, identiques d’une semaine à l’autre, sauf un vendredi et un samedi sur deux. Très souvent des burgers de poulet, des frites ou des croquettes, de la compote en pot, d’autres aliments faciles à manger avec les mains ou à la cuillère pour éviter que les patients atteints de démence ne plantent leur fourchette dans la main d’un voisin de table. Moyenne du coût journalier des repas, selon l’estimation contenue dans la note du résident : 1,82 euro. Une paille au regard du tarif de séjour, non officiel, tournant à l’époque autour des 800 ou 1 000 euros par mois.
En avril, cela se transforme en une plainte formelle auprès de la police locale. Et en un long procès-verbal transmis au parquet de Bruxelles. Ça bouge enfin. En apparence, en tout cas. « On a fait la totale, dit-on au commissariat. Sécurité, hygiène, bien-être au travail, respect des lois sociales. » S’ensuivent un coup de peinture, des engagements à ne plus filmer les résidents à leur insu, quelques travaux jugés cosmétiques par les riverains mais suffisamment importants aux yeux de la commune. On pourrait imaginer que Woluwe et son bourgmestre se concertent alors avec les autorités régionales. Du tout. Quand Médor a interrogé l’agence régionale Vivalis, chargée des problématiques sociosanitaires, voici ce qui nous a été répondu : « En ce qui concerne Duden et la Forêt, ces établissements ne sont pas connus de nos services. Nous allons donc examiner leur situation. »
De son côté, le bourgmestre Cerexhe indique à Médor : « La Résidence (de) la Forêt fait l’objet d’une attention particulière de la part de la commune. J’ai d’ailleurs convoqué Monsieur Boulatiour […] pour faire le point sur la sécurité de la résidence au niveau des attestations de visite du SIAMU, le paiement de l’assurance responsabilité civile objective, le suivi des prescriptions AFSCA et la conformité électrique. Il a pu me transmettre des documents à jour attestant que tout était à priori en ordre. » Il s’agit donc d’une maison pirate où il y a eu des constats policiers sévères et l’ouverture d’une enquête judiciaire. Mais pour le bourgmestre, « a priori », tout serait désormais « en ordre ». Et la Région, codirigée par son parti, dit ne pas connaître cette résidence.
« Il est toujours aussi terrible d’y travailler vu le climat de suspicion généré par la nouvelle responsable, très autoritaire », souffle pourtant une infirmière. La nuit surtout, des cris de détresse résonnent toujours dans l’avenue. En 2025, plus de dix ans après la constitution de la Résidence de la Forêt, sous la forme d’une asbl, il est en tout cas impossible de jauger sa gouvernance financière : tout comme Duden, elle n’a jamais publié le moindre compte.

Le feu
En Wallonie, Esther Rodriguez et sa famille élargie ont pu faire reconnaître officiellement plusieurs maisons de repos. Deux, à ce jour. « Nous savons que l’affaire Massimo trotte encore dans les têtes. C’est bien compréhensible, commente-t-on à l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ). Rien n’est jamais tout blanc ni tout noir, mais, pour l’instant, nous n’avons rien de négatif à vous dire concernant cette famille. Dans les deux résidences où notre agence vient d’accorder son agrément, à Sombreffe (province de Namur) et à Gosselies (sur les ruines du home Massimo, NDLR), les gens sont bien logés et nourris. Nous opérons des contrôles réguliers. Les résidents ne sont pas parqués. »
Au sud du pays, c’est le cadet des Boulatiour, Nabil, qui tient la boutique. En octobre 2022, il a ouvert une nouvelle implantation, la Résidence Lyla, à Profondeville. Celle-ci n’a pas encore reçu le feu vert de l’AVIQ « en raison d’une plainte ».
En Flandre, c’est à Overijse qu’Esther Rodriguez et les siens ont fixé leurs amarres. Ils y possèdent plusieurs biens immobiliers, dont un petit château racheté il y a vingt ans aux héritiers de l’empire Côte d’Or. Les fêtes de famille s’y déroulent avec le sourire alors que deux des trois résidences détenues dans la commune connaissent de sérieux problèmes. Après plusieurs avertissements donnés par l’équivalent flamand de l’AVIQ, l’agence Zorg en Gezondheid, la Résidence Ofelia a dû fermer ses portes en juin 2024. Extraits d’un rapport de visite effectué quelques mois auparavant : plusieurs cages d’escalier n’étaient pas sécurisées, des médicaments administrés n’étaient pas identifiables, la famille d’un patient dément n’avait pas été avertie des mesures de contention qui lui étaient appliquées, une patiente avait été découverte affalée sur sa chaise avec un morceau de pain bloqué dans la bouche, les soins n’étaient pas assurés par du personnel qualifié.
À la Résidence Yasmina, à 1 kilomètre et demi de là, les rapports récents que nous avons pu lire comportent des griefs comparables. Se dirige-t-on vers la même issue ? Auprès de l’agence Zorg en Gezondheid, on temporise. Inge Lenseclaes, la bourgmestre N-VA d’Overijse, n’a pas répondu à nos sollicitations. Le 20 décembre 2024, une catastrophe a été évitée de justesse. Les pompiers de l’est de la province ont été appelés peu avant 16 heures. La fumée était à ce point dense que le voisinage a été invité à fermer portes et fenêtres. Sur les 34 occupants, sept ont dû être évacués par les secours. De cela aussi, nous aurions aimé parler avec Esther Rodriguez (lire l’encadré). Plusieurs questions lui ont été soumises par écrit. Elle ne nous a pas répondu.
Épilogue
Sur ces questions de vétusté, de sécurité, voire de maltraitance qui traversent les frontières régionales, notre enquête révèle une grande compartimentation de l’information. Reflet d’un dysfonctionnement de la Belgique fédéralisée, assurément. Ainsi, en Flandre, nos interlocuteurs disent n’avoir jamais été alertés du cas Massimo. Tandis qu’en Wallonie et à Bruxelles, ils affirment ignorer que le parquet de Hal- Vilvorde maintient ouverte une instruction judiciaire visant la famille, aujourd’hui encore soupçonnée de pratiques de marchand de sommeil. Comme à Gosselies, il y a dix ans.
Avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles
-
L’asbl Résidence Massimo.
↩ -
Qui fait partie des 19 cofondateurs/fondatrices de Médor.
↩ -
https://www.alterechos.be/home-massimo-une-affaire-de-famille/
↩ -
Tous les prénoms ont été modifiés.
↩ -
Une photo a été diffusée par Sudinfo, le 29 juillet 2022.
↩ -
La villa Michiels, entourée par un parc public qui fait la fierté de l’entité de Malaise.
↩