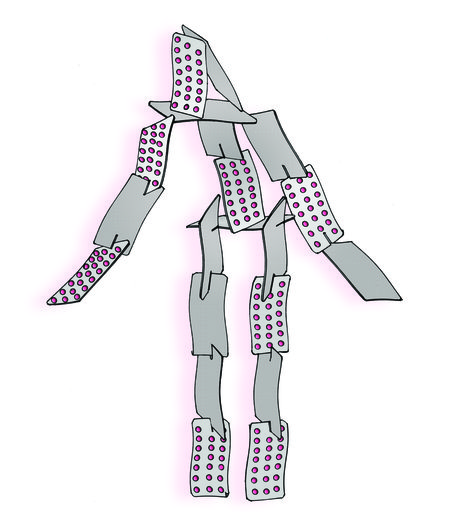Figure fondatrice du cinéma palestinien, Michel Khleifi a consacré son œuvre à fixer la mémoire d’un peuple menacé d’effacement. Cet artiste majeur donne une place centrale aux femmes et dénonce, avec constance, la violence de la colonisation. Installé en Belgique depuis les années 1970, il a aussi contribué au développement de notre cinéma. En 2019, la Cinematek a restauré l’ensemble de ses films.

Avril 2025. C’est un jeudi matin pluvieux, dans un centre culturel de Laeken. Le cinéaste belgo-palestinien Michel Khleifi doit intervenir après la projection de son film Ma’loul fête sa destruction, réalisé 40 ans plus tôt. Celui-ci raconte la tradition du « pic-nic commémoratif » effectué chaque année à Ma’loul en Galilée pour célébrer la mémoire de ce village, détruit par les forces israéliennes en 1948 et remplacé par une forêt de pins qui a été plantée à la mémoire des victimes du nazisme. Ironie de l’histoire, cette fête du souvenir se tient le jour de l’indépendance d’Israël, le seul de l’année où les Palestiniens peuvent circuler sans autorisation.
Le réalisateur arrive, souriant. Pourtant, ces dernières semaines, il se sent désarmé. « Gaza est en train de me tuer », souffle-t-il, la voix serrée. En guise de réconfort, il fait le parallèle entre le sionisme et la mafia, et cite le juge italien Giovanni Falcone. « La mafia, comme tous les phénomènes humains, aura une fin. »
Michel Khleifi, chaleureux, se lance alors dans une histoire qui en contient mille pour raconter la genèse de son film. Quand il était gamin à Nazareth, il y avait un couvre-feu militaire. Sa famille peignait les ampoules en bleu pour que la lumière ne soit pas visible de l’extérieur par les patrouilles de soldats israéliens. Tout le monde était donc bleu, son papa, sa maman. Ça teintait toutes leurs soirées. Plus tard, étudiant en théâtre à l’INSAS, il a découvert la période bleue de Picasso. Sa surprise fut immense : sa famille l’avait vécue sous l’occupation militaire israélienne.
À 14 ans, en 1964, il arrête l’école pour aider sa famille en travaillant dans un garage israélien à Haïfa. Et c’est le long du trajet de bus qu’il découvre Ma’loul. Plus tard, à travers l’histoire de ce village, il relèvera le défi de raconter « la complexité de la situation du Proche-Orient » de manière pédagogique et poétique dans un film de 33 minutes. Khleifi filme des pieds qui foulent cette terre volée. C’est au niveau du sol que les mémoires du récit se tissent. Une idée inspirée d’un vers du poète palestinien Mahmoud Darwish : « Quand tu marches, fais attention, tu marches peut-être sur le rêve de ton père ou de ton grand-père. »
Même subjective, la mémoire vécue reste, pour le cinéaste, plus proche de la vérité. Dans le film, un vieil homme se tient sur l’emplacement supposé de sa maison détruite. Il se souvient, mélancolique : « Les gens venaient boire de l’arak. Manger des abricots et des amandes… Mais le mûrier… qu’est-il devenu ? Est-il mort ? A-t-il disparu ? » Le vieil homme s’inquiète pour cet arbre fruitier comme pour un membre de sa famille. « Pourquoi sont-ils venus ? », demande le réalisateur, en parlant des Juifs. Le vieil homme répond, amer : « Je ne sais pas, moi. Je ne les ai pas emmenés ici. Va demander aux États-Unis, à l’Angleterre, à l’Italie, à l’Allemagne, à la Belgique, à la Hollande, à la Pologne… » Il fait référence à la partition de la Palestine en 1947, par les Nations unies, en deux États, l’un juif, l’autre arabe. Khleifi résume le problème palestinien simplement – « On m’a pris ma terre, je veux ma terre » – mais entre ces deux phrases, il y a un vide vertigineux. « Le peuple palestinien, pour revendiquer ses droits, doit apprendre l’histoire occidentale, il est pris dans une énergie historique qui le dépasse. » Peut-être que c’est là, dans cette béance, que naît le cinéma de Michel Khleifi.
Sauver les traces
Très tôt, Michel Khleifi comprend qu’il faut fixer la mémoire de la Palestine, qu’elle est en danger. C’est ce qui l’a poussé vers le cinéma plutôt que le théâtre, dont il est passionné. Il veut avoir un impact. Cette idée devient une obsession : « Je connais les sionistes, et comme tous les criminels, ils veulent effacer les traces. » Le poète israélien Haim Gouri, que Michel Khleifi lit en hébreu et qui a lui-même combattu au sein d’une milice sioniste, le regrette : « Tout ce que nous avons aimé, nous l’avons détruit. »
Tout jeune, avant d’avoir peur lui-même, le cinéaste dit avoir senti la peur des adultes. Il se souvient du massacre de Kafr Qassem, en 1956 (48 civils arabes tués par la police des frontières israélienne), des violences et humiliations quotidiennes, et des arrestations, qu’il observait, curieux, avec ses amis. À la fenêtre du commissariat, ils criaient aux prisonniers : « Vous inquiétez pas, on est avec vous ! » La résistance, il la voit très vite comme un acte d’amour, de lien. À 17 ans, il s’est forgé une conviction : un militant vivant vaut mieux que mille morts. Il va donc partir, pour s’émanciper de sa famille et d’Israël. Il ne veut pas passer sa vie en prison. Il doit construire « quelque chose » pour la Palestine.
Un jour, sa mère lui dit qu’il peut garder l’argent qu’il gagne : « Tu économises, tu ouvres un garage, tu te maries. » Michel Khleifi invente qu’il veut se spécialiser en mécanique, tout en rêvant secrètement d’étudier le théâtre à Londres.
Il atterrit finalement à Wavre, chez un proche. De la Belgique, il ne connaît alors que la colonisation du Congo, à travers les revues communistes rapportées par son père ouvrier. « Un cadeau inestimable », qui l’ouvre à l’internationalisme : « Trouver la fraternité avec les autres, il n’y a rien de plus beau. Je suis sensible à toute forme d’oppression. Je n’aime pas l’ethno-narcissisme propre au sionisme. »
À Bruxelles, en 1970, il se retrouve dans une manifestation étudiante contre la « loi Vranckx », qui vise à expulser les étudiants étrangers après leurs études. Il fuit les charges de police avec un groupe qui l’amène ensuite à l’Office des étrangers, où on lui dit d’apprendre le français. Il se souvient d’un accueil magnifique et bienveillant. Il découvre avec joie qu’il peut étudier les arts sans diplôme du secondaire. Le petit voyou garagiste de Nazareth réussit alors son entrée à l’INSAS, en théâtre-radio-télévision. Il travaille ensuite à la RTBF, réalise des reportages en Palestine. C’est là qu’il comprend qu’il lui faut inventer une autre manière de filmer, brouiller les frontières entre fiction et réalité. Il se lance dans son premier film.

Ne pas mentir
La Mémoire fertile, premier film palestinien sélectionné à Cannes, en 1981, à la Semaine de la Critique, suit deux femmes : Sahar, écrivaine à Ramallah, et Farah, paysanne à Nazareth, tante du réalisateur. Deux résistances à l’occupation israélienne : l’une par les mots, l’autre par la terre. Michel Khleifi comprend vite que les hommes sont dans le discours politique, ils « donnent des leçons » ; les femmes, elles, assument leur ressenti, partagent leurs sensations. Comment dès lors raconter au féminin ? Le cinéaste rejette la structure classique (montée, climax, chute) calquée sur les schémas de pouvoir, au profit d’une forme horizontale, comme la vie quotidienne. « Ce qui m’a frappé, dit-il, c’est que même la jouissance, chez l’homme, est verticale : ça monte, et puis plouf, ça retombe. Tandis que chez la femme, c’est horizontal, ça se propage, comme quand on jette une pierre dans l’eau, les petites vagues s’étendent à l’infini. » Alors, il ose une forme féminine pour un film politique. Chez Khleifi, la résistance n’est pas seulement contre l’occupation ; elle est aussi contre le patriarcat.
Dans une scène mémorable, sa vieille tante refuse de vendre sa terre aux Israéliens. Elle s’oppose, calmement mais catégoriquement, malgré les injonctions de son fils. Après une projection familiale, le réalisateur lui demande son ressenti par rapport au film. Elle répond : « Je n’ai pas menti. » Il lui sourit : « Moi non plus. » Et de conclure : « Ma tante m’a appris que l’art, c’est de ne pas mentir. »
Fort de cette leçon, il fonde avec Thierry Odeyn et Eric Pauwels la « ligne réalité » à l’INSAS. Cette pédagogie du réel, Michel Khleifi la définit par ces quelques mots : apprendre à l’étudiant à voir et à entendre pour lui permettre de déclencher un processus de réflexion sur le réel. Patrick Leboutte, historien du cinéma et également professeur dans cette école bruxelloise, rappelle combien cette approche a été la marque de fabrique de l’institution.
Pendant les années 1970, le cinéma documentaire est souvent militant, voire propagandiste. Khleifi s’en méfie. La réalité pour lui est polysémique. Il n’y a pas d’objectivité. Cadrer, c’est forcément exclure. « Et pour trouver la complexité, explique Patrick Leboutte, il faut partir de ce qui nous peuple, dans un mouvement dialectique : de l’intérieur vers l’extérieur. » L’historien rappelle aussi qu’à l’époque, une bonne moitié des cinéastes qui représentent la Belgique à l’international sont nés de l’autre côté de la Méditerranée : Borhane Alaouié, Néjia Ben Mabrouk, Mahmoud Ben Mahmoud… Aujourd’hui plus que jamais, l’historien invoque l’urgence de revoir les films de Khleifi. « Les images d’actualité nous pétrifient, dit-il. Le cinéma est l’antidote. Khleifi nous lie à des récits humains. Il fait remonter la mémoire fertile pour féconder l’avenir. Peut-être qu’il ne reste plus que l’art comme lieu de rencontre, et Israël essaie de détruire cela aussi. »

Joies et souffrances sous l’occupation
Pour son premier film de fiction, en 1987, Michel Khleifi continue de s’ancrer dans le réel et cherche à raconter la joie sous l’occupation, convaincu que l’expérience palestinienne peut aussi apporter quelque chose de précieux à la société humaine. Noce en Galilée raconte un mariage dans un village palestinien placé sous le couvre-feu. Dans le cinéma de Khleifi, seuls la vie et le quotidien sont bien réels, la politique et la religion sont des mythes. Dans une scène suspendue entre documentaire et tragédie, le cheval des mariés s’égare dans un champ de mines, coincé entre la vie et la mort.
Plus tard, le réalisateur racontera que cette image est née de deux anecdotes : un paysan arrêté parce que son âne avait franchi une frontière invisible pour lui, et celle sur le tournage d’un téléfilm américain, d’un berger dont les moutons, sourds aux ordres en hébreu ou en anglais, ne répondaient qu’aux sons familiers de leur maître. Face à la démonstration de force technologique de l’occupant, le film célèbre un lien intime à la terre, une fidélité organique aux lieux. À la fin du film, les villageois révoltés descendent dans la rue contre l’occupation militaire. Quelques mois après sa première à Cannes, en 1987, où le film reçoit le prix de la critique, le réel rattrape la fiction et la première Intifada éclate.
Sur le film suivant, Cantique des pierres, son expérience de cinéaste se complique. Un de ses collaborateurs est blessé par balles. On est alors en 1988, toujours en pleine Intifada. Dans l’urgence des événements, Khleifi veut raconter les histoires de quatre enfants tués par l’armée israélienne à travers les voix de leurs familles. Mais ça ne donne rien, les témoignages sont indistincts ; comme une sorte de discours automatique pour la presse. C’est là qu’il pense à Hiroshima, mon amour, sorti en 1959. Dans son Cantique, il écrit un dialogue poétique à deux voix. Et deux récits finissent par s’entrelacer. Celui, théâtral, d’anciens amants séparés par l’exil. Et celui, documentaire, du quotidien palestinien au cœur de l’Intifada. Les enfants, qui occupent une place centrale dans le cinéma de Khleifi, jouent avec des balles en caoutchouc récupérées après les affrontements. Ils alignent différentes douilles, connaissent leurs usages. Eux n’ont que des pierres. Quand le réalisateur leur demande s’ils ont peur, ils répondent sans hésiter : « Non, c’est eux qui ont peur », en parlant des soldats israéliens.
Le film fait sa première à Cannes en 1990. Là où les critiques occidentales saluent la démarche cinématographique, Khleifi provoque des controverses dans le monde arabe. Son ami et ancien étudiant Omar Al-Qattan explique que montrer les militants en position de vulnérabilité ou de fragilité a été vu comme une tentative d’affaiblir le discours officiel de propagande.

Gaza, terre d’accueil
Le Conte des trois diamants, tourné au début des années 1990, est le récit initiatique d’un premier amour, dans le contexte du blocus de la bande de Gaza. Youssef, enfant débrouillard, tente de franchir les frontières de Gaza. Cette enfance sous occupation fait écho à celle de Michel Khleifi, lui aussi très tôt par le désir de traverser les barrières imposées par Israël aux « Palestiniens de 48 », les rescapés de la Naqba (la fuite forcée), exilés de l’intérieur. Michel Khleifi voit « la nécessité de reconstruire le monde des enfants de Gaza et leur droit de rêver et d’être aussi libres que tout autre citoyen du monde. Une société ne peut être construite sans la créativité de ses enfants ».
On est en 1994, juste après les accords d’Oslo. L’espoir de paix est permis. On se prépare au retour de l’icône palestinienne Yasser Arafat, le président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Mais le tournage commence le jour du massacre d’Hébron. Le 25 février, à l’aube, un colon israélien tue 29 Palestiniens, en blesse 125 autres en prière dans le Tombeau des patriarches. C’est un vendredi, en plein ramadan. Vincent Canart, premier assistant réalisateur, se souvient du choc : à Netzarim, la colonie voisine de l’orangeraie où ils tournent, on diffuse de la musique festive pour célébrer l’attaque terroriste. Alors qu’on craint des émeutes à Gaza, la BBC, coproductrice, souhaite interrompre le tournage, mais l’équipe belge choisit de rester, par respect pour ses collègues palestiniens. Une décision qui, selon Vincent Canart, servira le film.
Michel Khleifi se souvient qu’on les prenait pour des fous : « En plein blocus, nous tournions des scènes avec de fausses armes et des voitures grimées en jeeps militaires israéliennes. » Vincent Canart évoque une équipe légère, mobile, toujours bien accueillie par la population et rarement inquiétée par l’armée : « Une fois ou deux, ils inventaient une “zone militaire” pour nous bloquer ; on changeait juste d’endroit. » Il faut imaginer le hors-champ : un plateau improvisé, encerclé par mille curieux, les silences presque impossibles à obtenir. En revoyant le film, Canart confie : « C’est vraiment Gaza tel que c’était. Même si c’est un conte, ça me rappelle les films de guerre de notre enfance : L’armée des ombres, La grande vadrouille… La pression constante, les jeeps, le regard baissé. Toujours en alerte, toujours profil bas. »
Occupants et occupés
En 2003, après le déclenchement de la seconde Intifada, Michel Khleifi et l’Israélien Eyal Sivan réalisent ensemble Route 181, fragments d’un voyage en Palestine-Israël, film fleuve de quatre heures qui suit les frontières tracées par la résolution 181 des Nations unies (1947), laquelle a provoqué la première guerre israélo-arabe. Dans la première partie du film, à Masmiyé, dans l’une des dernières maisons arabes d’un village rebaptisé Bnei Re’em, un jeune homme évoque le quotidien du double standard auquel il est confronté : « Je vais pleurer chaque fois que je vois “morts aux Arabes” ? ! Je te défie d’écrire une seule fois “morts aux Juifs” n’importe où, et toute la presse internationale débarque. Tous nos amis étaient juifs… Aujourd’hui, c’est fini, on n’est plus des humains à leurs yeux. » Pour ce jeune homme, le conflit n’oppose pas les Juifs et les Arabes, mais les occupants et les occupés.
Aujourd’hui, Michel Khleifi se sent désarmé par la cruauté et hésite à écrire encore. Du théâtre peut-être ? C’est qu’il faut continuer à transmettre une culture de la résistance, qui défend la vie et la fraternité. « Même si cela doit prendre quatre mille ans, assure-t-il, l’erreur serait de croire qu’on va lâcher. »
Mardi 1er juillet à 18h30, Médor organise avec le cinéma Galeries (Bruxelles) une projection du film "Le conte des trois diamants" de Michel Khleifi. Cette projection sera suivie d’une discussion entre Pauline Beugnies (autrices de cet article), Michel Khleifi et le public. Plus d’infos ici.
-
Idéologie et mouvement nationaliste qui vise à établir un État juif en Palestine. Khleifi rappelle que le sionisme est né à la fin du XIXe siècle.
↩ -
Dans un texte de 1992 republié dans Mémoire fertile, un livre hommage à Khleifi édité par la Cinematek.
↩ -
« De la réalité à la fiction – de la pauvreté à l’expression », texte de Khleifi paru dans El País, février 1997.
↩