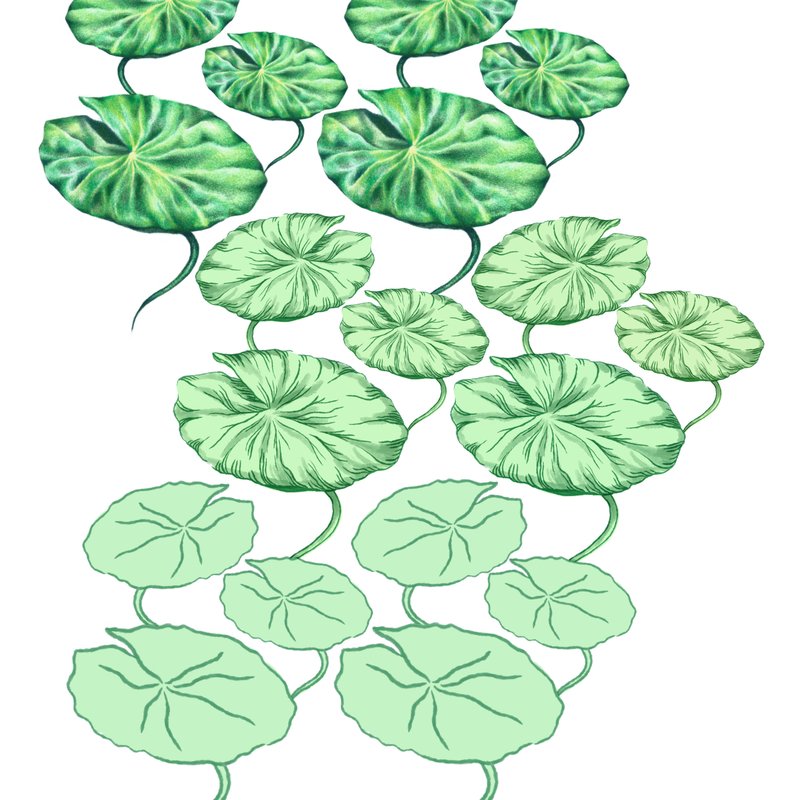Le temps du virus
L’édito du Médor de juin 2020 (n°19)
Textes (CC BY-NC-ND) : L’équipe de Médor
Publié le

Le 2 mai dernier, sur les réseaux sociaux. L’image de gens vus de dos sur un escalator. Et ce commentaire : « La notion de distanciation sociale est encore loin d’être une réalité pour tous. » Nous en étions donc arrivés là. Nous photographier en catimini et clouer l’autre au pilori.
Nous n’en menions pas large. Le philosophe André Comte-Sponville qui interroge sa liberté et prône le retour à une vie normale « pour arrêter de sacrifier les jeunes » ? « Irresponsable. » La Suède ou les Pays-Bas qui n’adoptent pas un confinement strict ? « Irresponsables. » L’école qui rouvre mais ne rouvre pas vraiment ? « Irresponsable. » Nous ne savions donc qu’une chose : l’irresponsabilité de l’autre. Cet autre, accusé de ne pas la jouer collectif, au moment où il en va de notre survie.
Il y avait de quoi flipper pour l’Humanité. Celle que Patrick Declerck, écrivain amer, a depuis longtemps flinguée. Mais où s’arrête l’individu et où commence la vie en société ? On a tous dû répondre à cette question dans nos relations sociales. On se serre la main, on se touche, on approche la joue, on se tâte le coude, on s’éloigne, on se confine, on s’isole, et puis quoi encore ? Nous avons été contraints à des choix moraux, certains déchirants, comme ces personnes qui n’ont pas pu se serrer dans les bras lors d’un deuil. Qu’est-ce qui était légitime : apaiser la douleur d’un proche ou protéger les autres ?
Le choix était d’autant plus cornélien que ce satané virus avait bien brouillé les pistes. L’égoïsme et l’altruisme se sont entremêlés dans les mêmes objets. Le masque étant autant symbole de peur que de protection. Se calfeutrer devenait un acte de solidarité, rencontrer des êtres aimés, un acte d’égoïsme. Le virus a fait en sorte d’empêcher le choix individuel isolé (impossible de se foutre d’attraper le virus puisqu’on peut le transmettre à notre entourage). Il a uni nos sorts, faisant enfin comprendre au plus buté d’entre nous que nous étions tous liés.
« Je suis un homme ; je considère que rien de ce qui est humain ne m’est étranger », avançait le poète latin Térence. Il s’est trompé. Cela va plus loin : tout ce qui est de l’ordre du vivant, du climat, de la présence sur cette terre me concerne. Nous sommes interconnectés et sujets au bug. Trop occupé à considérer la chauve-souris – ou le pangolin – comme la source du mal, l’homme, ce fou furieux, oublie de voir sa propre responsabilité dans l’apparition d’un virus qu’il combat.
Nos vies cédées
Il y a une piste intéressante pour nous retirer les œillères et nous sortir de l’ornière : prendre le temps de réfléchir. Ça paraît bête à dire, mais cela manque cruellement quand on a la tête en feu. Nous vivons une « famine temporelle », selon le philosophe allemand Hartmut Rosa, pour qui le phénomène « d’accélération » porté par les sociétés modernes est aujourd’hui devenu une « aliénation » collective. Au quotidien, l’individu passe son temps à gérer les urgences. Au niveau collectif, les politiques perdent la maîtrise d’un projet commun. « Paradoxalement, cette course folle s’accompagne alors d’un sentiment d’inertie et de fatalisme », ajoute l’essayiste et journaliste française Mona Chollet.
C’est avec cette « déconcertante fatalité » que nous avons cédé nos existences aux médecins, aux virologues et à un comité pluraliste d’experts : ils ont pris un moment les commandes de l’État. Cet État, la Belgique, mais aussi l’Europe, a montré d’inquiétantes fragilités, des faiblesses. Une incapacité à agir mais également à réfléchir à un projet. Et c’est peut-être là le constat le plus inquiétant ET le plus réjouissant. Nous pourrions relancer la machine sur de nouvelles bases, redéfinir un projet excitant, solidaire, unificateur. Opter pour des choix radicaux. Nous remettre en question et en réflexion : que faire de cette Humanité destructrice honnie par Declerck ?
Un retour crétin à la « normale »… ? Mini(bad)-trip en avion, agrémenté du pire, avec nos artistes à terre, nos infirmiers épuisés, les faibles affaiblis et les marginaux un peu plus en marge. Le monde d’aujourd’hui préparant l’immonde de demain. C’est le scénario le plus réaliste.
Mais traînent quelque part les utopies. Vu le manque de moyens pour nous sauver, détruire les paradis fiscaux ? Après le travail acharné des premières lignes, payer enfin décemment les éboueurs, les conducteurs de bus, et tous les autres utiles présentés comme des tuiles. Et relocaliser l’économie, freiner les avions, développer les transports en commun. Prioriser l’éducation, la justice, la santé. Ne plus accepter aucune limite de moyens ; plutôt réclamer la poursuite des fins. Des solutions existent. Il faut oser les rêver.