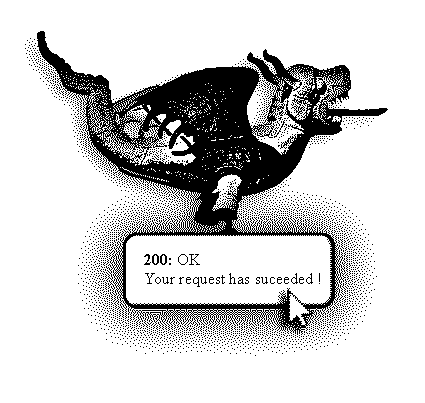Bâillon sur la liberté d’informer
secret-des-affaires
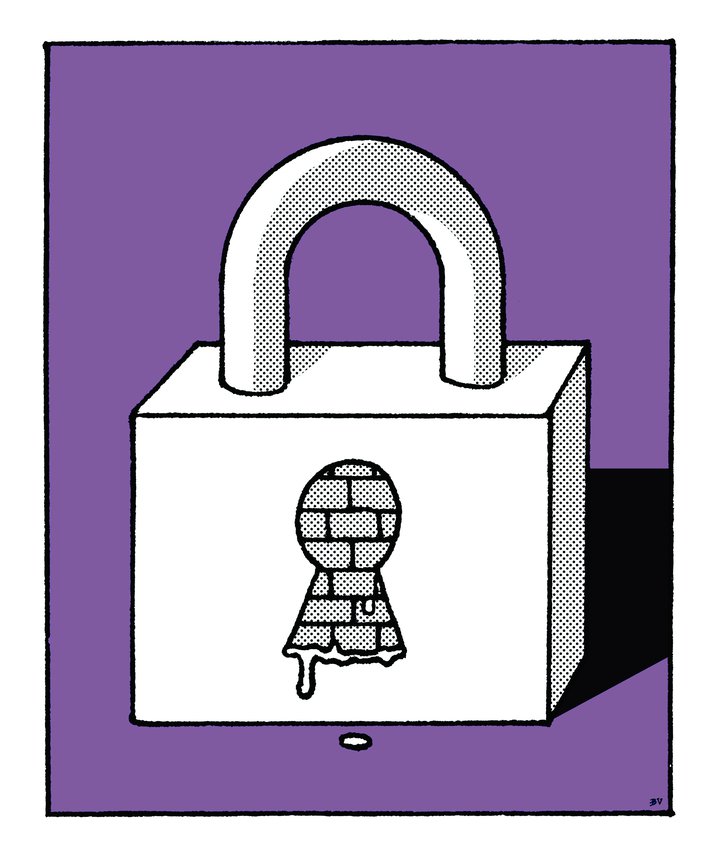
Au Corporate Europe Observatory, ONG qui scrute comment les lobbys influencent les législations européennes, j’ai beaucoup travaillé pour faire connaître, critiquer et rejeter la « directive sur le secret des affaires ». Souhaitez-moi bonne chance : je veux vous résumer 18 mois d’observation en 7 500 signes !
Le 28 novembre 2013, la Commission européenne publiait son projet de directive sur la « protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ». Le texte allait devenir plus connu sous le nom de « directive sur le secret des affaires ».
Ce même jour, Thomas Tindemans, directeur du bureau bruxellois de la société de conseil en lobbying Hill & Knowlton Strategies, écrivait aux trois fonctionnaires de la Commission européenne ayant rédigé le texte : « Gentlemen,
Permettez-moi de vous adresser mes plus sincères félicitations pour l’adoption de cette proposition de directive par la Commission. Il y a encore beaucoup de travail à venir, mais c’est une étape décisive et vos efforts seront fructueux.
Bien à vous, Thomas »
Il pouvait se réjouir : c’est lui qui avait approché la Commission pour la convaincre d’écrire le texte pour le compte de ses clients, un groupe de multinationales surtout françaises et américaines (Air Liquide, Alstom, DuPont, General Electric, Intel, Michelin, Nestlé et Safran) appelé Coalition pour le secret des affaires et l’innovation (TSIC). Le groupe avait ensuite travaillé plus largement avec Business Europe (le patronat européen) et d’autres lobbies (chimie, parfums, semi-conducteurs…).
Élaboration à sens unique
Seuls l’industrie et des cabinets d’avocats d’affaires avaient été consultés par la Commission pendant l’élaboration du texte, jusqu’à une « consultation publique » fin 2012 où les 152 citoyens européens ayant participé se sont prononcés à 75 % contre l’intérêt de ce texte. Seul représentant étatique à y participer, le ministre de la Justice suédois avait glissé en fin de questionnaire que le texte devait être discuté plus publiquement car il pouvait avoir de sérieuses implications pour le droit du travail, la protection des lanceurs d’alerte et la liberté de la presse.
À part les syndicats suédois et le Parti pirate européen, seuls à s’être rendu compte du problème à ce stade, les syndicats et ONG bruxellois – moi compris – n’ont découvert les risques de ce projet de directive qu’à l’automne 2014, huit mois après sa publication par la Commission. Après son examen par les États. Au Parlement, seuls les Verts s’y opposaient activement.
Que sont ces « secrets d’affaires » ? La définition que propose la Commission quand elle veut expliquer le texte au public est claire : des informations gardées secrètes (une recette secrète, des plans de prototype) par une entreprise pour obtenir ou conserver un avantage concurrentiel. Ce dernier mot est essentiel : la justification première de cette directive est de lutter contre l’espionnage industriel, dont l’existence est indiscutable. Pourtant, la définition finale n’est pas aussi précise : les secrets d’affaires, au sens de la directive, sont des informations « secrètes », qui ont une « valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes », et dont le secret a fait l’objet de mesures de protection « raisonnables ». Le temps qu’une jurisprudence s’établisse, et au niveau européen cela peut prendre dix ans, une telle définition peut désigner quasi toute information interne.
Opposition tardive, mais d’envergure
L’autre « cœur » de la directive, avec la définition des secrets d’affaires, est la définition de ce qui constitue leur « obtention, utilisation et divulgation illicites ». Et là les choses sont simples : est illicite toute obtention de secret d’affaires sans le consentement de son propriétaire. Pire : est aussi illicite toute obtention « lorsque, au moment d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer le secret, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret a été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite » (article 4 § 4). Difficile d’imaginer plus large.
Le texte crée donc un droit au secret très large pour les entreprises. Et, ce qui est fou, le monopole de l’information est ici accordé sans contrepartie, contrairement au brevet qui est un monopole temporaire accordé en échange de la publication de l’invention. Seule limite : le secret d’affaires cesse d’exister le jour où il cesse d’être… un secret. Certaines exceptions sont prévues, comme les cas prévus par la loi, la redécouverte par examen (ingénierie inverse) et, mais de manière moins claire, l’activité syndicale et la liberté d’expression et d’information.
Nous avons tenté de mobiliser pour limiter les dégâts, et d’approcher les eurodéputés. Pas facile. La mobilisation s’est faite sur un mode très dispersé, chacun travaillant sur « son » aspect du texte : les syndicats s’occupaient des syndicalistes et des travailleurs, les journalistes des journalistes, les ONG de leurs questions spécifiques.
Pendant ce temps, l’industrie ne restait pas inactive non plus. D’après un lobbyiste indiscret, la TSIC s’employait à « réduire la résistance des socialistes et d’une partie des centristes en fournissant des exemples d’espionnage industriel à la Commission et aux députés ». Qui pourrait s’opposer à la lutte contre les méchants espions chinois ?
Le travail de la société civile a pourtant payé : les exceptions et protections sont moins mauvaises dans le texte final adopté par l’UE. Impossible de publier ici une analyse complète du texte, mais citons les principaux éléments liés à la liberté de l’information : les journalistes ne devront plus démontrer, lorsqu’ils seront poursuivis (le risque persiste), que leur travail était un usage « légitime » de la liberté de la presse ; leurs sources et les lanceurs d’alerte ne devront plus prouver, lorsqu’ils seront poursuivis (idem), qu’il leur était « nécessaire » de publier le « secret d’affaires » concerné ; le juge ne devra plus évaluer s’ils ont agi « dans l’intérêt public » mais bien leur intention de le faire.
Mais le texte reste fondamentalement dangereux. Notre appel au rejet a connu une notoriété allant au-delà de toutes nos espérances : près de 580 000 citoyens européens ont signé des pétitions en ce sens, des centaines d’appels téléphoniques ont été passés pour tenter de convaincre les eurodéputés de rejeter le texte et une vidéo de l’humoriste française Nicole Ferroni ridiculisant les arguments des défenseurs du texte a totalisé plus de 13 millions de vues !
Pourtant le Parlement a largement adopté le texte le 14 avril dernier, seuls les Verts et la Gauche unie votant « contre ». Les socialistes ont été convaincus de voter « pour » par leur négociateur, Sergio Coferatti, qui estimait qu’un rejet du texte en l’état risquait d’annuler les avancées qu’il avait obtenues et que le texte deviendrait, au final, pire (une majorité centre droit/extrême droite étant numériquement possible). L’adoption définitive du texte a eu lieu le 17 mai par le Conseil de l’UE (les gouvernements nationaux).
menace collatérale
Reste la dernière étape : pour que ce cadre juridique devienne une réalité, chaque État doit l’adapter en droit national (et a deux ans pour le faire). L’occasion de revenir sur les problèmes posés par ce texte mais avec une menace collatérale. S’il sera possible à la société civile de limiter les dégâts (par exemple en obtenant que le texte ne s’applique qu’aux espions et aux voleurs), il sera aussi possible à l’industrie de les empirer en détricotant les exceptions ! De plus, là où la Commission n’avait pas le pouvoir d’introduire du droit pénal (peines de prison et amendes), les États seront vivement encouragés à le faire. À bon entendeur…