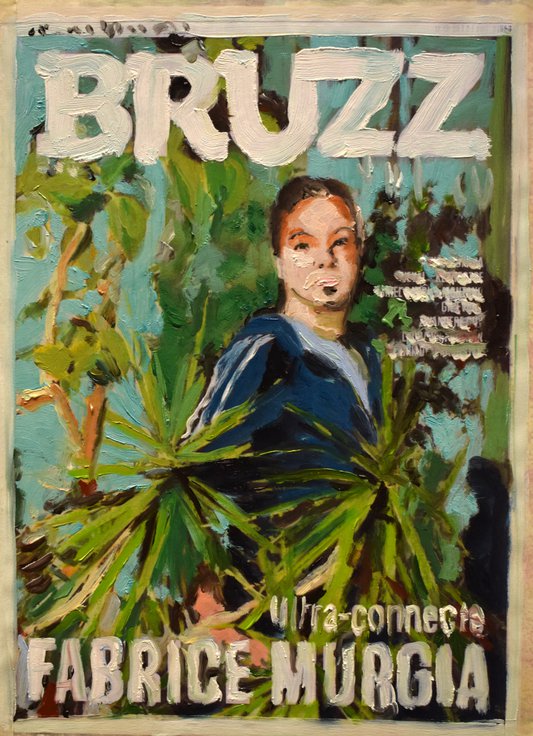Les profs du fond de la classe
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Enquête (CC BY-NC-ND) : Céline Gautier & Chloé Andries
Textes et photos (CC BY-NC-ND) : Ophélie Friberg
Publié le

Au départ, ils sont profs. De français pour Arnaud (le brun très inspiré sur la photo), de religion catholique pour Jérôme (le barbu – aucun rapport avec Jésus). Ensemble, ils ont tout fait : n’importe quoi quand ils enseignaient dans la même école (résidence dans un festival de danse contemporaine avec des élèves en électromécanique, leçon dans un centre commercial, cours sans évaluation), une pièce de théâtre sur l’orthographe, La Convivialité, qui a fait carton plein et énervé quelques mecs à perruque de l’Académie française. Et, enfin, cette interview sauvage à Braine-l’Alleud.
Dans leur pièce de théâtre La Convivialité, dont le texte a été réédité sous le titre « La Faute de l’orthographe », Jérôme Piron et Arnaud Hoedt se permettaient – ô sacrilège – une réflexion critique sur le dogme de l’orthographe. Pourquoi écrire « contraindre » (avec un a) alors qu’il vient de « stringere » comme « astreindre » (avec un « e ») ? À quelle étymologie se rapporte le « d » de « poids » alors qu’il vient de « pensum » ? Pourquoi le participe passé utilisé avec avoir s’accorde-t-il avec le complément seulement s’il vient avant ? L’orthographe française concentre des paquets d’erreurs de moines copistes et de règles absurdes que les petits francophones passent une grande partie de leur scolarité à essayer d’intégrer, sans poser de questions. Lassés de jouer les « curés de la langue », nos deux profs, romanistes de formation, ont fait cette proposition osée : cesser de voir les conventions orthographiques comme les Tables de la loi et s’autoriser à poser sur elles un regard critique. Même dans le foot, il arrive qu’on change les règles, non ?
C’est ce même exercice critique qu’on leur a demandé de faire avec l’école, en général. Histoire de voir si, du fond de la classe, on pouvait bénéficier d’un autre éclairage.
Médor : Jérôme, vous étiez prof de religion catholique. Une passion pour les Évangiles ?
Jérôme Piron : Au tout départ, j’ai été prof de français, mais le programme de français oblige à avoir un rapport formel au programme, alors qu’en tant que prof de religion, j’ai vite senti que j’allais pouvoir réfléchir au monde, avoir des initiatives pédagogiques. Peu à peu, j’ai réussi à imposer ma méthode principale, qui est de cesser d’évaluer.
Pourquoi ?
J.P. Dans le système actuel, l’évaluation fausse le rapport à la matière. L’objectif du prof, c’est le savoir, la compétence de l’élève et, parmi ses outils, il y a l’évaluation. C’est un moyen, et non un but. Mais l’élève fait l’inverse : son but, c’est l’évaluation, et le moyen d’y parvenir, c’est le savoir.
C’est pour ça qu’on a (presque) tout oublié de ce qu’on a appris à l’école !
J.P. Je n’ai jamais étudié le néerlandais dans le but de le parler, mais dans le but d’avoir une bonne note à l’interro. C’est pour cela que j’ai tout oublié.
Pourquoi continue-t-on avec les interros, alors ?
J.P. Une des principales difficultés de l’école, c’est la résistance des profs. Malgré eux d’ailleurs. On le sent très fort avec l’évaluation, car, la principale source de motivation des élèves, c’est la peur de l’échec. Sans notes, les profs se demandent : « Mais comment je vais les faire travailler ? » Si on prend le temps de réfléchir à cette logique, elle concentre tout le problème de l’école !
C’est aussi la crainte de ne pas être un bon prof ?
Arnaud Hoedt : Oui. Certains profs évaluent leur propre qualité à leur taux d’échecs. On rencontre souvent des profs chez qui tout le monde rate. On leur demande : « C’est quoi, le problème ? » « Je suis très exigeant ! » Eh bien, pas avec leurs résultats, en tout cas… C’est complètement absurde.
La question de l’évaluation rejoint le fameux débat sur les savoirs et les compétences. On en est où ?
A.H. Les référentiels sont supers, précisément parce qu’ils sont toujours pensés par compétences, contrairement à la France qui privilégie les savoirs verticaux et patrimoniaux… Avec les compétences, les savoirs sont considérés comme des ressources, avec comme objectif de développer des savoir-faire en connexion avec le réel.
J.P. Je reprends l’exemple du néerlandais : tu peux apprendre une liste de vocabulaire sur la boulangerie – c’est un savoir –, mais on l’évaluera quand tu iras acheter ton pain.
A.H. Cette logique des compétences est aujourd’hui constamment battue en brèche. Par la droite mais aussi par l’extrême gauche, qui voit parfois ça comme quelque chose d’utilitariste, un truc d’entreprise pour dresser l’animal pour qu’il soit rentable. Il y a du vrai dans cette critique. Mais il n’y a pas de honte à être productiviste à l’école, si on produit du savoir, des compétences et de l’intelligence, et pas des coques de GSM.

La droite, elle, y a vu un danger pour le savoir, la culture commune…
A.H. Oui. Elle considère Victor Hugo comme LE savoir, auquel il faudrait aspirer. Comme si simplement le lire était en soi émancipateur, alors que, ce qui est intéressant, c’est d’essayer de le comprendre, de voir en quoi sa pensée éclaire l’actualité. C’est un peu comme la théorie du ruissellement, en économie, qui considère que l’argent des plus riches ruissellerait forcément sur les plus pauvres, sans qu’on intervienne. Comme si Victor Hugo allait ruisseler sur les pauvres et les émanciper…
J.P. Cela devient un but en soi : connaître des choses.
A.H. Les compétences, c’est justement l’idée d’utiliser l’ensemble des matières et connaissances de l’école dans des tâches concrètes.
Selon vous, l’écriture prend trop de place ?
A.H. C’est un autre problème de l’école : l’omniprésence de la langue écrite par rapport à la langue orale. En primaire et secondaire, les profs font trop peu d’oral, alors que c’est au programme.
J.P. Sur une semaine, le temps pendant lequel un élève est écouté, par les autres, par un prof, c’est trois minutes.
A.H. Et quand on fait cours en rhéto, on le sent. Quand on fait des exercices oraux, 20 à 30 % des élèves sont totalement muets – on arrive à peine à leur faire dire leur prénom à voix haute devant une classe. En conseil de classe, dans 90 % des cas, on va dire : « Il/elle est timide, hein ? » Comme si la timidité était une fatalité. Comme si on ne pouvait pas apprendre à ne plus être timide, à l’école. C’est l’un des enjeux majeurs de l’école : apprendre à parler.
J.P. On dit toujours : il ne faut pas que tu fasses de fautes d’orthographe parce que le jour où tu enverras un CV ou une lettre de motivation, ça n’ira pas. Mais on évoque rarement l’entretien d’embauche quand quelqu’un a du mal à prendre la parole. Il faudrait apprendre aux élèves à exprimer des idées, plutôt que de se focaliser sur le fait de ne pas faire de fautes.
Le clivage droite/gauche, dont vous parliez, se manifeste-t-il ailleurs dans l’école ?
A.H. Il y a en tout cas aussi la différence entre la pédagogie déductive et inductive. La pédagogie déductive, c’est dire : « Je connais un truc que je vais t’enseigner ; je suis le maître et tu vas apprendre de moi. » Tout ce qu’on fait en classe est déduit d’un savoir auquel on doit aspirer. À l’inverse, la pédagogie inductive part de l’élève, de ses besoins, de comment ça marche, et se demande : « Est-ce qu’on peut développer des compétences en toi ? »
J.P. Avec le prof comme personne-ressource.
Il y a aussi cette opposition entre apprentissage individualisant et apprentissage par le groupe ?
A.H. Oui. En schématisant, on pourrait dire que les déductifs sont individualisants. On aligne les bancs, chacun a sa place, on fait la dictée. C’est l’enseignement traditionnel. Mais au Secrétariat général de l’enseignement catholique (SEGEC) (pour lequel il a participé à l’élaboration des programmes de français, NDLR), on essaie de pousser la dimension collective des apprentissages.
Vous avez pu tester différents types d’approches, en pratique ?
A.H. Oui. Moi j’ai par exemple beaucoup travaillé avec la pédagogie inversée, qui s’inscrit dans cette tendance nouvelle. L’élève apprend les leçons à la maison et fait les devoirs en classe. La leçon vise à fournir des outils à l’élève. Et puis il est important que l’élève choisisse les supports pour qu’il réalise une tâche qui a du sens pour lui. On peut développer des compétences d’expression, même en parlant du Basic-Fit ou de la plongée sous-marine…
J.P. Mais tous les élèves ne vont pas se retrouver dans cette approche pédagogique. De nombreuses études montrent à quel point on est tous différents dans notre façon d’apprendre. Je me suis intéressé à la gestion mentale développée par un pédagogue français, Antoine de La Garanderie. Il a observé les façons d’apprendre et en a déduit différents « gestes » mentaux essentiels – faire attention, mémoriser, comprendre, réfléchir et imaginer – qu’on peut tous apprendre. À condition d’aider l’élève à identifier ceux qu’il maîtrise moins.
A.H. Avec l’idée que les cerveaux sont différents, on peut appréhender des méthodes différentes pour enseigner. Le même tarif pour tout le monde, ça n’a rien d’équitable.
De toutes ces avancées pédagogiques, il n’y a rien qui percole dans nos programmes scolaires ?
A.H. Si ! Tous les programmes actuels insistent sur le fait qu’il faut distinguer les méthodes par élève. Mais ce sont les profs qui rechignent !
Les parents sont parfois plus réfractaires que les profs…
A.H. En effet. À beaucoup d’endroits, les parents critiquent les profs qui ne font pas « comme on faisait avant ». Dans des classes où les enfants jouent, ont peu de devoirs, les parents disent : « On veut du taf comme on a eu, nous ! »
J.P. Prenons la grammaire. Nous, on l’a appris d’une certaine manière.
A.H. Appri-se !
J.P. Ha ha. On a l’impression que ça a bien fonctionné pour nous, qu’on n’est pas bêtes, qu’on est éduqués. Quand on vient avec la nouvelle manière d’analyser (le sujet, le prédicat), qui est plus cohérente et efficace que celle avec les compléments d’objet direct, le parent se sent dépossédé. D’abord, il ne sait pas le faire, vu qu’il ne l’a pas appris. Et il se dit : ça a marché pour moi, pourquoi ça ne marcherait plus ?
En fait, prof, c’est devenu une mission impossible, non ?
A.H. Clairement. Surtout que l’obsolescence des profs aujourd’hui, c’est sur cinq ans. Comme dans tous les métiers, cela dit. Le problème est que le prof accepte difficilement que ses matières puissent évoluer et changer.
J.P. Ce n’est même pas la matière mais le rapport à la matière qui change. Ce qui est neuf, c’est la façon dont les gamins regardent la connaissance et explosent les champs de connaissances.
Avec internet, le savoir est aussi à portée de main. Ça change forcément le rôle du prof…
A.H. Au Moyen Âge, les moines apprenaient par cœur des passages de la Bible, parce qu’il n’y avait pas l’imprimerie. Vers le XVIIIe et XIXe siècle, le livre imprimé est devenu le support ; mais aujourd’hui, il est derrière nous. L’info, tout le monde l’a, partout. Traiter de l’info est devenu plus compliqué que de la connaître.
J.P. Tous les gamins regardent E-penser (vidéos de vulgarisation scientifique disponibles sur YouTube, NDLR). Si le prof fait son cours comme un simple discours, il se met en compétition avec E-penser… et il perd à tous les coups ! Il doit profiter de son avantage d’être présent.
A.H. Le prof, il doit faire de l’aïkido et faire regarder E-penser à ses élèves. Et après, discuter avec eux et être beaucoup plus dans une relation de codécouverte que d’explication du monde. Le prof gagne en autorité quand il se met au côté de ses élèves pour apprendre avec eux, en leur demandant : « C’est quoi, les derniers trucs ? » En plus, je peux affirmer qu’en quinze ans d’enseignement, mes élèves sont devenus de plus en plus curieux.
J.P. Absolument. Mais les élèves ne s’intéressent pas toujours à ce qui intéresse les profs. Ou à ce qu’ils trouvent qui doit être intéressant. Il faudrait pouvoir se laisser redéfinir par les élèves.
A.H. On n’a jamais eu chez eux une aussi grande disponibilité émotionnelle, une volonté de savoir, une curiosité. Les complotistes, ce sont des gamins qui ont envie de savoir, même si ce sont des gamins qui s’égarent. Des curieux radicaux.
Mais c’est difficile pour le prof de se réinventer constamment…
J.P. Oui, d’autant que le système encourage des profils plan-plan. Et qu’aujourd’hui, garder les bons profs, c’est un problème. Prenons le projet Teach for Belgium. C’est la main du privé, McKinsey (société de consultance, NDLR), dans l’enseignement. Ils encadrent des profs pendant deux ans, avec leurs propres formateurs, puis les envoient dans les écoles pour inspirer les autres profs, avec de nouvelles méthodes. On en avait dans notre école – on les appelait « les tiches ».
A.H. Ha ha, j’avais oublié.
J.P. On a eu des profs hyper-bons, ultra-motivés, ultra-compétents.
A.H. Ils font des cours de dingues.
J.P. Mais ils restent deux ans. Quand ils voient ce qu’on leur permet de faire et ce qu’on ne leur permet pas, ils réalisent qu’ils ont sont déjà au top, qu’ils ont fait le tour des possibilités de développement après deux ans. Ils sont ambitieux. Et l’ambition éloigne les profs de l’enseignement.
A.H. L’initiative n’est pas encouragée chez les profs par les directions. La créativité est tuée par l’administratif, alors que des profs qui ont de l’initiative, il y en a plein !
Qu’est-ce qu’on peut faire alors ?
A.H. Dans un monde ultra-changeant, ultra-divers, ultra-complexe, plus on donnera d’autonomie aux écoles et aux profs, plus on leur permettra de s’adapter aux différents élèves.
J.P. Sachant que l’autonomie est aussi, potentiellement, une source d’inégalités.
S’il faut s’adapter à chaque élève, doit-on aller jusqu’à leur proposer des pédagogies différentes selon leurs profils ?
A.H. Oui il faut différencier les enseignements ! Que ce soit dans les écoles mais aussi entre les écoles.
J.P. Dans le système actuel, il y a déjà de la variété. Il y a des écoles élitistes, générales, techniques, professionnelles, artistiques, industrielles. Mais les critères sur lesquels on oriente sont catastrophiques : pour faire un métier manuel, il faut avoir raté. C’est un constat de fou pour une société.
A.H. C’est aussi parce que les profs enseignent peu et sélectionnent beaucoup. On en revient encore à l’évaluation ! Ils sélectionnent ceux qui leur ressemblent le plus. Tous les beaux idéaux qui nous animent, de développement, d’émancipation, de donner le goût des choses, c’est bien beau, mais en fait les profs de façon inconsciente sont souvent en train de sélectionner.
L’ascenseur social est-il cassé ?
J.P. L’école est en fait une turbine qui va prendre ton enfant et va le mettre à « sa juste place » dans la société.
A.H. Ce n’est pas un avis ou une vision qu’on a de l’école, ce sont des faits sociologiques. Quand tu dis dans une salle des profs que l’ascenseur social est cassé, tout le monde te regarde de travers. Ça fait 40 ans qu’on parle de ça pourtant, mais ça n’a pas encore percolé.
J.P. Non seulement l’école produit et reproduit cette inégalité, mais elle la légitime aux yeux de ceux qui la vivent.
C’est-à-dire ?
A.H. En gros, c’est l’idée que si je suis en professionnel, c’est que c’est de ma faute, je l’ai mérité. Hier à la sortie de notre spectacle (La Convivialité, NDLR), je discute avec le gardien de sécurité, qui n’est pas venu voir le spectacle. Il me dit : « Tu sais le théâtre, le français, c’est pas pour moi, j’étais nul à l’école. » C’est dommage !
J.P. Plus l’école dira que c’est grâce à elle qu’on s’en sort, plus ceux qui ne s’en sortent pas penseront que c’est de leur faute.
Si on pousse le bouchon, on peut se dire aussi qu’elle crée une hiérarchie sociale entre les profs…
A.H. Clairement. Une fille ou un garçon de « bonne famille », qui réussit bien ses études en humanités dans une bonne école et qui dit à ses parents : je vais faire instit, tout le monde le ou la décourage. C’est moins valorisé socialement alors qu’être pédagogue en première primaire, apprendre à lire, écrire, c’est largement aussi compliqué, voire plus, que d’enseigner la littérature à des rhétos.
J.P. Il faut absolument inverser cela.
À vous entendre, il reste quelques chantiers pour l’école…
A.H. La question, c’est de savoir si on veut vraiment que l’école adapte l’individu à la société… Aujourd’hui, tout est foireux : c’est la catastrophe sociale, écologique, économique. C’est d’ailleurs les gosses qui sont descendus dans les rues pour réclamer une autre société, plus respectueuse de l’environnement. Si on n’adapte pas les enfants à cette société qui va mal, ce n’est peut-être pas si grave. On pourrait plutôt leur demander d’en faire une autre ? C’est un peu utopiste et joli, ça fait un peu « cœur avec les doigts ». Mais, à un moment, l’esprit de compétition, le fait de trouver un emploi pour te situer dans l’échelle sociale, de travailler individuellement les uns contre les autres, ça te prépare peut-être à l’avenir, mais ça ne fait pas que l’avenir sera radieux.