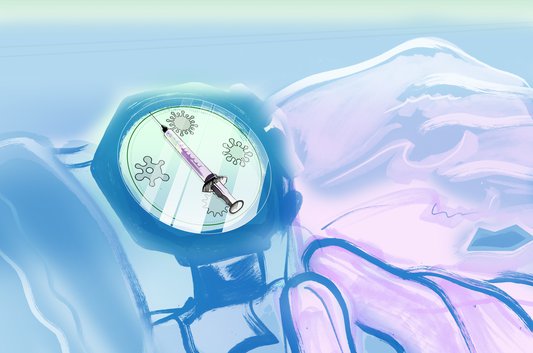- ép. 2
Des hamsters et des hommes
Sur la piste du vaccin belge - Épisode 2/3
Après avoir effectué des tests sur des hamsters, les chercheurs du Neyts-Lab (Louvain) se rendent compte que leur vaccin est efficace. Si son laboratoire ne joue pas à armes égales avec Pfizer ou Moderna, Johan Neyts et son équipe ont un atout que d’autres n’ont pas.
Trois mois. C’est le temps qu’il aura fallu à l’équipe du Neyts-Lab de l’Institut Rega (KU Leuven), pour créer huit prototypes de vaccins-candidats contre le coronavirus, en modifiant le vaccin contre la fièvre jaune (voir l’épisode 1). En avril 2020, les chercheurs passent à la première phase de tests sur des animaux. Ils ont d’abord pensé aux souris, mais elles ne sont pas facilement infectables. Ils explorent alors la piste des hamsters et deviennent une des premières équipes au monde à découvrir qu’un modèle d’infection basé sur ces rongeurs permettra d’avancer sur le vaccin.
Au fur et à mesure des tests, un des prototypes de vaccin semble bien fonctionner. Les hamsters sont vaccinés au jour 0 avec soit une faible dose de vaccin, soit une injection de vaccin contre la fièvre jaune classique soit une injection simulée. Ensuite, ils sont boostés au jour 7 (comprenez : on leur fait une 2e injection pour renforcer encore leur immunité). Au 21e jour, les hamsters montent des taux d’anticorps contre le coronavirus assez élevés.
2 à 7 jours plus tard, ils sont infectés au coronavirus, par le nez, avec une attaque virale assez importante.
Résultats sans appel
Pour les hamsters faussement vaccinés ou vaccinés avec le vaccin contre la fièvre jaune, les charges virales de coronavirus dans les poumons sont hautes. Les symptômes ressemblent à ceux des humains qui affichent une bronchopneumonie sévère après avoir contracté la Covid-19 : bronchiolite, œdème, infiltration leucocytaire (soit une forme d’attaque par des cellules inflammatoire). Les hamsters vaccinés, eux, résistent très bien à l’infection au coronavirus. Les traces du virus dans les poumons sont nulles ou quasi-inexistantes. La dissémination virale à travers l’organisme est aussi très faible. Au bout de quatre jours, seules de très faibles traces du virus sont détectables dans la rate, les poumons, les reins et le cœur.
Des tests supplémentaires seront effectués sur des souris, quand même, et des macaques. Ceux-ci seront vaccinés et infectés dans un laboratoire spécialisé au Pays-Bas. Dans le développement d’un vaccin, le passage par des tests sur des animaux demeure une étape obligatoire.
1er décembre 2020. Les chercheurs du Neyts-Lab publient dans la revue Nature leurs résultats sur le vaccin-candidat. Ils y expliquent, aussi, que les tests sur les animaux sont à chaque fois approuvés par les autorités en charge de ces enjeux et que des mesures sont prises pour déterminer le nombre d’animaux strictement nécessaires pour les tests.
Neyts et son équipe savent qu’ils ont bonne chance de faire d’une pierre deux coups. Ils ont sous la main un vaccin-candidat qui, s’il passe les tests chez l’homme, pourra protéger contre le Sars-CoV-2 mais aussi contre le virus de la fièvre jaune. Avec 200 000 personnes touchées par année, dont 30 000 décès, en immense majorité sur le continent africain (90 %), c’est un « un bonus non négligeable pour les zones endémiques de fièvre jaune comme l’Afrique ou l’Amérique du sud, estime Johan Neyts. Le vaccin se fait en une dose et se conserve à des températures positives. » Contrairement aux vaccins à ARN messager, qui doivent être stocké à des températures polaires (de – 20 pour le Moderna à -70° pour le Pfizer).
Une route tortueuse
Le laboratoire a carburé, les débuts sont prometteurs, mais la route est encore longue. « Le cycle de développement d’un vaccin, nous le connaissons évidemment très bien. Après les tests chez les animaux, nous devons démarrer les tests chez les humains. Cela se déroule en trois phases, rappelle Neyts. D’abord il y a une ou deux personnes, volontaires, qui reçoivent une injection. On les contrôle de près. Le jour d’après, on injecte à deux autres personnes. On tente d’arriver jusqu’à 30 ou 40 personnes. On espère alors avoir l’indication que le vaccin est sûr. C’est la phase 1. » C’est cette phase qui permet de donner un début de légitimité au vaccin, et de traquer les effets secondaires immédiats. Les anticorps produits par les volontaires sont mesurés.
La phase 2 peut impliquer de cent à plusieurs centaines de personnes. « On explore s’il y a un effet thérapeutique et protecteur sur le long terme », résume Neyts. Les chercheurs évaluent l’évolution des taux d’anticorps ou de lymphocytes dans le sang, ce qui permet de mieux déterminer le nombre de doses et les effets secondaires à moyen terme.
Enfin, la phase 3 est la plus compliquée et coûteuse à mettre en place. Elle implique plusieurs dizaines de milliers de personnes. C’est elle qui permet de savoir dans quelle mesure le vaccin protège de la maladie à large échelle, de déterminer les effets secondaires rares et dans quels groupes de population et classes d’âge, le vaccin est efficace ou non.
Investisseurs essentiels
De la phase 1 à la phase 3, tout coûte extrêmement cher. « Pour la phase 3, l’ampleur des coûts est évidente, explique Johan Neyts. Il ne suffit pas seulement de payer les doses mais aussi le coût de l’organisation des tests sur des dizaines de milliers de personnes (44000 pour le Johnson&Johnson par exemple), dans différents hôpitaux à travers le monde, en payant le personnel hospitalier, les analyses de laboratoire. Une phase 2 est également trop chère pour un laboratoire académique. »
Mais même une « simple » phase 1 coûte des millions d’euros. « Il faut un processus de production qui respecte les principes GMP et qui effectue toutes les analyses toxicologiques pré-cliniques (avant les essais donc, ndlr) requis par l’Agence européenne des médicaments. Un essai en phase 1 ne peut pas être fait avec des doses conçues par un laboratoire mais bien par un CDMO (soit un Contract Development and Manufacturing Organization, c’est-à-dire un façonnier ou sous-traitant spécialisé dans la fabrication de médicaments). Il devra créer une méthode de production stable, où chaque tour de production de vaccins garantit le même nombre de doses par volume, avant de permettre les études prétoxicologiques et donc d’entrer en phase 1. Rien que ce travail-là coûte plusieurs millions pour lesquels il faut des investisseurs. »
Sans partenariat avec une société pharmaceutique ou des investisseurs aux bourses bien remplies, il n’est pas possible pour un laboratoire académique de mener des essais cliniques.
Un petit club
En décembre 2020, malgré la publication dans Nature, l’équipe du Neyts-Lab sait depuis plusieurs mois qu’elle ne sera pas la première à mettre un vaccin sur le marché. Pfizer, Moderna (ARN messager tous les deux) et AstraZeneca (vaccin à vecteur viral) ont été plus vite que tout le monde. Le 21 décembre 2020, la Commission européenne délivre son autorisation de mise sur le marché à Pfizer. Moderna suivra le 6 janvier 2021, et Astra-Zeneca le 29 janvier.
Au Neyts-Lab, la phase 1 n’a pas encore démarré. À l’été, des investisseurs et des sociétés s’étaient annoncés pour produire le vaccin (les noms resteront confidentiels), mais l’avancement ultra-rapide des grosses sociétés pharmaceutiques les a refroidis.
« Évidemment, tout le monde est content que des solutions aient été développées pour le coronavirus, reconnaît Neyts. Il n’y a d’ailleurs pas que les vaccins, des avancées ont été faites dans la recherche de médicaments antiviraux, ou, comme à l’université de Gand, le développement d’anticorps administrés par injections, qui sont capables de neutraliser le virus. Mais cela peut être effectivement frustrant car après l’arrivée du Pfizer, il est devenu plus difficile de trouver du capital. Mon laboratoire est un tout petit club comparé à des entreprises qui se sont jetées dans la bataille contre le coronavirus en investissant à risque. Certains gros joueurs comme GSK ou Sanofi n’ont pas réussi à faire aboutir leur projet de vaccin, et n’ont donc pas voulu prendre un deuxième risque. »
Depuis le mois de janvier 2020, Neyts et l’Institut Rega ont dû rassembler de l’argent pour leurs recherches. Ils disposaient, alors, d’une bourse de la Commission européenne pour utiliser le vaccin contre la fièvre jaune et le transformer, grâce à la biologie moléculaire, en vaccin contre la rage. Quand le coronavirus est arrivé, la Commission a autorisé l’argent à être alloué à la recherche d’un vaccin, les deux approches étant liées.
« Durant les premiers mois, nous avons aussi bénéficié d’un Fonds Covid de la KU Leuven, financé par des sociétés, des citoyens, aisés ou moins aisés, qui nous a permis de survivre. Il faut avoir de l’argent à disposition directement dans ce genre de cas. Or, les candidatures pour des bourses de recherche prennent des mois. » Les finances seront complétées par la société d’assurances Ageas, la Bill and Melinda Gates Foundation et une donation privée, notamment. L’Institut Rega fait aussi des recherches et des tests sur des anticorps et des médicaments pour d’autres sociétés et institutions, comme l’Université de Gand ou la Croix-Rouge, qui génèrent des bénéfices immédiatement libérables pour de la recherche.
Les moyens sont limités mais ce n’est pas parce que quelques vaccins de première génération arrivent sur le marché que l’équipe cesse ses recherches. « Nous aurons peut-être besoin d’un vaccin de deuxième génération meilleur et plus robuste », relativisait Kai Dallmeier de l’Institut Rega en octobre 2020.
Il y a, après tout, « sept milliards de personnes à vacciner », ajoute Johan Neyts. Et le vaccin-candidat de son laboratoire dispose d’un avantage que les vaccins à ARN Messager n’ont pas. « Contrairement à ceux-ci qui doivent se garder à des températures très basses, le nôtre se conserve à température positive. Les pays du sud, où il est difficile de mettre en place une chaîne du froid et des rappels, notamment à cause des distances, ne doivent pas être oubliés et notre projet est évidemment utile. Il vaut de toute façon mieux avoir une diversité de vaccins efficaces . »
En octobre 2020, alors que les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca finalisent leurs tests et leurs demandes de mises sur le marché, un invité surprise débarque : le variant indien, ensuite renommé delta. Le troisième en quelques mois, après le britannique (alpha), le sud-africain (bêta) et le brésilien (gamma). Sauf qu’il est encore plus agressif et contagieux.
Une nouvelle course, pour adapter les vaccins cette fois, va pouvoir démarrer.
Suite du récit de ce marathon ce vendredi 18 février.
Avec le soutien du Fonds pour le Journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les questions de Médor : tous les mois une nouvelle enquête, en 3 épisodes. Les publications se font les mardi, jeudi et vendredi de la 3ème semaine, à 11h. Gardez les yeux ouverts.
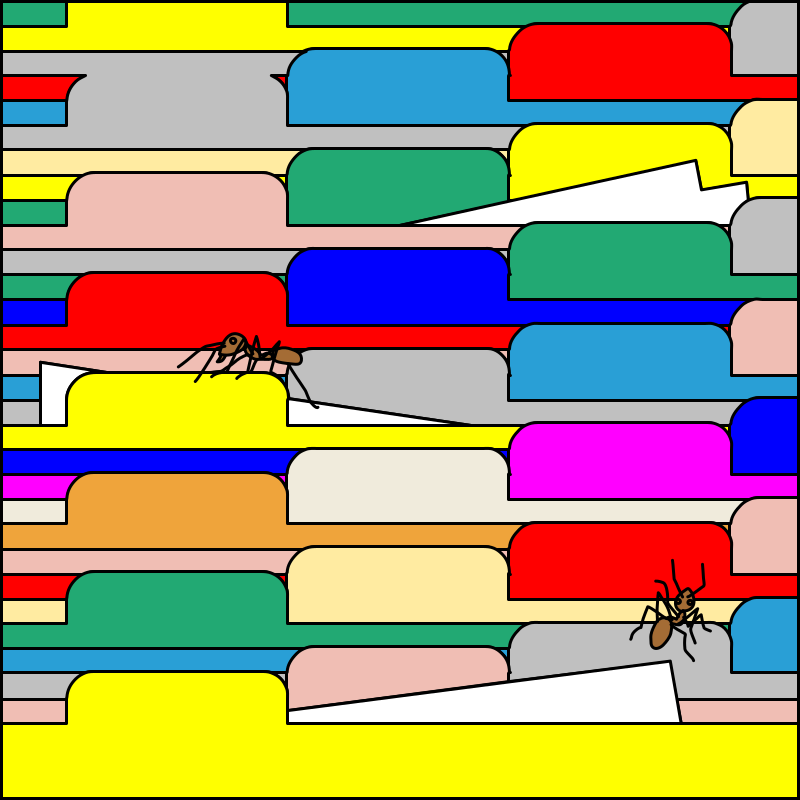
-
Good Manufacturing Practices ou bonnes pratiques de fabrication
↩