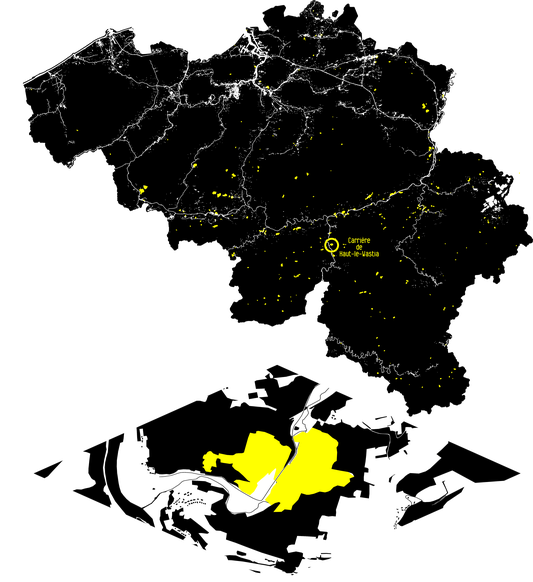Luc Barbé : la question centrale
Enquête (CC BY-NC-ND) : Cédric Vallet & Grégoire Comhaire
Publié le
Il n’est pas venu les mains vides. En arrivant à l’interview, Luc Barbé a amené un vieux livre illustré, issu d’un dessin animé de Walt Disney sorti en 1957. Avec ses avions nucléaires, ses bateaux et ses injections médicales, « Notre Ami l’atome » est révélateur d’une époque, pas si lointaine, où le nucléaire était vu comme un vecteur de progrès et de paix. Luc Barbé, lui, n’a jamais regardé l’atome comme un ami.
Après une formation d’ingénieur, il se lance en politique sous la bannière des verts flamands d’Agalev. Il devient ensuite chef de cabinet du secrétaire d’État à l’Énergie Olivier Deleuze en 1999. C’est lui qui, dans l’ombre, sera la cheville ouvrière de la loi de sortie du nucléaire votée quatre ans plus tard. Déjà auteur de « La Belgique et la bombe », un livre consacré au rôle joué par la Belgique dans le développement de l’arme atomique, Luc Barbé prépare actuellement un ouvrage consacré à la N-VA. Toujours attentif aux questions énergétiques, il porte un regard acerbe sur les quinze années d’inertie politique qui ont mené au chaos actuel.
Médor. En 1999, Écolo se retrouve au gouvernement fédéral, invité surprise d’une coalition rouge-bleue sans les sociaux-chrétiens. Comment les écologistes sont-ils parvenus à imposer la sortie du nucléaire dans l’accord de majorité ?
Luc Barbé. Il faut se remettre dans le contexte de l’époque. Avant les élections, socialistes et libéraux avaient décidé de mettre leurs divergences de côté pour construire un nouveau projet politique ensemble, en mettant le CVP dans l’opposition après 50 ans de pouvoir. Il fallait faire des avancées en matière d’éthique (mariage homosexuel, euthanasie…). Or c’était impossible à faire avec les sociaux-chrétiens ! Écolo et Agalev ont été associés à ce projet. La sortie du nucléaire a été actée dans l’accord de gouvernement, au terme d’une négociation et d’un compromis. Pour nous, c’était la cerise sur le gâteau d’une bataille de quarante ans !
La négociation a été difficile ?
L.B Les socialistes soutenaient la proposition mais, au départ, les libéraux n’en voulaient pas. Il faut dire qu’à l’époque, l’énergie et le climat étaient encore vus comme des dossiers secondaires. La preuve, la matière a été confiée à un « secrétaire d’État à l’Énergie », même pas à un ministre !
Votre premier grand chantier, c’est la libéralisation du marché de l’énergie…
L.B Oui. Jusqu’en 1999, on était dans une situation de monopole de fait d’Electrabel, qui décidait de tout en matière d’énergie. Or, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Electrabel a toujours été une entreprise privée. Il y avait bien un comité de contrôle pour l’électricité et le gaz et une concertation avec les partenaires sociaux pour les investissements et les prix, mais, dans les faits, le pouvoir était chez Electrabel et pas dans la sphère politique. Il n’y avait pas de politique énergétique dans le sens où on le connaît aujourd’hui. C’était totalement déséquilibré.
Vous l’avez vue comme une opportunité pour préparer l’après-nucléaire ?
L.B. Bien sûr ! Pour nous, c’était le cadre qu’il fallait pour casser le monopole d’Electrabel et ouvrir les investissements dans les énergies renouvelables. La directive européenne nous obligeait à ouvrir le marché, mais nous avions en réalité une grande marge de manœuvre pour la mettre en place. Il était possible d’adopter un modèle « soft » ou « hard ». Dans chaque arrêté royal, on peut définir si on consolide la position d’Electrabel ou pas. Les dirigeants d’Electrabel ont espéré qu’on ne laisse entrer que quelques petits concurrents, sans vraiment rien changer à leur position. Cela ne s’est pas passé comme ça. Chez Electrabel, ils étaient furieux ! Ils venaient dans mon bureau pour expliquer que, dans d’autres pays, la libéralisation se faisait de manière à protéger les grands opérateurs historiques !
Vous avez donc opté pour la version « hard » ?
L.B. Avant 99, en Belgique, on ne concevait pas la politique énergétique avec des lois mais avec des conventions entre l’État et Electrabel. C’était comme un contrat entre deux acteurs privés, cela affaiblissait le pouvoir de l’État et donnait une forte assise à Electrabel dans les grands choix énergétiques. Lorsque Olivier Deleuze est devenu ministre, il a souhaité en finir avec cette pratique. « Mon outil, c’est la loi », a-t-il dit. Une des options prévues dans cette directive était de créer des « régulateurs » du marché. Nous avons donc créé la Creg (Commission de régulation de l’électricité et du gaz), qui doit vérifier le bon fonctionnement du marché. Olivier Deleuze souhaitait un régulateur fort et indépendant. C’était la panique totale du côté d’Electrabel. Toutes les bonnes relations qu’ils avaient développées sur des dizaines d’années avec le PSC et le CVP ne leur servaient plus à rien. Ils ont dû reconstruire des alliances. Alors certes, ils pouvaient encore s’appuyer sur le MR. Nous recevions des amendements du MR calqués sur les propositions d’Electrabel.
Selon vous, Electrabel était un obstacle au changement ?
L.B. C’était plus ambigu que cela. Nous ne croyions pas que cet acteur pouvait, à cette époque, aider à la transition énergétique dont la Belgique avait besoin. Donc il fallait casser son monopole et fermer les centrales nucléaires. Enfin, le but était de faire émerger de nouveaux acteurs capables d’accompagner la transition vers un modèle centré sur les énergies renouvelables.
Vous aviez imaginé qu’entre 2003 et 2015, la libéralisation du marché allait amener de nouveaux acteurs dans le secteur de l’énergie renouvelable, permettant ainsi de compenser la future perte de capacités de production liée à la fermeture des centrales. N’avez-vous pas trop cru en la force du marché ?
L.B. Le raisonnement était que les opérateurs, sur le marché, se disent : « Il y a en Belgique un appel implicite à investissements car il y a des besoins en électricité. » Le signal était clair dès décembre 2002. Mais qu’a fait le monde politique ? Exactement l’inverse. Après notre départ du gouvernement, des gens ont commencé à dire tout haut le mal qu’ils pensaient de la loi de sortie du nucléaire. Surtout à partir de 2007. C’est ce qui a fragilisé la confiance des investisseurs, qui attendaient des signaux clairs. Ils n’aiment pas l’incertitude.
On insiste : n’avez-vous pas été un peu optimiste quant à cette capacité du marché à investir dans les renouvelables ?
L.B. Le schéma européen interdit de planifier la politique énergétique. L’idée européenne, c’est l’ouverture du marché. Mais cela ne veut pas dire que les pouvoirs publics ne peuvent rien faire ! Un État peut lancer des appels à projets, soutenir des investissements grâce à des subventions. Cela n’a pas été fait et c’est une grande faute politique.
Pourquoi les gouvernements successifs ne se sont-ils pas lancés dans l’accompagnement d’alternatives au nucléaire, dans le développement de nouvelles capacités de production électrique ?
L.B. Je pense qu’il s’agissait d’un choix politique de ne pas mettre en œuvre la loi de sortie du nucléaire. Cela profitait à Electrabel, qui encaissait les recettes de son parc nucléaire après l’avoir amorti. Tant que la Belgique n’investit pas dans des capacités alternatives, c’est tout bénéfice pour Electrabel, car la durée de vie des centrales sera peut-être prolongée. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé avec Tihange 1, Doel 1 et 2, dont l’exploitation a été prolongée de 10 ans. La stratégie fonctionne.
Pourtant, aujourd’hui, les centrales nucléaires belges ne sont pas franchement rentables. Elles ont l’air d’être un handicap pour Engie (ex-GDF Suez, la maison mère d’Electrabel, NDLR). À tel point qu’en France, Engie aurait parlé de « nid à emmerdes » au sujet des centrales belges…
L.B. Chez Electrabel, ils n’avaient pas prévu les milliers de microfissures dans les cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2. Ni le sabotage de Doel 4 en 2014. Si l’on ajoute les problèmes de béton, les pannes, les plans qu’on ne trouve plus… C’est à peine croyable dans le secteur nucléaire.
Il se dit qu’Engie cherche à se débarrasser d’Electrabel…
L.B. Deux manœuvres intéressantes illustrent bien la problématique. Il y a eu le plan Bianca, en 2016, dont l’objectif était d’ouvrir le capital d’Electrabel. Le but était de faire entrer les communes et l’État. Non pas pour profiter de bénéfices… mais bien pour partager les pertes d’Electrabel. Ça n’a pas fonctionné. La deuxième tentative est plus récente avec cette idée de vendre Electrabel à EDF. Ça ne se fera pas facilement. Nous l’avions dit il y a longtemps, aujourd’hui tout le monde s’en rend compte : ces réacteurs nucléaires ont été conçus pour fonctionner 30 ans. Pas davantage. Sinon ils ne sont pas fiables.
Y a-t-il eu un travail de lobbying depuis 2003 pour remettre en cause la loi de sortie du nucléaire ?
L.B. Oui, notamment via les grandes campagnes du Forum nucléaire. À la fin des années 2000, ils ont semé le doute, grâce à des séminaires, des campagnes d’affichage, des publicités. Ils ne cherchaient pas à « vendre » directement l’idée d’une énergie nucléaire vertueuse. C’était plus subtil. « OK, il y a le problème des déchets, mais, le nucléaire, c’est une sécurité d’approvisionnement. Et puis cela fait baisser les émissions de CO2. » Le message implicite c’est : « Est-ce qu’on peut se passer du nucléaire ? » Et les gens commencent à douter.
Parmi les difficultés pour engager une transition énergétique vers le renouvelable, on peut aussi noter un problème typiquement belge : les soucis de compétences…
L.B. Les entités fédérées sont responsables en matière de renouvelable, sauf en mer du Nord où il est possible de lancer des projets dans l’éolien. Cela complique énormément le dossier. Comment faire du planning au niveau fédéral sans compétences en matière d’énergies renouvelables ? Dès 2010, j’ai dit, avec d’autres, qu’il fallait un pacte énergétique entre le fédéral et les Régions, avec la FEB (Fédération des entreprises belges) et les syndicats.
Ce pacte énergétique a été annoncé au début de cette année…
L.B. Marie-Christine Marghem a mis quatre ans pour produire un texte qui n’est pas du tout un pacte. C’est juste une déclaration d’intentions sans éléments concrets de mise en œuvre. C’est scandaleux !
Notons peut-être deux points qui devraient vous satisfaire. Charles Michel a confirmé l’intention de son gouvernement de sortir du nucléaire en 2025. De plus, des investissements d’importance sont réalisés dans l’éolien offshore en mer du Nord.
L.B. Il faut distinguer les mots et les actes. Si l’intention est bien de sortir du nucléaire en 2025, alors, dès juillet 2018, il aurait fallu lancer des appels à projets, favoriser les investissements… Mais rien n’est fait, à part dans l’éolien offshore en effet, via des subventions, ce qui prouve que la libéralisation d’un secteur n’empêche pas l’État d’agir.
Vous évoquiez le fait qu’Electrabel avait un intérêt – financier – à prolonger la durée de vie de ses centrales. Mais dans le même temps, l’état du parc nucléaire semble déplorable, avec des problèmes à répétition – qui aboutissent encore aujourd’hui à des menaces de black-out. Comment expliquer cette contradiction ?
L.B. La pression de Paris pour faire des économies en matière de personnel, d’investissements, est très forte. C’est ce qui remonte du secteur. Après 10 ans de manque d’investissements, ça commence à se voir.
Vu l’état des centrales… est-on en danger ?
L.B. Il faut fermer d’urgence les deux réacteurs avec leurs milliers de microfissures. Il n’y a pas de doute. On parle du cœur du réacteur. De la cuve. Une cuve qui se dégrade, ça veut dire qu’en cas de problème, le combustible nucléaire – hautement radioactif – peut se libérer. Donc cela serait Fukushima au carré. Une véritable catastrophe !
Pensez-vous que les différents partis qui ont soutenu la filière nucléaire sont en train d’infléchir leur position, y compris au MR et à la N-VA, vu les difficultés que traverse la filière ?
L.B. Le MR et la N-VA ont d’excellents contacts avec le patronat. Ils ont des liens avec les patrons d’entreprises qui consomment beaucoup d’électricité, le port d’Anvers, Solvay, BASF… des entreprises défendues par la FEB. Cette dernière considère que le nucléaire est une garantie en matière d’approvisionnement et réclame des tarifs préférentiels pour ces gros acteurs économiques. Ils n’arrivent pas à percevoir la transition vers un modèle centré sur les énergies renouvelables comme une opportunité économique. Le choix d’Angela Merkel d’en finir avec le nucléaire et d’encourager le renouvelable, tout en défendant les intérêts économiques de son pays avec force, ne leur parle pas.
Le patronat belge serait réfractaire au changement ?
L.B. C’est une organisation qui est très corporatiste. La FEB ne parle pas au nom des entreprises belges. Elle parle trop au nom de certaines entreprises. Dans le CA, on trouve un représentant du secteur de la métallurgie, un autre de l’énergie, de la chimie. Ils défendent l’intérêt du secteur, pas de l’ensemble de l’économie belge. Un des grands nœuds dans ce problème, c’est que leurs éventuelles dissensions internes n’émergent pas publiquement. Mais attention, la situation évolue ces derniers mois. S’il y a bien une chose importante pour les grandes boîtes à Anvers, c’est la garantie, à 200 %, de la sécurité d’approvisionnement en électricité. S’il y a un black-out, ça va aller vite, la coalition en payera le prix.
Electrabel est censé verser beaucoup d’argent – des provisions – pour le futur démantèlement des centrales et le traitement des déchets. C’est une conséquence de votre deuxième loi, celle du 11 avril 2003, qui instaura une commission des provisions nucléaires en charge de surveiller l’affectation de ces fonds. Le dossier est aujourd’hui très brûlant… On sent peu d’enthousiasme chez Engie et Electrabel à l’idée de payer ces milliards…
L.B. C’est une question très importante. On parle pour l’instant de 10 milliards d’euros (huit milliards avaient déjà été versés en décembre 2015, NDLR) ! En 99, dans l’accord de majorité, la sortie du nucléaire était actée. Mais il n’y avait rien sur les provisions nucléaires. Il fallait pourtant une loi pour garantir que de l’argent soit versé pour démanteler les réacteurs et gérer les déchets. Il y a eu cette deuxième loi sur les provisions nucléaires. Nous poursuivions deux buts. D’abord qu’il y ait assez de provisions pour couvrir les coûts. Ensuite que cet argent soit réellement disponible. À l’époque nous avions trouvé un système, pas forcément optimal, mais issu d’un compromis. L’argent versé par Electrabel reste dans une filiale de l’entreprise, Synatom. Un contrôle est exercé par la Commission des provisions nucléaires. Synatom peut prêter 75 % de ces provisions à Electrabel qui peut l’utiliser mais sous conditions. La Commission des provisions va suivre le « rating » d’Electrabel, donc sa santé financière et économique. Si le rating se dégrade, l’argent doit revenir chez Synatom. Cela permet d’avoir des garanties. Les 25 autres pour cent ne peuvent être investis que dans des investissements sûrs.
Sauf qu’il existe une sorte de nervosité par rapport à ces provisions. Engie les payera-t-elle ou bien les consommateurs belges vont-ils se retrouver avec la facture ?
L.B. Le changement majeur a eu lieu en 2005. À cette date, Electrabel, entreprise belge, devient française. Et ça change tout. La situation est unique dans le monde. La Belgique a sept réacteurs nucléaires qu’elle compte démanteler dans les mains d’un autre pays. Il y a une loi et une surveillance, mais, compte tenu de la situation, il faudrait la modifier. Car aujourd’hui l’enjeu des provisions échappe beaucoup plus au gouvernement belge. La Belgique a l’autonomie et les compétences pour durcir la loi. Par exemple le ratio concernant la disponibilité (le 75 %-25 %, NDLR) de ces provisions pourrait être modifié. Mais les Français ne veulent pas en entendre parler.
En mai 2018, les quotidiens L’Écho et De Tijd annonçaient qu’Engie avait reçu 1,641 milliard d’euros d’Electrabel l’an dernier, réactivant la crainte qu’Engie organise la faillite d’Electrabel pour éviter d’avoir à payer ces provisions…
L.B. Je n’y crois pas. Si Engie commence à vider Electrabel, son rating va baisser. Et la Commission des provisions nucléaires va intervenir. Il y aura donc de l’argent qui reviendra vers Synatom. Le défi me semble être différent. Il semble plutôt qu’Engie souhaite plafonner les coûts du démantèlement et de gestion des déchets qui lui seraient imputés. Il ne faudrait surtout pas l’accepter, car les coûts, dans le secteur nucléaire, sont totalement imprévisibles.
L’autre gros dossier qui s’enlise est celui des déchets nucléaires. Est-ce que la piste de l’enfouissement, qui est privilégiée, est une bonne solution ?
L.B. Je ne suis pas du tout rassuré par ça. Il faut distinguer deux choses. D’abord les déchets nucléaires faiblement radioactifs. L’Organisme national des déchets radioactifs (ONDRAF) construit une « décharge » à Mol-Dessel pour les stocker pendant 300 ans. En théorie c’est une bonne solution, car je peux encore m’imaginer une durée de 300 ans. Mais pour les autres déchets, on parle d’un stockage de… 230 000 ans. La pyramide de Kheops, c’était il y a 4 500 ans. L’homme de Néandertal, c’était il y a 100 000 ans. Donc là on se situe dans du très très long terme. Comment transmettre sur de telles durées la connaissance relative à ces déchets et à leur traitement ? Autre question : comment signaler sur de si longues périodes la présence de déchets nucléaires enfouis ? On fait appel à des artistes. Certains évoquent un monument pour effrayer les gens, car la mémoire peut se perdre. D’autres pensent au contraire qu’il vaut mieux faire oublier ces déchets, car un avertissement quelconque finira par attiser les curiosités. Mais comment suscite-t-on l’oubli ? Depuis 50 ans on fait des études au sujet de l’enfouissement et les conclusions sont toujours les mêmes : il faut une étude en plus car les garanties en termes de sécurité ne sont pas suffisantes. Cette garantie ne peut pas vraiment exister. Comment anticiper les changements climatiques, mais surtout les changements géologiques sur une échelle de plus de 100 000 ans ? C’est impossible.
Ce dossier nucléaire n’est-il pas symptomatique de l’inertie belge qui se ressent un peu partout ?
L.B. Absolument ! Changer quelque chose en Belgique, c’est terriblement difficile ! Quand on regarde les grandes décisions du gouvernement ces vingt dernières années, on se rend compte qu’ils ont agi soit par obligation internationale, soit parce qu’il y a eu une crise. Après la dioxine, on a réorganisé les inspections. Après l’évasion de Dutroux, on a réformé la justice et la police…
Le black-out qu’on nous annonce, ça pourrait faire office de crise ?
L.B. Un black-out, c’est une grand-mère bloquée dans un ascenseur, ce sont des hôpitaux dont le groupe électrogène est peut-être défaillant… Il y aura des morts ! Personne ne veut en arriver là. En tous cas, si on a un black-out, ou même un délestage partiel, la ministre de l’Énergie saute et le MR ne fera même pas 20 % en 2019. Si on en arrive à ce cas extrême, c’est fini pour Charles Michel !
Quelles sont les forces politiques qui défendent encore le nucléaire aujourd’hui ?
L.B. Le SP.A est contre, l’Open VLD aussi. Ils ont compris l’opportunité économique qu’il y avait, car même les études de Greenpeace ont sous-estimé la vitesse à laquelle se développent les énergies renouvelables. Le PS est contre aussi, en théorie, même si c’est Paul Magnette qui a décidé de prolonger les trois plus vieux réacteurs qui devaient fermer en 2015. C’était un signal catastrophique pour les investisseurs. Le CD&V a été lié avec l’establishment énergétique pendant 50 ans, mais il y a une nouvelle génération qui n’a pas connu cette époque. Le MR, lui par contre, va toujours écouter les actionnaires. Ils prétendent défendre les PME, mais en réalité c’est le parti des grands patrons qui n’a aucune vision énergétique.
La N-VA, aujourd’hui, c’est le parti pronucléaire par excellence ?
L.B. Oui, et pour deux raisons. Le lien avec le Voka (Union des entreprises flamandes, NDLR) d’abord. Et puis leur volonté de se distinguer de la gauche. Et comme la gauche et les écologistes sont contre le nucléaire, la N-VA est pour. Toutefois, ils ne sont pas d’accord entre eux sur cette question. Leur grand point fort : c’est qu’ils n’étalent pas leurs dissensions sur la place publique. La N-VA est dans un dilemme. Ils veulent de l’électricité bon marché mais se rendent compte maintenant que, si on avait appliqué la loi Deleuze dès 2015, on n’aurait pas eu les problèmes d’aujourd’hui.