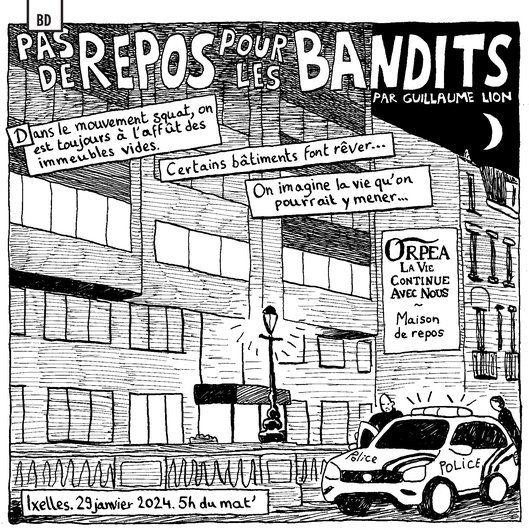Le poids des seins
Textes et photos (CC BY-NC-ND) : Philomène Raxhon & Laura Collard
Publié le

400 grammes. L’équivalent d’un pamplemousse. C’est le poids minimum qu’il faut retirer à chaque sein pour qu’une opération de réduction mammaire soit remboursée en Belgique. Un critère lourd, qui renvoie de nombreuses patientes dans la catégorie « chirurgie esthétique ».
Dans sa chambre d’enfant, en région liégeoise, Sarah, 25 ans, ausculte sa poitrine dans le miroir de la penderie, étire son téton pour révéler la cicatrice blanche qui l’entoure. À l’adolescence, ses seins sont apparus très vite, atteignant un bonnet C sans passer par la case A ou B. Dans les vestiaires de gym, elle observe ses camarades en petites brassières de sport, se compare. Sa maman, Béatrice, 56 ans, la regarde et se souvient de sa propre expérience : « À 12 ans, en 6e primaire, j’étais une des seules à avoir des seins qui poussaient et, en secondaire, j’étais toujours celle qui en avait le plus. » Mère et fille ont toutes deux eu recours à une opération de réduction mammaire, à 15 ans d’intervalle, pour diminuer ces seins qui prenaient toute la place.

En Belgique, entre 2012 et 2022, 3 680 réductions mammaires ont été prises en charge par l’Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI) par an en moyenne. Un chiffre bien loin derrière celui de l’augmentation mammaire. En 2023, plus de 14 000 augmentations mammaires ont été pratiquées en Belgique, selon le rapport annuel de l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (IPSAS). Les seins bombés sont encore et toujours le standard de beauté, que les influenceuses contribuent à normaliser sur les réseaux sociaux.
En comparaison, personne ne parle de la réduction mammaire. « Pour moi, on se faisait opérer pour mettre plus de seins, mais pas pour en enlever », explique Camille, 22 ans, qui projette de se faire réduire la poitrine dans l’année. Pourquoi voudrait-on avoir moins de ce que le monde a érigé en symbole ultime de féminité ? Celles qui décident d’y avoir recours commencent tout juste à sortir du bois.
Camille évoque les vidéos de la youtubeuse française Anna RVR, qui a dévoilé, depuis son lit, les détails de sa propre réduction mammaire. « Je pense que le fait d’en entendre parler à grande échelle a été le plus gros élément déclencheur. C’était une meuf un peu connue qui parlait de problèmes que tu connaissais, que tu comprenais. Ça l’a démocratisée (la réduction mammaire, NDLR). »
Selon un rapport de 2022 de l’INAMI, si l’âge moyen des patientes qui subissent une réduction mammaire est de 40 ans, le pic d’interventions est observé entre 20 et 24 ans. Des jeunes femmes, gênées par leur poitrine, cherchent, à travers les réseaux sociaux et internet, à voir ce processus intime représenté. Pour Clémentine, 23 ans, qui s’est fait réduire les seins en octobre 2023, ces vidéos ont aussi légitimé son besoin médical, lié à ses maux de dos.
À bout de torse
Une poitrine si développée peut entraîner d’importants problèmes de posture et des douleurs. « L’hypertrophie mammaire implique presque toujours un retentissement physique », à savoir des « douleurs du cou, des épaules et du dos », considère la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique dans une publication de 2022.
Avant son opération, Clémentine devait régulièrement s’allonger pour soulager un mal de dos intense qu’elle traînait depuis l’adolescence. Certaines femmes doivent ainsi constamment soutenir, à bout de torse, plusieurs kilos de glande et de graisse dans chaque sein.

Au-delà des douleurs, ces seins démesurés dérangent. Béatrice parle de l’été, « l’enfer » de s’habiller, « les crises dans les cabines d’essayage » avec sa mère, les maillots à « 100 boules ». Camille raconte la sueur qui s’accumule sous les seins à la période estivale. Elle a laissé tomber le yoga, parce que ses seins la gênaient. « Courir, ce n’est même pas envisageable », poursuit-elle. Beaucoup de femmes dotées d’une forte poitrine n’y songeraient même pas, tant, « dès qu’elles courent, ça fait boum-boum », image avec subtilité une chirurgienne plastique.
Et puis, il y a les regards. « En grandissant, dès qu’une jeune fille a une grosse poitrine, elle est tout de suite sexualisée », décrit Sarah. Alors qu’elles n’ont que 11, 12, 13 ans, ces fillettes tout juste pubères sont déjà confrontées à des regards, « parfois vicieux », ajoute Béatrice, qui a observé ce comportement envers elle, mais aussi envers sa fille. « Je marchais derrière elle et je voyais les gens qui regardaient quand elle passait… c’était encore pire parce qu’évidemment ça me rappelait des souvenirs », explique-t-elle.
À cela s’ajoutent la curiosité, voire les moqueries. À l’école, Béatrice se fait appeler « la vache », tandis que Sarah se construit avec l’image hypersexualisée de « celle avec les gros seins ». Alors qu’à 13 ans, Camille portait déjà un bon bonnet C, la jeune femme se souvient, à l’inverse, de la valorisation des grosses poitrines : « À l’époque, c’était un peu stylé d’avoir plus de seins que mes copines. » Dans les vestiaires, à la piscine, c’est à celle qui pourra faire tenir sa serviette sans les mains.
Réduction amère
Des bretelles de soutien-gorge qui creusent des sillons dans les épaules aux complexes causés par une poitrine disproportionnée, de nombreuses raisons peuvent conduire à une réduction mammaire. Cette décision intime se heurte pourtant à la prise en charge réductrice de l’INAMI. Depuis 2016, les critères de remboursement pour les réductions mammaires ont été modifiés, passant d’une évaluation individuelle des patientes par une ou un médecin-conseil à un formulaire standardisé d’une page recto verso.

Pour bénéficier du remboursement, il faut désormais que la poitrine présente une distance suffisamment importante entre le mamelon et le pli sous-mammaire, le dessous du sein où certaines peuvent faire tenir plusieurs crayons. La patiente doit avoir un indice de masse corporelle inférieur à 35, le palier qui correspond à une obésité sévère. La poitrine doit aussi entraîner une gêne, des « répercussions fonctionnelles ».
Enfin, le ou la chirurgienne doit s’engager à retirer au moins 400 grammes de tissu glandulaire par sein, l’équivalent d’un pamplemousse. Un critère arbitraire imposé par l’INAMI, qui admet une certaine marge de manœuvre : « C’est l’intention du chirurgien plasticien de réséquer 400 g qui compte et non le fait d’avoir 400 g précis sur la balance. » Des contrôles sont néanmoins possibles et engagent alors la responsabilité du chirurgien. En France, le minimum à retirer est 300 grammes et, au Luxembourg, 500. Des conditions qui ne prennent surtout ni en compte la morphologie des patientes ni leurs désirs pour leur propre poitrine.
« Je savais que je n’allais pas avoir la taille que je voulais », se souvient Clémentine, qui s’est faite à l’idée de se faire enlever 400 grammes pour bénéficier du remboursement et soulager son dos, passant d’un bonnet F à un petit C. Depuis l’opération, la jeune femme évite de regarder sa nouvelle poitrine, qu’elle juge trop petite. « J’aurais préféré faire du D », résume-t-elle en ajustant son chemisier.
Dans son cabinet privé de Braine-l’Alleud où se côtoient une armée de petits soldats de plomb et des implants en silicone, le docteur Jacques Duchateau, chirurgien plastique, hausse les épaules à la mention de ces nouveaux critères. Si l’INAMI avance un souci d’équité entre patientes pour justifier la standardisation de ses conditions, le médecin y voit d’abord une volonté de faire des économies en restreignant l’accès au remboursement. « L’INAMI a fait une belle affaire, puisqu’ils interviennent beaucoup moins qu’avant. » Selon un rapport de l’INAMI réalisé entre 2012 et 2022, les réductions mammaires coûtent en moyenne près de trois millions d’euros par an à l’institution fédérale. Après 2016 et le changement des règles (mais avant la crise du Covid), le nombre de prises en charge a effectivement chuté. Des réductions à la fois mammaires et budgétaires.
Jacques Duchateau affirme que bien plus de réductions mammaires que celles recensées par l’INAMI sont pratiquées en Belgique chaque année. Elles sont réalisées par des chirurgien(ne)s plasticien(ne)s, mais aussi par d’autres spécialistes, de l’ORL au gynécologue, en toute légalité. Il est difficile d’en évaluer le nombre. Dans un article de 2017, la RTBF en dénombrait plus de 7 000. Jacques Duchateau en a pour sa part cinq dans son calendrier tous les mois, mais ne remplit désormais de document pour l’INAMI que dans un quart des cas.
Sarah envisage depuis quelques mois de se faire opérer une seconde fois. Ses seins ont encore grossi depuis sa première réduction mammaire, quand elle avait 18 ans, et la gêne est revenue dans son quotidien. En réséquant à nouveau 400 grammes pour que cette intervention soit prise en charge par la mutuelle, son chirurgien estime que sa poitrine passerait d’un bonnet F à un bonnet B. Sarah devrait accepter de vivre avec des seins bien plus petits, une toute nouvelle morphologie. Son médecin lui a par ailleurs déjà annoncé qu’il ne chercherait pas à retirer 400 grammes pour qu’elle soit remboursée mais n’ait « plus de poitrine ».
Sarah sait qu’elle devra donc peut-être assumer les frais de cette nouvelle opération. « Il y a quand même une frustration parce que je n’ai rien demandé à la vie », admet-elle. Si les fortes poitrines ne sont pas forcément héréditaires, dans la famille de Sarah, la sœur, la mère et la grand-mère en ont toutes écopé. « Je peux me permettre de payer 4 000 euros, même si ça va bazarder dans certains projets, relativise encore la jeune femme, tout le monde ne peut pas en dire autant. »
Pour 100 grammes, t’as plus rien
À 100 grammes près, des patientes dont la situation ne légitime pas un remboursement financent, par leurs propres moyens et à l’aide de leur assurance, une opération dont le coût peut s’élever à plusieurs milliers d’euros ; à moins qu’elles ne choisissent une option low cost à l’étranger, avec des risques avérés.
Elles basculent en même temps dans un monde parallèle, celui de la chirurgie esthétique. Avec l’idée sous-jacente que leur opération ne serait qu’une coquetterie superficielle… La réduction mammaire fait partie de ces interventions dites « borderline », qui peuvent être nécessaires d’un point de vue médical, mais remboursées seulement sous certaines conditions.

La clinique des Houx, où officie la docteure Françoise Bluth, se trouve au milieu des champs et des éoliennes de la province de Liège. Dans l’entrée, il y a un sol presque pailleté et des magazines people. Les bêlements des moutons résonnent entre les bips du moniteur cardiaque de la salle d’opération. Ici, on vient pour des injections de botox, des augmentations des fesses, des greffes de cheveux, mais aussi des réductions mammaires et des mastopexies.
Françoise Bluth est moins critique à propos des conditions dictées aujourd’hui par l’INAMI, particulièrement en ce qui concerne l’indice de masse corporelle. Elle refuse les patientes « quand elles sont obèses ». La médecin souligne que l’excès de poids augmente les risques opératoires, que ce soit de phlébite ou d’embolie pulmonaire. « J’estime que c’est moi qui décide aussi, ajoute-t-elle. Je n’ai pas besoin de calculer l’IMC, dès que je les vois, je leur dis qu’il faut d’abord perdre du poids. »
Quand Camille commence à se renseigner sur la réduction mammaire l’année dernière, le chirurgien qu’elle consulte - recommandé par une amie - fait la grimace devant son IMC, qu’il juge « limite », bien que la jeune femme ne soit manifestement pas obèse. Mais l’étudiante n’est pas la candidate idéale pour une réduction mammaire dans l’imaginaire collectif teinté de grossophobie, à savoir « une fille d’un poids normal qui a de très gros seins, ça, c’est l’hypertrophie », décrit la docteure Bluth.
Pendant la première consultation, le chirurgien bruxellois rencontré par Camille lui conseille de faire du sport, ne lui parle que d’argent et s’agace lorsqu’elle paraît gênée de se déshabiller. Les deux rendez-vous auxquels l’étudiante se rend dureront chacun 15 minutes. « Je me suis dit que c’est peut-être ça l’esthétique, on te parle comme si tu étais une cliente », raconte-t-elle l’air dépité.

Dans le milieu de la chirurgie esthétique, le culte du « beau » apparaît indissociable de l’acte chirurgical, dans une idée unique de ce à quoi doit ressembler une paire de seins. « Personne n’aime les seins moches qui tombent. C’est facile de dire qu’il faut s’accepter, mais il y a une très forte pression exercée sur les femmes à propos de leurs seins. Il faut toujours être parfaite. De façon générale, on est moins exigeant avec les hommes », observe la docteure Bluth.
Cette recherche de perfection se retrouve même dans la technique d’incision utilisée, où on se dispute la meilleure méthode. Certains prêchent pour la technique de « l’ancre », la plus en vogue, qui laisse une fine cicatrice autour de l’aréole, au milieu du sein à la verticale et sous le sein à l’horizontale, tandis que d’autres ne jurent que par l’incision verticale qui resserre la peau sans incision sous-mammaire, pour éviter les cicatrices disgracieuses.
Lait et cochon grillé
Parmi les richesses que le Brabant wallon a à offrir, les amateurs et amatrices de grandeur s’attardent bien souvent sur le château de La Hulpe. Huppé, certes, mais pas autant que sa voisine, la discrète clinique Claris, où exerce le docteur Jacques Duchateau, dissimulée dans le complexe hôtelier « Dolce Hotels and Resorts » de la forêt de Soignes. Les clientes luxembourgeoises peuvent y réserver une chambre de luxe après leur lifting du visage, précise le chirurgien.
Dans le bloc opératoire, ce dernier est penché sur une poitrine orange d’iso-Betadine. Sous les tissus vert d’eau, sur la table d’opération, il y a Léa (prénom d’emprunt), 20 ans, qui subit une mastopexie pour remonter et réduire ses seins, mais de moins de 400 grammes. La pièce est envahie d’une odeur de cochon grillé, faute au bistouri électrique qui cautérise la chair que découpe Jacques Duchateau. L’infirmière pèse soigneusement les morceaux de tissu mammaire, dont une partie sera envoyée à l’anatomopathologie, « anapath » dans le jargon, l’endroit où sont analysés ces résidus pour y repérer d’éventuelles anomalies.
L’intervention dure moins de deux heures. Les seins sont à vif, puis découpés, resserrés, recousus. Même suturés, ils paraissent impeccables, deux demi-pommes toutes neuves. Parce que le visage de la patiente est caché, ce changement de poitrine la transfigure, la rend méconnaissable. La philosophe et chercheuse Camille Froidevaux-Metterie dédie l’ultime chapitre de son livre Seins, en quête d’une libération à cette idée des seins comme des visages, « l’incarnation de nos existences » féminines.
La réduction mammaire implique ainsi de se redécouvrir. Après l’opération, il y a la convalescence, « un mois où tu ne dors pas parce que tu dois rester sur le dos », se souvient Sarah. Les douleurs au réveil, les drains et les pansements enlevés. Puis cette nouvelle identité. « Le jour de l’opération, je me revois aller devant le miroir et les voir. Je les ai regardés pendant mille ans. Parce que c’était petit mais bien. C’était parfait. » Sarah n’était plus la fille à gros seins.