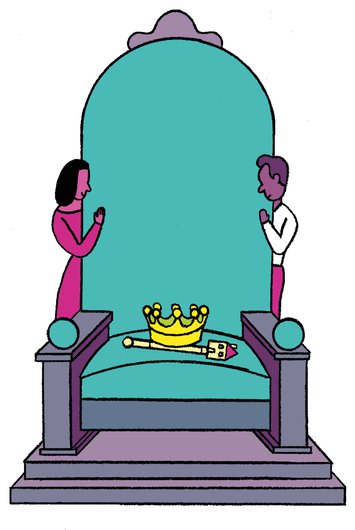Le combat de la mode, c’est d’être prise au sérieux
Entretien avec Francine Pairon
Textes et photos (CC BY-NC-ND) : Lydie Nesvadba
Textes (CC BY-NC-ND) : Céline Gautier & Jehanne Bergé
Publié le

En 1986, Sandra Kim gagne l’Eurovision, les Diables rouges sont en demi-finale à Mexico et Francine Pairon crée à Bruxelles La Cambre Mode/s/, qui deviendra l’une des plus prestigieuses écoles de mode d’Europe. Elle dirige ensuite un master en création au très prisé Institut français de la mode (IFM) à Paris. À ses étudiants, elle répète la phrase de l’artiste Joseph Noiret : « La rupture est création, nous dormirons plus tard. » Pendant des années, elle bouscule les futurs créateurs, les empêche de s’assoupir sur leurs fringues et forge une pédagogie unique, basée sur le travail pratique, l’expression de la personnalité de l’étudiant et la franchise de l’enseignant. Aujourd’hui, à 71 ans, Francine Pairon s’est mise au solfège, se passionne pour l’écrit et change ses meubles de place chaque fois qu’elle passe l’aspirateur. Peu importe la manière, pourvu que la créativité s’exprime.
Médor : Francine, on te tutoie. On s’est déjà croisées dans la vraie vie. Maintenant que c’est dit, peux-tu nous raconter les années 1980, à tes débuts, et le lancement par le gouvernement Martens du plan Textile (un plan quinquennal reconduit une fois), pour sauver l’industrie du textile et de l’habillement (100 000 à 120 000 emplois menacés) ?
Francine Pairon : À l’époque, toutes les usines textiles étaient en train de fermer. On avait un très bon savoir-faire, mais il n’y avait aucune connexion entre les créateurs et l’industrie. L’Institut du textile et de la confection de Belgique (ITCB) est créé en 1980. Ils se sont dit : c’est bien de subventionner l’industrie, mais, si elle n’a pas une image créative, ça n’a aucun sens. Des concours ont été créés, ils ont payé des stands dans des salons, ils ont offert aux entreprises les services de créateurs ou aux marques pas très créatives l’image d’un styliste en vue. Et tout ça apparaissait dans un gros magazine, Mode, c’est belge, qui coûtait l’équivalent de deux euros et avait développé une première campagne autour du thème « Nul n’est prophète en son pays ».
Cela n’a malheureusement pas suffi à sauver le secteur…
En effet. Ça restait très difficile et coûteux de produire en Belgique. Un créateur ne fait pas de grandes séries. Du coup, ce n’était pas rentable pour les ateliers de production. Et, de toute façon, les grosses séries étaient beaucoup moins chères à l’étranger. Petit à petit, la production s’est délocalisée vers le bassin méditerranéen, l’Europe de l’Est ou la Chine, et de plus en plus d’ateliers de confection ont fermé leurs portes.
Par contre, ce label « Mode, c’est belge », inventé par le fédéral en 1982, devient un concept…
Oui. Mais au départ, ça a commencé comme un canular, ce truc. On disait de tout ce qui était créé en Belgique : « C’est moche, c’est belge. » Mais il y a eu une prise de conscience de notre identité créative. Et on est passé à « C’est mode, c’est belge ». La Belgique est partie d’un énorme complexe.
L’ITCB lance aussi un concours de jeunes stylistes belges en 1982, la « Canette d’or » (pour les amateurs de pils, le terme « canette » désigne aussi une petite bobine de fil pour machine à coudre). Ann Demeulemeester (styliste rock et minimaliste, copine de Patti Smith) remporte la première édition. Martin Margiela (le secret fondateur de la Maison Margiela, qui n’accorde aucune interview et ne se laisse pas photographier) y fera sensation. Tu y étais ?
Oui. Je suis entrée dans cette salle de la Madeleine à Bruxelles, j’ai vu ces collections défiler sur ce podium… Je pense que c’est l’une des émotions les plus fortes de ma vie, tant ces silhouettes étaient d’une beauté et d’une intensité extraordinaire. Dans le jury, ils avaient invité des créateurs reconnus, comme Jean-Paul Gaultier. Et c’est comme ça que la mode belge a commencé à se faire connaître à l’étranger. Maintenant, dès que c’est belge, c’est fantastique.
En 1987, six stylistes sortis de l’Académie d’Anvers (parmi lesquels Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester et Dries Van Noten) font sensation au British Designer Show de Londres. À défaut de pouvoir prononcer correctement leurs noms, la presse internationale les surnomme les « Six d’Anvers ». Du côté francophone, tu viens de lancer une école…
On a créé le département La Cambre Mode/s/ en 1986, dans la foulée du plan Textile. Il y avait un grand élan autour de la mode, tout le monde voulait l’étudier, mais il n’y avait rien dans l’enseignement public côté francophone. La Belgique était complètement vouée à la création néerlandophone. Ils étaient très forts et omniprésents. Nous, on n’existait pas.
Comment La Cambre a-t-elle réussi à se faire une place à côté de ces Flamands-stars ?
On a participé à tous les concours internationaux. Au Festival de mode d’Hyères (LE rendez-vous des audaces, dédié à la jeune création internationale de mode, lancé aussi en 1986, NDLR), on a eu le premier prix, le prix de la presse,… On a été reconnu à Bruxelles par la vague internationale.

En 2014, Veerle Windels, une journaliste fashion qui compte en Flandre, écrivait dans le Standaard : « Pourquoi vous ne pouvez pas manquer le défilé de La Cambre. » Lors de la première édition, en 1989, elle était moins enthousiaste…
Oui, elle avait écrit de notre premier défilé que c’était moche, moche, moche. Heureusement, Le Soir avait titré « La Cambre est là ! » Et là, que des éloges…
La Cambre t’a donné « carte blanche » pour créer une formation de mode, de niveau universitaire, sur cinq ans. Mais tu n’avais même pas appris le stylisme. Tu t’es sentie légitime ?
Non. Même aujourd’hui, je ne me sens légitime pour rien. Mais je me suis dit : si on te le propose, essaie. Et chaque année, j’ai essayé, et chaque année j’ai revu ma copie. J’ai étudié l’architecture d’intérieur, c’est comme ça que j’ai côtoyé des artistes et des professeurs de La Cambre. J’ai créé quelques modèles de vêtements, qui ont été achetés par Tapta (sculptrice belge d’origine polonaise, NDLR), qui était professeure de sculpture souple à La Cambre. Quand La Cambre a voulu ouvrir un atelier de mode, mon nom est sorti de différentes bouches. Je suis partie de tous mes manquements. Je ne sais pas dessiner. Par contre, je suis née avec une paire de ciseaux dans la main.
Et donc, au lieu de dessiner des patrons sur du papier, en 2D, tu as d’abord invité les étudiants à travailler en volume…
Percevoir le volume d’un corps est complexe, car les gens ont conscience de leur masse, mais pas de leurs creux. Or, pour construire un vêtement, il faut visualiser ces vides et ces pleins. Aussi, on a fait le chemin inverse. On créait directement le volume sur les bustes ou sur corps et après seulement on mettait le volume à plat pour dessiner des patrons. En fait, le volume, c’est comme un fruit. Peler le fruit et vous en avez le patron. Mais vous aurez autant de patrons que de manières de peler. Imaginez maintenant que vous deviez faire le patron d’un fruit en calculant la circonférence puis la hauteur… C’est le casse-tête assuré.
Mais cette relation intérieur-extérieur, c’est aussi un véritable parcours identitaire…
Oui. Une de mes étudiantes, Ada, disait « personne ne me voit d’où je me regarde », et cette phrase continue de me hanter.
Le résultat de cet enseignement, c’est que le défilé de La Cambre est devenu un événement incontournable, qui attire les amateurs de mode, d’art ou de paillettes…
Pour moi, le leitmotiv, c’était de développer des personnalités, un langage propre, un style identifiable. Et cela, en faisant fi des tendances, mais en respectant des codes de fabrication corrects. On cherche à toucher la personne en face de soi. La mode doit être vue. Le défilé, c’est la ligne d’arrivée. Toute l’organisation, la conception artistique, c’est un travail monumental, ça n’a rien de bling-bling.
La Cambre, fondée en 1927 par l’architecte Henry Van de Velde, est avant tout une école d’art, comme l’est aussi l’Académie d’Anvers. Ce n’est pas anodin…
En effet, c’est une école publique qui s’inscrit dans une école d’art. L’idée est d’exprimer un langage identitaire fort et très personnel (pour former des créateurs de mode). Dans les écoles privées, l’enseignement est généralement plus orienté vers les tendances et le système de la mode (formant principalement des stylistes).
Les silhouettes proposées en défilés sont parfois excentriques. Comment rencontrer des acheteurs potentiels ?
À l’intérieur d’une collection, il y a différents degrés. Lors du défilé, il y a un étendard, une image qui va frapper l’œil. Ensuite, cette idée exacerbée est déclinée dans des éléments plus portables que l’on retrouve en boutique.
La mode est-elle incomprise, même dans notre pays de créateurs ?
Oui. Quand j’allais chercher de l’argent auprès des ministères pour nos événements, on me répondait : « Mais, Madame, comment voulez-vous qu’on soutienne quelque chose d’aussi frivole que la mode ? » Ça me mettait dans une colère noire. Je leur disais : « Là vous portez un vêtement, allez voir les frivolités qui se cachent sous votre doublure. » La mode est vue comme superficielle. Elle n’aura jamais le statut du design ou de l’architecture. Tout le combat de la mode, c’est d’être prise au sérieux, tant par le secteur artistique que par le secteur économique.

En 1967, Yves Saint Laurent propose le premier « tailleur-pantalon » pour femmes. Il déclare : « Le temps des femmes-poupées et des hommes dominateurs est révolu. » Il y avait une réflexion sur l’usage. C’était un engagement. C’est quoi l’équivalent aujourd’hui ? On a parfois l’impression que les créateurs se regardent le nombril.
Par exemple, à la période de la Canette d’or, Sami Tillouche a représenté une masculinité douce, fine. On sortait d’une virilité affirmée, il n’y avait pas d’autres propositions à l’époque. Certains se sont reconnus dans cette proposition d’hommes doux. Pour moi, ce n’est pas une question de nombril. À partir du moment où tu crées quelque chose qui a une identité claire, tu peux devenir le porte-drapeau de gens qui ont une énergie qui ressemble à la tienne. Comme Ester Manas, qui s’adresse à tous les types de corps (ses pièces peuvent être portées indifféremment par une femme faisant un 34 comme un 50, NDLR), ou Jean-Paul Lespagnard, qui travaille dans la mode, la danse, le théâtre, le rock… Il a une énergie créative explosive et positive. Dans un monde qui devient complètement morose, c’est une réponse enthousiasmante.
À condition qu’on aille vers ce type de petites productions… La plupart d’entre nous se tournent plutôt vers la fast-fashion. Ce faisant, on sabote le travail des créateurs ?
Absolument. Avant, dans les défilés de mode, les photographes étaient interdits, il y avait juste des dessinateurs qui croquaient les modèles. Le contexte a complètement changé. Avec les réseaux sociaux, dès qu’un défilé est passé, toutes les marques digèrent les recherches des créateurs pointus et les transposent dans quelque chose de plus commercial. Tout le temps nécessaire à la gestation d’une collection, l’énergie pour la produire, c’est un travail immense. Et copier, ça se fait maintenant en trois coups de cuillère à pot. C’est un véritable scandale, en fait. Une provocation énorme.
Il y a encore quelque chose de politique à la mode ?
L’acte politique se trouve à tous les échelons. Le créateur pense individuellement d’une façon authentique, personnelle, qui l’engage. C’est déjà un acte politique. Après, l’idée, il faut la produire. Quelle matière, quel colorant choisir ? Faut-il opter pour les circuits courts en Belgique, la vente par Internet ? Chaque étape est un choix politique. Et chaque personne qui porte un vêtement s’engage aussi. Les gens qui disent « Primark, c’est génial », s’ils savaient un tout petit peu ce qu’il y a derrière tout ça… Le problème, c’est qu’en achetant des choses à 3 ou 5 euros, tu crois qu’elles coûtent 3 ou 5 euros. Et tu valides tout un système qui est basé sur l’exploitation des gens et la pollution de la planète. C’est à tout niveau que c’est puant. Et après, comme ça n’a rien coûté, tu le balances et tu rachètes un nouveau truc. Le plaisir est dans le fait d’acheter. C’est de la consommation pure et dure, c’est comme bouffer. Je pense qu’aujourd’hui, on ne peut plus être dans une action innocente. Il vaut mieux avoir un beau truc plutôt que vingt trucs moches.
C’est quelque chose que tu as transmis aux étudiants ?
Avec mes étudiants de première année à La Cambre, on passait une après-midi rue Antoine Dansaert pour rencontrer les créateurs et les gens qui géraient les boutiques. Je demandais par exemple à Sonja Noël de chez Stijl (un magasin multimarque de créateurs, NDLR) de nous présenter trois pièces et de nous expliquer pourquoi ça coûtait si cher. On allait aussi chez Delvaux. Et on terminait par le bas de gamme, mais à l’époque il n’y en avait pas beaucoup (les chaînes Zara, H&M et Cie se sont développées à l’international dans les années 1990 et 2000, NDLR). Au bout de la journée, un truc était tombé dans leurs yeux, ils disaient : « Quand je vois la qualité, je crois que je vais mettre un peu de thune de côté ou acheter vintage plutôt que d’acheter un truc de merde. »
Tes étudiants, comme tout le monde dans le milieu de la mode, ne t’appellent pas « Francine Pairon », mais « Franc’ Pairon »… (on prononce « France »).
Non, justement, surtout pas « France » ! Mais « Franc » (elle prononce : « fran ») ! Francine, ça faisait « coiffure Francine », c’était trop gentil. Si tu enlèves le « ine », c’est franc, c’est net.
La franchise t’a aidée en tant que prof ?
Oui. Ma question, c’était : « Comment dire sans blesser ? » Quand on enrobe, on rate le message. Quand un étudiant présente son travail, si je lui dis « oh, tu as l’air fatigué, je vois que tu as passé beaucoup de temps sur ton travail, on va essayer de trouver quelque chose à retirer de ce projet… », il s’endort sur ce qu’il a retenu de positif parce que je n’ai pas ouvert la porte à la critique. Mais, si je commence par « là je crois qu’on ne peut rien faire avec ton truc. Ce n’est pas dramatique, je vois que tu as travaillé, mais on jette ça par la fenêtre et demain tu me ramènes un truc nickel », alors, je suis confiante dans ce que je dis, je reconnais la qualité de son travail et je lui ouvre une porte – demain, ça sera mieux.
Tu as dû travailler sur toi pour gagner cette assurance…
Je n’en ai pas l’air, mais je suis née timide. J’avais une longue frange jusque dans les yeux. À l’église, je comptais les carrelages pour revenir à ma chaise sans lever la tête. Dans mon éducation, se mettre en avant, c’était se vanter. Et ça, ce n’était pas beau. Du coup, j’étais la fille qui hésitait sur tout. Un jour, je me suis dit : « Tu ne vas pas passer ta vie à être timide comme ça. » La réponse à cette timidité presque maladive, ça a été la spontanéité. J’ai coupé dans mes cheveux, j’ai coupé dans mon nom, j’ai coupé dans tout.
« La rupture est création, nous dormirons plus tard », cette expression de Joseph Noiret, ancien directeur de La Cambre, que tu répètes volontiers, est aussi à l’image de ton parcours personnel…
Plus personne ne peut imaginer ce que c’était d’être une femme dans les années 70. J’avais une vie tellement bien rangée, mariée à 22 ans, deux enfants. Mais petit à petit, je sentais que ma vie rétrécissait. Tu crois que l’amour passe par le don de soi – or ce n’est pas ça. Le don de soi peut mener insidieusement à l’abnégation de soi. C’est dans ces années-là que j’ai puisé toute mon énergie pour la suite.
Parce que tu as fini par changer de vie, à une époque où ça n’était pas si fréquent.
La rupture, je l’ai expérimentée à 33 ans, en devenant, presque du jour au lendemain, une femme sans mari et une mère sans enfant. Divorcer était un choix mais pas celui de m’éloigner de mes enfants. Cette solitude imposée, brutale m’a mise face à moi-même. Je devais sortir tout ce que j’avais en moi, sinon à quoi bon, ce grand charivari ? En 1982, j’ai pris un atelier. C’était un vent de liberté, mais quel enjeu ! La barre était si haute. Je m’interdisais d’aller dormir si je n’avais pas fait un vêtement par jour. C’était ma discipline.
Et très vite, tu as développé une approche pédagogique…
J’ai fait des ateliers dans des endroits pourris, où je m’amusais à habiller des gens qui avaient des garde-robes fragmentées, avec des vêtements pour travailler, d’autres pour sortir avec des amis, d’autres pour la famille. Ils n’avaient pas conscience de la possibilité de développer un style. « Et si on s’amusait à s’habiller ? », ai-je proposé. On faisait des jeux de rôle dans des temps chronométrés. Ça a donné des résultats magnifiques. Je n’oublierai jamais cette fille qui avait un joli minois, mais des cheveux de chien mouillé, qui se tenait rentrée, comme quelqu’un de très introverti. Le groupe avait exactement un quart d’heure pour l’habiller, selon des directions précises (par exemple « dynamique », « comédienne », « confiante », etc.). Ils l’ont transformée. Elle s’est regardée dans le miroir et est partie en pleurant tellement c’était fort pour elle d’être confrontée à cette beauté. Là, je me suis dit qu’on touchait à quelque chose de très sensible.
Nos vêtements disent quelque chose de nous ?
Un vêtement, c’est une carte de visite silencieuse. Il parle de toi avant que tu n’ouvres la bouche. Ce n’est jamais anodin. À Paris, je faisais des workshops avec des gens du management. Je mettais les tables en U et je leur demandais de marcher les uns après les autres au centre. Les autres devaient dire ce que, selon eux, la personne envoyait comme message. Ils disaient : « il aime la mode », « il est plein de fric », « il aime la symétrie », « une nonchalance », « un intellectuel fatigué »…
C’est comme les jeunes, ils ont besoin de se rattacher à une tribu qui leur ressemble. Si tu n’as pas ta propre personnalité, soit tu veux te fondre dans la masse, soit tu souhaites ressembler à une tribu à laquelle tu veux appartenir. Ou alors, tu peux être le leader d’une nouvelle tribu que tu vas créer. L’Angleterre a été souvent en avant de ces mouvements-là.
La pédagogie a été ton cheval de bataille. Qu’est-ce que l’école t’inspire aujourd’hui ?
Il y a beaucoup de choses à revoir. L’intelligence est connectée avec les émotions. Il faut susciter l’intérêt, capter l’attention, proposer à l’élève de mettre les choses en pratique lui-même. Il faudrait qu’on exploite autant ce qu’on appelle les défauts que les qualités. Souvent, les profs veulent gommer les défauts au lieu de les accentuer. Mais ce qu’il faut, c’est créer la différence, ce qui fait la force de la personne.
Face à des étudiants apathiques, je demandais souvent : si vous deviez descendre dans la rue et brandir une pancarte, que revendiqueriez-vous ?
Aujourd’hui, tu es plus attachée aux mots qu’aux images. Finalement, la mode n’aura été qu’un prétexte pour toi, un médium créatif ?
Ce qui est fondamental, c’est comment aborder la construction de soi. La mode, je m’en fous (elle éclate de rire).