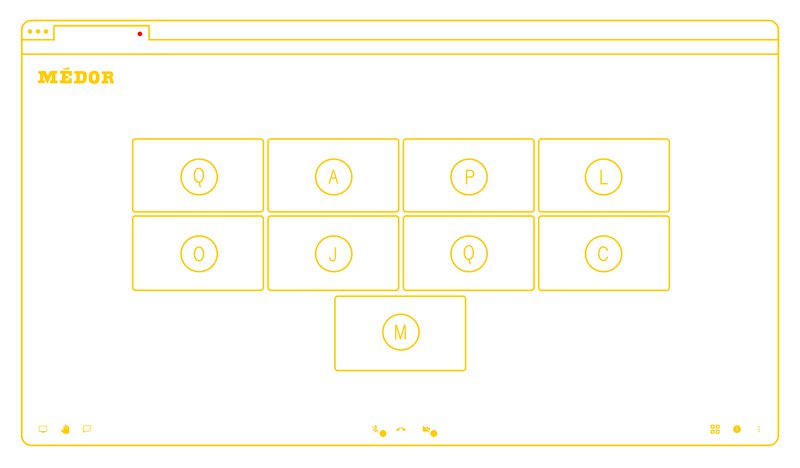« Longue vie aux pangolins ! »
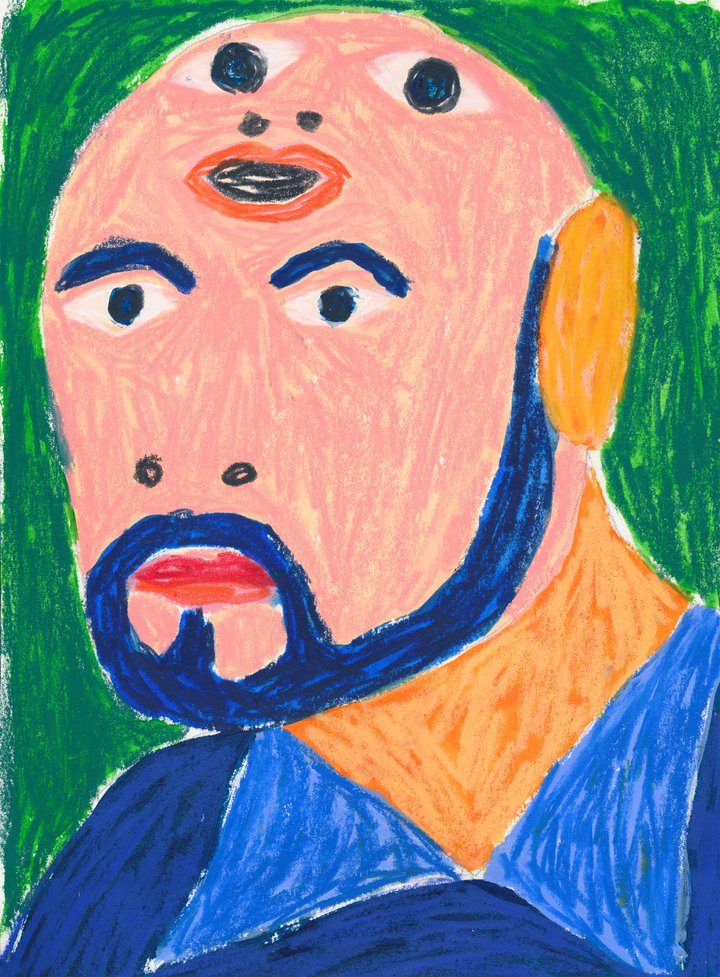
Comment renoncer à l’ennui quand on se sait condamné ? Survivant d’une tumeur maligne au cerveau, l’écrivain et philosophe Patrick Declerck dézingue l’incorrigible Homo sapiens, « un destructeur ».
Un propos noir et cinglant comme l’arme du sniper professionnel qu’il est devenu. Décalé et drôle, aussi.
Il y a bientôt quinze ans, Patrick Declerck apprend par son médecin qu’il souffre d’une tumeur au cerveau. Agressive, mal positionnée. « Il m’a dit de régler mes affaires. J’ai réagi en allant m’acheter un fusil de chasse de marque Browning pour me tirer une balle dans la tête au cas où… » Sa hantise ? Assister sans mots à sa déglingue : ne plus pouvoir parler, écrire, surtout, penser le monde, caresser son chien, les seules choses qui comptent vraiment à ses yeux. En mars 2013, Patrick Declerck, également anthropologue, philosophe et psychanalyste, s’est donné un peu de rabiot en se laissant dévisser la boîte crânienne, comme il le raconte crûment dans Crâne. L’écrivain est resté éveillé et conscient pendant toute l’opération, guidant les chirurgiens pour extirper la tumeur sans abîmer le langage. Patrick Declerck a gardé la parole. Il avoue en être sorti chamboulé, à la fois libéré, confronté à sa limite ultime et conforté dans ses désillusions. « Il y avait un peu plus de 3 % de risque que cela finisse mal. Ce qui d’ailleurs n’est pas sans évoquer les statistiques du coronavirus. »
3 %, c’est peu ? C’est beaucoup ? On ne sait combien de morts fera l’épidémie actuelle, mais l’écrivain rappelle, avec un bon sourire, que, « quels que soient le scénario et les causes précises, le taux de mortalité finit toujours par rester stable, soit 100 % pour l’ensemble des vivants. Nous sommes plus de 8 milliards sur terre, c’est grotesque. L’invasion, c’est nous. La vraie épidémie du monde, c’est nous. Et voilà qu’Homo sapiens découvre – incroyable ! – qu’il est mortel. Je ne vais pas le plaindre, dit-il. Ce monstrueux primate détruit la terre entière et dévore tout y compris ces pauvres pangolins qui n’ont jamais rien demandé ni fait de mal à personne. Les instincts structurellement pourris de notre chère Humanité démontrent sans cesse à quel point elle est irrécupérable. »
La mort programmée, la peur de tout et la santé non garantie, l’émerveillement pour le bisou d’un phoque en Bretagne où ce Bruxellois de Paris est confiné : voici l’interview d’un athée aimant s’aventurer aux limites extrêmes de la normalité. Un hom-me qui a roulé sa bosse, vécu en rue avec les sans-domicile fixe (SDF) (« je suis ethnologue ») et qui les a soignés chez Médecins du Monde puis à l’hôpital de Nanterre. Plutôt rare dans les médias, il avait prévenu Médor. « Ma philosophie est parfois scabreuse. »
LE « COURAGE »
Le 13 avril, le président français Emmanuel Macron en appelle au « courage » de la nation face au confinement prolongé. Idem en Belgique, la première patrie de Patrick Declerck. Né à Bruxelles, le 18 novembre 1953, lauréat du prix Rossel, l’écrivain belgo-français aime se moquer de lui, de nous : le courage, ça s’apprend ?
Patrick Declerck : Le courage, je l’ai cherché quand j’ai été opéré du cerveau, je ne l’ai pas trouvé. Je ne sais pas ce que c’est. La peur, en revanche, est omniprésente dans nos sociétés. Avec ce virus, le monde entier a peur. Il faut tout de même mettre en perspective ce qui nous arrive : aux États-Unis, le pays où il y a le plus de victimes – plus de 60 000 décès fin avril – 300 000 personnes sont mortes d’un cancer ou d’un accident cardio-vasculaire depuis le début de l’année. Je respecte la douleur des proches des victimes du Covid-19 et voir des enfants frappés est atroce car aucun d’entre eux n’a demandé à être là. Mais pour le reste, ce qui arrive, épidémies, guerres et catastrophes diverses, le moins que l’on puisse dire est que nous l’avons bien cherché. Avoir quoi que ce soit à faire avec la destruction du vivant me devient insupportable. L’Humanité commet horreur après horreur. Ma rage est sans fin et j’ai choisi mon camp : vive les pangolins ! S’il existait un front de libération de ces animaux à écailles, je serais son premier adhérent.

(Il ressent une pointe de perplexité.)
Ma vision d’Homo sapiens est souvent accusée d’être cynique et glaciale. Qu’on pense cela de moi m’indiffère. Je ne suis pas là pour plaire à quiconque. On impute aux pangolins ou aux chauves-souris ce virus mondial venu de Chine. Mais pourquoi continuons-nous à manger la terre et tout ce qui y vit ? Je suis trop velléitaire pour devenir végétarien, mais je devrais l’être.
Nos pays ont réagi par le confinement. Vous auriez fait autre chose ?
Non. Et personnellement, le confinement me va très bien. Ayant une vie sociale quasi inexistante, je ne m’aperçois même pas de la différence. Je sors mon chien, ça oui, mais je déteste le bla-bla. Tous ces échanges de salon où on est à la recherche d’une sorte de douteuse satisfaction identitaire du genre « c’est moi, le plus intelligent, etc. » ne sont que vanité et imbécile perte de temps ! Au début du confinement, j’ai relu Daniel Defoe, l’auteur de Robinson Crusoé. Dans A Journal of the Plague Year, il a reconstitué l’année où la peste a ravagé Londres, en 1665. C’est étonnant de ressemblance sur les précautions prises aujourd’hui. On disait à la population « Restez chez vous, protégez-vous ». À l’époque aussi, les Londoniens avaient placé des gardiens devant les maisons, ce qui n’empêchait pas les gens de tricher. Cette merveilleuse Humanité n’a jamais évolué… Le personnage principal de Daniel Defoe discutait de sa foi avec son frère et lui-même. Ai-je péché ? Qu’ai-je fait ? Il se tournait vers Dieu, ce grand humoriste…
Peut-on tirer quelque chose de positif d’une telle expérience hors norme ?
Nous semblons être dans la redécouverte permanente de ce qui a été vécu et ravagé. Je pense donc que la pandémie actuelle ne va rien changer. La preuve, nos dirigeants ne pensent qu’à une chose : faire reprendre l’économie. Notre idéal n’est que celui d’un produit intérieur brut toujours en croissan-ce et détruisant la planète avec enthousiasme. L’Humanité, collectivement, n’apprend jamais rien. Certains individus, oui. La masse, non, rien, jamais !
Il y a zéro espoir d’une prise de conscience collective ?
L’espoir est une illusion comique. La pire chose que pourraient écrire les médias est que l’histoire de l’homme n’est qu’une navrante répétition sans fin. Ils se tireraient alors une balle dans le pied.
LA PITIÉ
Au début de sa carrière d’écrivain, Patrick Declerck a publié plusieurs livres sur sa rencontre avec les SDF à l’hôpital de Nanterre, dans la banlieue de Paris. Il dit avoir voulu vivre la précarité au ras des pavés. « Je n’avais pas 40 ans. À cet âge-là, on est encore bourré de testostérone. » Ensuite, on mûrit. Pour Declerck, le désenchantement remonte à cette époque. Pourquoi ?
Je suis resté dix-neuf ans au contact des SDF. Ce sont des survivants, capables de tenir fort longtemps avant de mourir soudain et très vite. L’alcool éteint leur insupportable conscience. Les SDF sont issus de la même famille que les prisonniers et les prostituées. Ils m’ont permis de beaucoup réfléchir à la supposée normalité à laquelle on nous demande de croire. Je me sens très proche d’eux : ils ne parviennent pas à donner un sens à leur vie – moi non plus.
J’ai lu que vous aviez un sentiment de pitié à leur égard…
La pitié est à peu près la seule chose en laquelle je crois encore. Pitié qui n’a rien à voir avec cette sorte de condescendance doucereuse et méprisante qu’éprouvent les dames patronnesses à l’égard de quelques mendiants adéquatement méritants. Non, celle dont je parle vient de l’incontournable évidence que l’Autre, quel qu’il soit, est d’abord et avant tout une version alternative de moi-même, ou à tout le moins de ce que j’aurais pu être si les circonstances de la vie avaient été différentes. Et cela s’étend de près ou de loin à l’ensemble du vivant, animal et végétal. Que cela plaise ou non, nous sommes les très, très lointains descendants d’algues qui ont mal tourné… Alors, pitié pour le vivant, pour les vivants ! Et pour tel ou tel humain, mais en aucune façon pour l’Humanité dans son ensemble. Combien faudrait-il de Jean-Sébastien Bach pour effacer Auschwitz ?
LA MALADIE, LA MORT
En 2008, Patrick Declerck sait qu’une tumeur au cerveau ne le lâchera plus. Il écrit Socrate dans la nuit. Un ouvrage dur, où l’écrivain et psychanalyste freudien évoque l’arme acquise pour abréger – si nécessaire – sa souffrance de ne plus pouvoir penser, parler, écrire. Des lecteurs y verront un
remède face aux angoisses de mort : au moins, il y a une échappatoire à la perte de sens. « Quand on me dit ça, je me sens d’un coup utile. Un peu. Même si beaucoup de gens détestent ce que j’écris et me prennent pour un sale type… » En 2015, Declerck raconte tout aussi cliniquement ce qu’il ressent avant, pendant et après l’ablation d’un demi-cerveau, comme il dit en ricanant.
Un de ses médecins, choqué par le compte rendu clinique, n’a pas pu lire ce récit vécu de l’autre côté du bistouri. « Mort, c’est mort. Sur la table, j’ai perçu ce que c’est de ne pas avoir de conscience. » Serait-il le même homme sans la tumeur, sans la maladie ?
(Il hésite.) Sur le fond, oui. Mais ce qui a changé est que je ne peux plus maintenant oublier un seul instant que mes jours sont comptés. Vivre une chirurgie extrême a quelque chose de libérateur. On sait que l’on va finir par mourir et on commence à s’en foutre un peu. Mon existence, en soi, ne compte pas beaucoup ; tout au plus pour la demi-douzaine de mes proches. Quant à « invoquer sa postérité, comme disait Céline, c’est faire un discours aux asticots ».

Et cette confrontation avec la mort a-t-elle changé votre vision de l’Humanité ?
Je ne peux maintenant plus refouler l’évidence de ma mortalité. Cela fait de moi un être en exil. En revanche, ma vision du monde, riante comme vous l’avez remarqué, ne date pas d’hier. Ainsi, en 1966 au Katanga, j’ai vu, un jour, un type traîné au sol et battu par la police locale. « J’ai soif », répétait-il… Le lendemain, au village, dans des affiches collées sur les murs, on pouvait lire le nom de cet homme et la cause de sa mort : « Mort de soif ». Une autre fois, j’ai vu un groupe allant attaquer le village voisin en agitant le bras découpé à la machette d’une supposée sorcière… J’avais 12 ans, cela laisse un brin rêveur… Aussi, je refuse d’être un acteur de ce monde. Je l’observe, c’est tout.
Vous avez pensé au suicide ?
Oui. Une chirurgie peut aussi rater. Et de telles pathologies finissent toutes mal. La question du suicide en fin de partie se pose donc même si je n’ai, personnellement, jamais eu de tentations de ce type. Mais l’interrogation est de savoir jusqu’à quand il est encore raisonnable de continuer. Je sais, pour y avoir travaillé, que la médecine d’hôpital peut amener à vivre au-delà de ce qui vaut la peine. À un moment, on peut se retrouver enfermé dans sa propre survie.
Vous pensez ça pour les gens des homes, victimes directes ou indirectes du coronavirus ?
Je ne m’autorise pas à penser de telles choses pour les autres.
SNIPER EN QUESTIONS
En septembre 2012 et en mai 2016, avant et après sa délicate opération au cerveau, Patrick Declerck brave sa peur bleue des airs et s’envole aux États-Unis. Il s’y forme dans une école d’Arizona au métier de sniper professionnel. L’écrivain, l’intello se retrouve au contact des baroudeurs qui prennent leur pied en faisant sauter une tête à 1 200 mètres sur une cible hyperréaliste. Pourquoi cette passion atypique ? C’est grave, Docteur ?
Pour écrire quelque chose, il faut que j’en fasse, au moins partiellement, l’expérience. C’était un fameux monde que cette école spécialisée. Il y avait des Marines instructeurs ayant fait l’Afghanistan, revenus
d’Irak 1 et 2, des civils prêts à intégrer des organismes paramilitaires travaillant, entre autres, pour la sécurité des ambassades des États-Unis au Moyen-Orient et aussi, quelques fanatiques des armes. Je vais raconter ça dans mon prochain livre. Il s’appellera : La raison pure. Sniper en Arizona.
Vous aimez les États-Unis ?
Pas les États-Unis, mais New York. J’y suis arrivé à 11 ans. Mes grands-parents étaient des petits bourgeois bruxellois mollement catholiques. Et là, d’un coup, je découvrais un nouveau monde, un univers multiculturel, des milieux de vie d’intellectuels, de juifs et d’athées. Si je devais avoir une identité, je serais New-Yorkais.
Vous vous dites marqué par le 11-Septembre, mais pas par le Covid-19 ?
Ce sont deux choses différentes, mais elles ont un point commun : l’Humanité ne marche pas. Le 11-Septembre, ça m’a plus qu’énervé. Outre les religions que je déteste et méprise toutes, l’envie et l’argent charrient les instincts autodestructeurs.
Vous êtes insondable, sur un plan politique…
Si être de gauche, c’est croire en l’homme et être de droite, c’est rêver d’avoir une Porsche, je ne suis ni l’un ni l’autre. Mais si penser qu’il est essentiel que les enfants, où qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, aient de quoi manger, aller à l’école et vivre convenablement, alors je suis de gauche jusqu’à l’os. Ma critique et ma détestation de l’Humanité s’arrêtent aux animaux et aux enfants.
Le lien entre votre opération au cerveau et vos voyages en Arizona, c’étaient les armes, le besoin d’en posséder une « au cas où » ?
(Il sourit, je le sens.) Oui et non. J’ai toujours vécu avec des armes. Mon oncle était un mercenaire katangais – j’en parle dans plusieurs livres. Mon père aimait aussi les armes. À 6 ans, j’ai reçu ma première carabine à plomb. À 11 ans, je tirais avec une 22 Browning long. Cela dit, il va de soi que je hais les chasseurs. Si j’avais à tirer sur quelque chose, ce serait sur mon vieil ennemi, Homo sapiens.
Au fond, c’était quoi, votre quête, en Arizona ?
Y aller et passer par le New York du 11-Septembre, je trouvais que ça avait un certain style… Mais au fond, je suis toujours engagé dans la même recherche, que ce soit en vivant avec des SDF, en décrivant ce que signifie être éveillé pendant une opération du cerveau ou en me mêlant à des snipers professionnels. C’est la même quête : explorer et décrire l’Humanité dans ses limites. Quant à tirer au fusil de guerre sur la photo d’un visage humain pour y dessiner un smiley, comme on le fait dans ce type d’école, il faut bien admettre que cela génère une sorte d’excitation un peu particulière. C’est quoi être sniper ? C’est apprendre à être un meurtrier à distance très efficace.
Ça vous permet de manier avec précision l’arme que vous envisagez de porter vers vous ? Donc, ça vous rapproche de votre mort ?
Je n’ai plus grand-chose à perdre. Je n’ai pas à m’en faire pour mes plans de retraite – d’ailleurs, je n’en ai pas (il rit). Je sais que ma fin n’est probablement pas aussi lointaine que je le souhaiterais, mais, au fond, cela m’indiffère. Et surtout, ça ne m’empêche pas d’être très sensible au bisou que vient de me faire ma chienne, là, maintenant, pendant qu’on se parle.