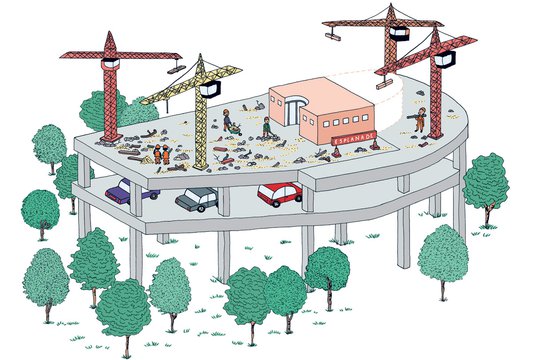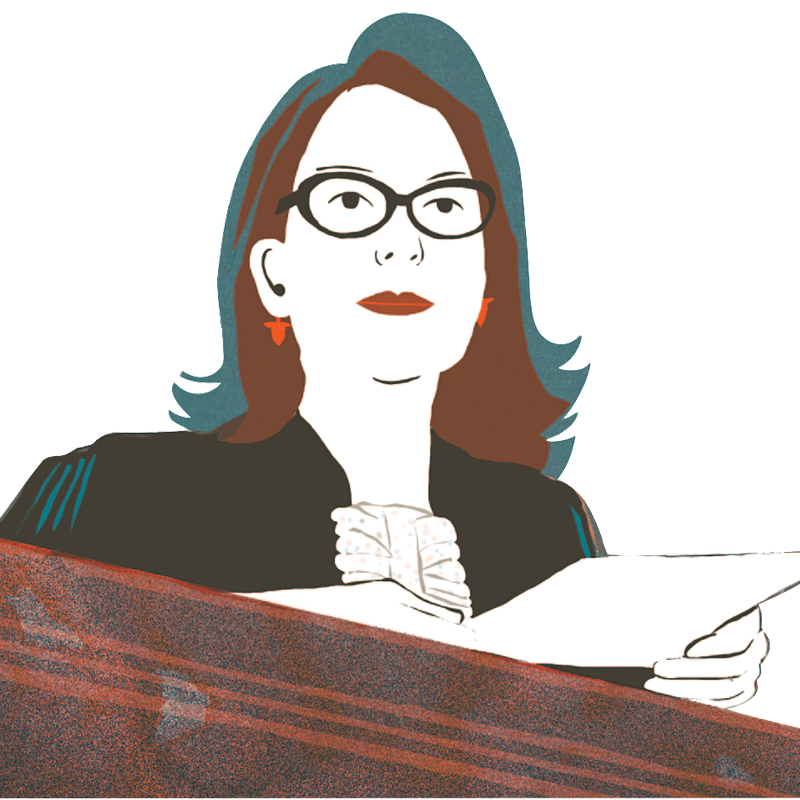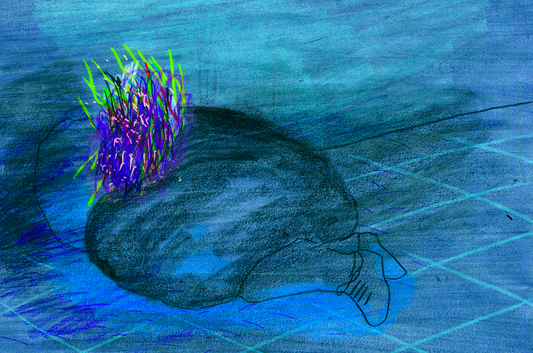Médor.e n’est pas un.e chien.ne
Texte (CC BY-NC-ND) : La rédaction
Publié le
« Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » La phrase du grammairien Nicolas Beauzée date de 1767, mais elle illustre un fait toujours d’actualité : la langue est un lieu de pouvoir.
Or la langue, c’est aussi le premier outil du journaliste. Ce qui place notre profession face à une responsabilité qu’elle ne peut contourner, celle de questionner son propre usage de la langue.
Et les faits sont là. Depuis le XVIIe siècle, l’usage du français a été façonné et normé, notamment sous l’impulsion du cardinal Richelieu et de l’Académie française, dans une logique de domination du masculin sur le féminin. Deux exemples : c’est l’Académie qui décida d’abandonner la règle de l’accord de proximité héritée du latin (Racine écrivait encore « trois jours et trois nuits entières ») jusqu’à ériger en règle absolue celle du « masculin l’emporte sur le féminin ». Elle aussi qui imposa de supprimer le féminin de tous les noms de métiers jugés trop savants. Adieu « philosophesses », « peintresses » et autres « médecines », alors en vigueur ! Pour les caissières, nettoyeuses ou aides-soignantes, qu’on se rassure : elles n’ont jamais fait d’ombre à personne.
Chez Médor, la place du féminin dans la langue alimente les conversations depuis notre première sortie. Pouvions-nous éviter plus longtemps le débat public avec nos lecteurs et lectrices ? Quelques médias francophones féministes, comme le magazine belge Axelle, ont ouvert la voie à une remise en cause des règles linguistiques machistes. Non seulement les journalistes y appliquent les recommandations officielles sur la féminisation des titres de fonction1 – ce qui n’est pas en soi avant-gardiste puisqu’elles datent des années 1990 – mais ils remettent aussi en question certaines règles de grammaire issues de cette même époque où l’on voulait empêcher les philosophesses de philosopher.
Pour tenter de faire bouger les choses, sans bénéficier de l’aide d’une institution normative, chacun y va de son initiative, qui abîme plus ou moins les yeux. Et c’est ainsi qu’on voit fleurir des « bonjour à tou-t-e-s », « lecteur/trice », « ami·e·s du death metal » ou des plus doux « lecteurs et lectrices »… Les représentants des coopérateurs au CA de Médor ont d’ailleurs adopté la grammaire égalitaire dans leurs newsletters, sur le modèle « Cher·ère·s copatron·nes ».
Pour notre magazine, nous avons consulté notre correcteur, Eddy. Qui l’a promis : dans cette vie-ci, il ne passera pas à ces « graphies tordues ». Et pourtant, Eddy est du genre à féminiser davantage que les recommandations officielles. Il concluait sa réponse, parfaitement égalitaire et un rien provocante, en citant un collègue se demandant si « l’humain était un·e lou·p·ve pour ses pair(e)s » et si « Médor(e) – qui n’est pas un(e) chien(nne) – lisait cela, mordrait-iel l’auteur·trice ? »
Sans aller jusqu’à croquer des mollets, comment utiliser notre outil premier, l’écriture, pour rendre leur place aux femmes ? Les linguistes le savent, c’est l’usage qui fait la norme. En 2005, une décennie après l’édition de son premier « Guide de féminisation des noms de métiers », la Communauté française observait une progression, lente mais sûre, des mentalités.
Mais, dans le même temps, une étude menée auprès des administrations publiques relevait une résistance à la féminisation « chez certaines femmes qui occupent pour la première fois un poste jusque-là réservé à un homme ». Et qui s’obstinent à se faire appeler « Madame le directeur ». Comme si, en ajoutant un petit « -trice », ces femmes perdaient tout à coup la bataille de l’égalité qu’elles venaient à peine de gagner.
Dès l’accès de la deuxième femme à ces mêmes postes, « le besoin d’être appelée par un titre masculin disparaît », notait la Communauté française. Comme quoi, combattre les décisions de vieux perruqués à la langue congelée, cela passe avant tout par la pratique quotidienne, dans les journaux comme sur nos cartes de visite. Dans un esprit ouvert, positif et non moralisateur.
Pour les journalistes, cela participe à un défi plus large, et plus urgent encore : donner la parole aux femmes. Et pas uniquement dans les articles consacrés aux couches lavables. En 2015, l’Association des journalistes professionnels menait une étude sur la diversité et l’égalité dans la presse quotidienne belge francophone. Résultat : les femmes occupent moins de 18 % de l’information. Seuls 16 % d’entre elles sont identifiées avec un nom complet et une profession, contre 83 % d’hommes. Si on décortique les articles liés à la sphère « travail », 84 % des intervenants sont des hommes. Au rayon « famille », en revanche, on obtient – miracle – une quasi-parité. Pendant que les deux pilotes (de sexe féminin) de ce numéro de Médor méditent sur ces chiffres interpellants, leurs mecs, bien dans leur siècle, gardent les enfants. C’est ça aussi faire un média innovant.
« Mettre au féminin. Guide de féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres », Fédération Wallonie-Bruxelles, 3e édition, 2014.