Musique belge : L’oreille cassée
Textes (CC BY-NC-ND) : Chloé Andries & Olivier Bailly
Illustrations (CC BY-NC-ND) : Noëmie Béchu
Textes (CC BY-NC-ND) : Quentin Noirfalisse
Publié le
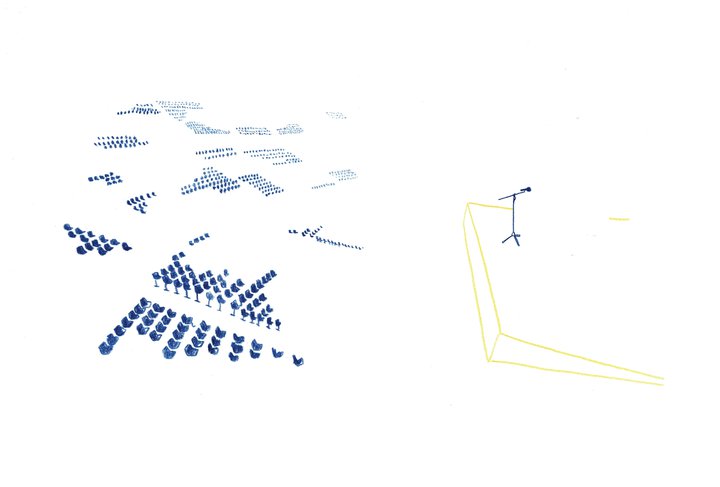
Dans la famille « culture », parent pauvre des politiques, les musiciens sont les fauchés parmi les fauchés. Comment est-ce possible ? Plus que tout autre art, la musique est omniprésente dans nos vies. Mais les artistes locaux ne tombent pas dans nos oreilles. Pourquoi ?
Les observateurs, tant au pays qu’à l’international, saluent la qualité et la créativité d’une scène musicale belge foisonnante. Et pourtant… Chez nous, survivre, c’est déjà pas mal. Voilà ce qui ressort des dizaines de documents compulsés et de la quarantaine d’interviews réalisées pour ce papier dédié aux musiques actuelles (soit tout sauf la musique classique). Artistes, mais aussi salles de concert, centres culturels, labels, tout le monde est frappé par le manque d’argent et de perspectives de promotion des talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). En première ligne, il y a les artistes, réduits au système D pour perdurer, dans un secteur qui peine à se structurer. Quel meilleur groupe pour tester cette loi de la jungle que… La Jungle ?
Le pire business plan de l’histoire
C’est l’histoire d’un groupe qui tourne. Une success-story. Celle de La Jungle, un duo montois de noise – et de niche – complètement psyché, encensé par la critique. « Le plus trippant et tribal duo du royaume », selon le Focus-Vif. Tout a commencé par un concert sur la scène alternative de La Faune, à Mouscron, en 2015. Puis, « comme une pandémie, ça s’est propagé », se marre Mathieu Flasse, le guitariste. Depuis, le groupe a sorti trois albums, en prépare deux autres, a lancé des remixes, composé des musiques de film. Et enchaîné plus de 450 dates. D’abord en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre. Puis dans les festivals, comme Dour, « où ils nous ont mis en avant, ça nous a permis d’aller en France et, via via, ça s’est enchaîné ». La Suisse, la Slovénie, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, le Royaume-Uni…
Le rêve, la vie de star, quoi… quoi ? Euh… C’est un peu plus compliqué en fait. Portés à l’origine par un réseau de lieux underground, fauchés mais solidaires, « où ça marche beaucoup par le bouche-à-oreille », les deux gars font tout en mode débrouille, du merchandising au pressage de disques, en passant par la salle de répet’, prêtée par le Rockerill (Charleroi). « Par choix, pour garder le contrôle », dixit Mathieu. Si La Jungle et son modèle de développement sont spécifiques, le groupe s’inscrit dans un paysage musical belge où la débrouille est la norme.
« Vous connaissez l’adage ? Un musicien, c’est quelqu’un qui transporte 5 000 € de matos dans une bagnole à 500 €, qui fait 500 km pour toucher 50 € en jouant devant cinq personnes. »
FACIR, la Fédération des auteur·ice·s, compositeur·ice·s et interprètes réunis, créée en 2013, a balancé ce pavé en pleine commission parlementaire, en 2017. Ce jour-là, elle tentait d’alerter sur les conditions de vie des artistes de musiques actuelles en FWB. Pour être sûr que tout le monde avait bien « saisi », le coup de gueule se précisait : « Imaginez que, dans le rock indépendant, un cachet moyen tourne autour de 350/400 € par concert, ce qui équivaut à 130 € facturés/personne pour un trio. 65 € dans la poche au final […] Ajoutez les dizaines de répétitions gratuites en amont et l’investissement dans le matériel, c’est le business plan le plus catastrophique de l’histoire du travail ! »
Exagéré ? Médor a lancé un appel à témoignages. Il confirme largement le constat. Pour vivre, les musiciens et les groupes jonglent avec diverses sources de revenus. Point commun : il n’y en a jamais suffisamment.
Les artistes musiciens qui décident de créer en seront pour leurs frais. C’est le cas de le dire. « Même si les coûts d’enregistrement ont énormément baissé, grâce aux home studios, beaucoup de musiciens puisent dans leurs économies pour enregistrer leur premier, voire leur deuxième ou troisième album », explique Anthony Sinatra, du label liégeois Jaune Orange.
Lola Bonfanti, autrice-compositrice bruxelloise qui manie la contrebasse, a déjà injecté 15 000 euros dans ses productions. Boris Gronenberger (River Into Lake, Grandpiano, ex-Girls In Hawaii) a touché 4 500 euros d’aide à la production pour le dernier projet de River Into Lake (20 000 euros). Sans même se payer, Boris a dû compléter. Son label est intervenu pour le pressage et la promo. « J’ai aussi récolté 6 500 euros en crowdfunding. Le reste, je l’ai fourni sur fonds propres, mes économies, mes autres boulots. »
Selon FACIR, les coûts de production pour la sortie d’un disque sur un petit label s’élèvent à 14 900 € pour des ventes estimées à 9 200 euros. Pour démarrer, faut se mettre dans le rouge.

Cachet dur à avaler
En parallèle des compos et des enregistrements, l’artiste doit se produire. La scène est reconnue comme une tranche essentielle des revenus. De là à dire que ça dégouline d’euros côté cachets, personne ne s’y est vraiment risqué durant notre enquête.
Retour avec La Jungle. Une idée des cachets ? « Ça tourne autour de 50 à 300 balles pour le groupe. Heureusement, eux ne sont que deux, enfin trois avec leur booker, pas un gars derrière son ordi, mais un pote qui vient partout avec nous. »
« Mais on peut aussi jouer pour 4 000 euros dans un festival ! » Tout n’est pas galère dans le navire musical. Des artistes confirmés, qui rencontrent le succès, évoquent des cachets de 2 000 euros en festival. Damien Aresta (It It Anita) parle d’une moyenne de cachets en 2019 de 1 500 euros.
Mais le décor général est clair. Confirmé par des dizaines de témoignages récoltés par Médor. Voici un aperçu : « Un concert au Botanique – pourtant une salle phare du pays –, c’est 700 euros, cinq sur scène et trois techniciens » (des contrats que nous avons consultés montrent des cachets oscillant entre 550 et 1 200 €). « Un musicien pop, ça touche entre zéro [mais chuuuut, c’est illégal, ça] et 300 [là c’est carrément Byzance, j’ai eu ça genre sept fois en 20 ans de concerts]. » « En général un musicien de jazz ça touche entre 50 et 150 euros par concert. C’est toujours en argent comptant ou en régime des petites indemnités [RPI], parce qu’un contrat, ça coûte trop cher aux salles… »
Toutes ces paroles viennent de professionnels, cherchant à faire de leur art un moyen de subsistance, pas de musicos amateurs.
Pour illustrer la dèche des musiciens, les chiffres de la Smart, entreprise intermédiaire entre employeur et employé, sont éloquents. Sur les 26 768 contrats de musiciens passés via Smart en 2019/2020, plus de 90 % enregistrent un tarif horaire moyen de 18 euros brut. Près d’un tiers des contrats annoncent 11 euros horaires. Brut.
La faute aux méchantes salles de spectacles ? Comme les musiciens, elles sont fauchées, tentent de se rattraper sur le bar, développent le bénévolat à l’extrême et paient comme elles peuvent. Souvent via le RPI, le régime des petites indemnités, un système de défraiement non taxé qui est réservé aux détenteurs d’une carte d’artiste et qui n’est pas considéré comme un salaire (lire notre enquête consacrée au RPI ici).
Où sont les salles ?
En Fédération Wallonie-Bruxelles, il n’y a pas que les cachets qui sont réduits. Les possibilités de jouer en live se comptent trop souvent sur les doigts de la main.
« Quand tu prends la route en Wallonie, bon courage, souligne Damien Waselle, directeur du label Pias Belgique. Le groupe qui commence à être confirmé, non seulement il ne pourra quasiment jamais rivaliser avec les grosses machines mondiales qui trustent les têtes d’affiche des festivals, mais, en plus, sa tournée locale, c’est quelques dates, au maximum : l’Eden à Charleroi, le Reflektor à Liège, l’Entrepôt à Arlon, le Delta à Namur et le Manège à Mons si t’as du bol, puis t’as déjà fini. »
Les artistes n’auront pas le choix : pour faire valoir leur talent et exploser, « il faudra surtout s’imposer en France, face à une concurrence locale rude, ou en Flandre, où, à même niveau de qualité, le public se tournera plutôt vers un groupe du cru », constate Damien Waselle.
A contrario, la Flandre, pour qui la culture est depuis des décennies un ciment identitaire fort, bénéficie d’un réseau de centres culturels bien connectés et remplis. Jean-François Assy a été le violoncelliste/bassiste de Bashung, Daniel Darc, Christophe. En 2011, il a accompagné l’artiste belge Daan pour défendre son album « Simple », qui a cartonné avec plus de 25 000 ventes : « On a fait 120 dates en Flandre, surtout dans les centres culturels. On a joué tous les cinq kilomètres dans une salle moderne de 200 à 600 personnes. » Une tournée improbable à ce jour au sud du pays : toutes les villes wallonnes n’ont pas la chance d’avoir des salles de 900 places comme au centre culturel de Tongres…
Reste le rêve ultime qui est aussi la seule façon, pour beaucoup, de vivre de leur musique : se faire adopter à l’étranger. Julien Fournier peut en parler. Il dirige WBM (Wallonie-Bruxelles Musique), l’organisme chargé de valoriser les artistes musicaux à l’international. Quand on l’interroge sur ce qui coince, il pointe le manque d’entreprises d’accompagnement d’artistes aux reins solides, capables de capitaliser et de faire émerger un véritable secteur : « Actuellement, le secteur est plus proche d’un artisanat professionnel que d’une industrie. Les artistes s’autogèrent souvent. » Ce qui complique leurs possibilités de s’exporter.
Des followers, mais pas de managers
Si l’argent et les salles manquent, c’est donc aussi vrai pour… l’encadrement des artistes. Damien Waselle peine à citer plus que quelques managers réellement actifs côté francophone.
Le rappeur carolo Mochélan, qui a pourtant raflé tous les prix des tremplins musicaux en FWB, n’a jamais su « bien » s’entourer à ses débuts. « Pourtant c’est LA bonne question : comment fait-on pour trouver un manager ? »
Alex Davidson est l’un des rares à exercer ce métier de manager musique côté francophone : « On a un pays divisé, dont l’assiette financière potentielle est tellement petite qu’il est difficile d’en vivre. Les managers, comme les bookers, vivent de pourcentages sur les revenus des artistes. Ce sont des intermédiaires comme les autres, mais dans un secteur très limité et qui a du mal à s’organiser. » Souvent isolés, les métiers destinés à accompagner les artistes sont aussi fragilisés par une lame de fond : « On aimerait faire croire aujourd’hui qu’un artiste doit tout faire lui-même, que les intermédiaires sont dispensables. Tous les musiciens que je connais ne sont pas armés pour être entrepreneurs. C’est une idée fausse, qui est très grave d’un point de vue politique. Cette tendance est née de la chute des ventes de disques qui a amené les grosses structures à saisir cette occasion pour laisser les artistes se débrouiller. »
La nouvelle génération a même quasi « intégré » qu’il fallait se démerder seul. Makyzard occupe un bon poste d’observation pour constater le phénomène. Ce Bruxellois aux talents multiples s’occupe d’ateliers d’écriture d’un chantier rap à l’association culturelle et d’éducation permanente « Lézards urbains ». « Internet a complètement changé la donne. L’artiste en herbe balance un clip sur YouTube et scrute un résultat. Un truc reggaeton, un afro, un rap en espérant qu’un style fonctionne. Du coup, où est la démarche artistique, la singularité du projet ? C’est un débat difficile à lancer avec les jeunes. Ils n’essaient pas de développer un univers, ils ont envie de remplir Instagram, d’avoir des followers. Et les programmateurs de festivals te demandent le volume de ton réseau. Tu te dis, c’est quoi le lien entre ma musique et ça ? »
Donner peu, à beaucoup
Face aux lacunes du secteur, que fait le politique ? Il manie à travers la technique du saupoudrage un budget de 4,5 millions d’euros annuels consacrés aux musiques actuelles dans le cadre de ses aides aux arts de la scène.
Au niveau de la création, les artistes peuvent déposer trois fois l’année des projets de résidence, d’enregistrement ou, en bout de course, d’aide à la promotion de leurs albums.
En 2019, 89 aides au projet ont été accordées à des musiciens. Total : 423 100 €. Soit 4 754 € en moyenne par projet. En 2020, l’enveloppe pour les projets a été portée à 654 000 €. À titre de comparaison, dans un autre secteur, le documentaire audiovisuel, un auteur pourra toucher 7 500 € d’aide pour l’écriture, et son producteur 20 000 € pour le développement du projet, avant de le tourner.
Le reste de l’enveloppe part à destination des opérateurs de musique actuelle à travers des contrats-programmes ou d’une aide pluriannuelle de deux à trois ans. En 2017, ils étaient 65 à se partager une enveloppe de 3,2 millions d’euros. Parmi eux, 30 festivals, des associations de promotion de la scène locale comme les Lundis d’Hortense, le Studio des variétés ou Court-Circuit et 15 labels ou structures d’encadrement comme les labels Jaune Orange ou Crammed Discs. Un budget pas vraiment ébouriffant quand on sait que l’Opéra royal de Wallonie engrange à lui seul 15 millions (mais emploie près de 300 personnes en CDI).
4,5 millions d’euros, est-ce une goutte d’eau dans l’océan ? « À titre de comparaison, la musique classique reçoit chaque année environ 33 millions d’euros [sur un budget Culture de 289 millions], dont la majeure partie va aux grandes institutions, et le théâtre reçoit plus de 40 millions, explique Fabien Hidalgo, musicien et coordinateur de FACIR. Un système d’aides revalorisé permettrait des productions musicales plus ambitieuses, avec plus de visibilité et de programmations. »
À ces budgets, il faut ajouter le montant alloué au Botanique, soit trois millions d’euros pour organiser 200 concerts par an, dont 70 d’artistes de la Communauté française, que ce soit en tête d’affiche ou en première partie. Par ailleurs, le Conseil de la musique obtient un peu plus de 900 000 € pour organiser toute une série d’activités : donner du conseil aux musiciens, gérer l’Intégrale de la musique (la base de données du secteur), éditer le magazine Larsen ou organiser des concerts à la Maison de la musique.
La ministre de la Culture de la FWB, Bénédicte Linard, assume pleinement la ligne politique en vigueur côté francophone, souvent opposée à celle de la Flandre. « La Flandre veut sortir chaque année quelques grandes stars et peut-être moins travailler sur la diversité. Je ne juge pas. En Fédération Wallonie-Bruxelles, nous voulons permettre des projets avec une ligne éditoriale forte. Des musiques alternatives que nous soutenons trouvent leur place à l’étranger. Nous voulons soutenir la diversité, l’accessibilité et l’émergence des artistes. »
Structure appréciée des musiciens que nous avons interrogés, Wallonie Bruxelles Musique s’est donné comme priorité d’aider le secteur à se développer, en soutenant les métiers accompagnants. Comprenez les managers, bookers, directeurs artistiques. Julien Fournier, son directeur, décrit lui aussi un choix flamand « plus libéral », qui « mise sur quelques champions », mais où il ne « fait pas mieux vivre pour l’ensemble des musiciens ». Et dissèque une autre différence entre Flandre et FWB : « La Flandre a un mégapôle qui s’occupe de tout à la fois, de la formation de jeunes musiciens au travail avec les managers en passant par le réseautage. Nous avons davantage de structures distinctes [comme le Conseil de la musique, Wallonie Bruxelles Musique, Court-Circuit, par exemple, NDLR]. Leur force : elles sont plus spécialisées et épaulent les artistes à des moments différents de leur carrière. Leur faiblesse : il faut pouvoir les faire communiquer toutes entre elles, ce qui ne se passait pas toujours avant. Au fil du temps, on se parle beaucoup plus. »
Art et Survie
Soutenir au large mais avec des moyens faibles. Toute l’ambivalence de cette politique se révèle dans les rapports annuels des Tournées Arts et Vie. Ou plutôt Art et Survie. Il s’agit d’un dispositif qui vise à « favoriser la programmation de spectacles vivants de qualité » dans des lieux culturels de la FWB, par l’octroi d’une subvention par représentation. Arts et Vie soutient financièrement un vaste catalogue d’artistes (pas que des musiciens), surtout dans les centres culturels.
Mais pas de quoi fanfaronner. Ce dispositif a investi 1 322 095 euros en 2018. Soit à peine 90 000 € de plus qu’en 2003, une augmentation qui ne permet pas d’être raccord avec l’évolution du coût de la vie. Avec une moyenne d’intervention de 467 euros, supposés couvrir au maximum 50 % du cachet, il vaut mieux ne pas être de trop sur scène…
Côté flamand, avec des lieux capables d’accueillir plusieurs centaines de personnes, un musicien peut espérer, sur une année où son groupe n’a pas de tournée, ramener jusqu’à 30 000 € de revenus de sa tournée en centre culturel. Un vœu pieux, actuellement, en FWB.
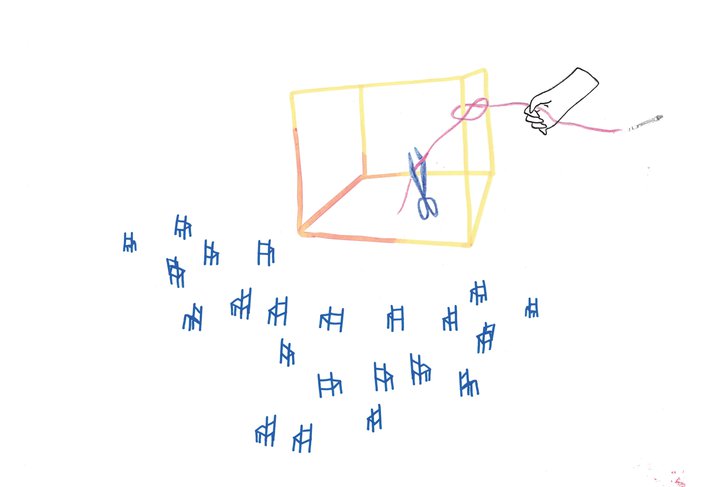
Les ondes brouillées
Pour que les salles se remplissent… encore faut-il être connu du public. Pour ça, un bon moyen, c’est de passer à la radio. Le rappeur carolo Mochélan a « fait » les Francofolies de Spa, Esperanzah, et pourtant… il n’est quasiment jamais passé à la radio.
« Je me souviens très bien d’une programmatrice d’un centre culturel francophone, qui, suite à un tremplin musical, nous programme. Les réservations ne suivent pas, on finit par jouer devant 50 personnes. À la fin, elle me dit : “J’adore ce que tu fais, mais tu reviendras quand tu passeras à la radio.” Cette phrase résume tout. »
La complainte revient sans cesse, tel le refrain d’un disque rayé : la RTBF n’en ferait pas assez pour la promotion des artistes locaux, malgré l’article 8 du contrat de gestion qui veut que le service public soit un « vecteur et un facteur de création, de diffusion et de promotion artistique et culturelle ».
La chaîne publique réfute l’absence de soutien aux artistes émergents. Chiffres à l’appui fournis par la maison : « Ces cinq dernières années, 1 828 artistes différents de la FWB ont été diffusés sur les ondes d’une de nos radios. La RTBF annonce aussi 175 concerts ou showcases diffusées en 2019, dont 100 d’artistes locaux. »
Et mieux, les choses s’améliorent, clame Frédéric Gérand, responsable de la stratégie musicale des radios RTBF : « Avec le coronavirus, on a pris une volée de bois vert [la RTBF avait programmé des musiciens belges entre 5 h et 6 h du matin pour les “soutenir”, une heure plutôt matinale qui a donné l’impression de caser les “Belges” dans la nuit, NDLR]. Fait-on vraiment notre boulot ? On a lancé une enquête en interne pour voir comment soutenir davantage. » Pour lui, depuis cette crise, « quelque chose s’est enclenché, un nouveau lien entre le monde de la musique et la RTBF. Il y a un vrai engagement, une vraie volonté. On ne peut pas enlever cela à nos programmateurs ».
La RTBF a par ailleurs rencontré David Dehart, de Court-Circuit (fédération d’organisateurs de concerts), pour appuyer la présence des artistes locaux sur les ondes.
Et puis il y a Jam, la radio que Bernard Dobbeleer a créée avec le soutien (mais sans les moyens) de la RTBF. « On est ravi que Jam existe, mais c’est insignifiant en termes d’audience, cela n’a pas d’influence sur des places de concert », souligne David Salomonowicz, attaché de presse et responsable com pour Esperanzah.
D’autres acteurs de la filière s’interrogent sur un manque d’ambition de la chaîne publique. Tom, tôlier du Water Moulin, lieu phare de la scène underground tournaisienne, s’interroge : « À la radio flamande, Stu Bru, ils passent des trucs qui arrachent en plein aprèm. Ils encouragent vraiment la culture musicale. Nous on a quoi ? Tipik ? Et avant, Pure FM ? Si les radios publiques n’encouragent pas la diversité musicale, c’est normal que les Belges francophones n’écoutent pas leurs groupes. »
Baston sur les quotas
Par leur contrat de gestion, les chaînes publiques sont tenues de passer 12 % de chansons de musiciens de la FWB. La RTBF s’en sort haut la main. Son pourcentage d’artistes FWB (moyenne 2016-2020, chiffres fournis par la RTBF) culmine à 17,70 % (La Première), 19,70 % (Pure/Tipik) ou 13,60 % pour Vivacité.
Pourtant les dents grincent. C’est un des grands combats de FACIR : « La FWB est l’une des régions d’Europe qui écoute le moins son répertoire local. En France, en Allemagne ou en Italie, la part d’artistes locaux sur les ondes avoisine, voire dépasse les 50 %. »
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui calcule et contrôle les quotas, la situation s’est fortement améliorée à la RTBF. Finie l’époque pas si lointaine où le quota était écoulé pendant la nuit. Reste l’enjeu de la diversification. Parce que mettre Stromae ou Angèle en boucle ne va pas aider l’émergence des artistes. Xavier Jacques-Jourion, responsable de l’unité Radio au CSA, estime que codifier la diversité des chansons hors Top 100 est « difficile à formuler et à mettre en œuvre d’un point de vue du cadre légal. Le défi est de formuler les choses de façon à produire un outil décrétal avec les effets escomptés. Un quota sur des œuvres récentes ne résoudra pas la question du succès ou pas ».
À parler tout le temps de la RTBF, on en vient à oublier que le paysage audio est constitué d’autres acteurs importants. Les quatre radios les plus écoutées sont Nostalgie, Vivacité, Radio Contact et Classic 21. Jam, elle, représente 0,03 % des audiences…
Ces radios sont aussi celles qui sont le moins encouragées à passer nos musiciens. Nostalgie ? 6 %. Contact ? 8 % avec un seuil minimal de 6 %.
À chaque fois que, dans ce dossier, de bonnes pratiques ont été citées, les regards se sont tournés vers la Flandre. Là-bas, on ne chipote pas. Le quota pour les radios publiques culmine à… 25 % !
Mieux, BX1+, la radio de la télévision locale bruxelloise BX1, affirme diffuser… 100 % d’artistes de la FWB ! Impossible de vérifier, en tant que radio web, elle n’est pas tenue par un quota du CSA. Jean-Jacques Deleeuw, directeur de l’info, a supervisé le projet né il y a un an et demi. Ce 100 % local « correspondait à notre objectif de mission de service public et notre volonté de nous démarquer des autres radios et webradios » assure-t-il. « C’était donc dans notre dossier plan de fréquence remis au CSA. » Quand BX1 embauche Sébastien Van Mulders pour gérer la programmation, il lui annonce tout de suite la couleur. Peur du 100 % FWB ? Pas du tout. « On diffuse sept genres : pop, electro, musique urbaine, classique, jazz, musique française et du monde. Et pas besoin de faire tourner les mêmes disques en boucle, je n’ai aucune difficulté à programmer des artistes de qualité. J’en découvre tous les jours. » La preuve que le talent ne manque pas et que le 100 % n’est pas une utopie. Du 15 % local, ce ne serait pas un peu chiche pour finir ?
La ministre de la Culture Bénédicte Linard, qui a aussi les Médias dans son portefeuille, se dit « très ouverte sur la question des quotas ». Au moment de boucler ce dossier, un nouveau décret passait en deuxième lecture au gouvernement (autant dire que c’est bingo) : « Avec ce décret, on passe à une obligation globale de 6 à 8 % pour les radios indépendantes, et 10 % pour les radios en réseau, sur une période transitoire de cinq ans. Parce que si on se rend compte que l’on peut aller plus loin, on veut se laisser la possibilité de le faire. »
Un problème de fierté
Le constat d’une Belgique francophone pas assez fière ni revendicatrice de ses talents revient dans – presque – tous les entretiens. La question de l’identité culturelle belge francophone est complexe. Mais le constat est, lui, plus simple. Le public francophone se bouge moins pour ses artistes que leurs concitoyens flamands. Que Nostalgie et Classic 21 soient parmi les radios les plus écoutées en dit long sur la curiosité du public.
Damien Waselle (Pias) se souvient avoir sorti le même mois, en 2015, les albums de Balthazar et Roscoe, un groupe flamand et un groupe wallon. « On a eu un accueil presse identique, assez favorable. Mais, à la fin, pour un album de Roscoe vendu, j’en écoulais cinq pour Balthazar. Pour deux projets qui, selon moi, ont une qualité, une identité similaire. »
Au Water Moulin, le public est composé pour une grosse moitié de Français. Un peu de Flamands aussi. Mais seulement un tiers de Belges francophones. « Par contre, ce sont essentiellement des Tournaisiens qui viennent à nos projections ciné » explique Tom, responsable du lieu.
Comment expliquer que les Belges francophones boudent leurs artistes ? Céline Magain, codirectrice de Francofaune, festival qui vise à soutenir la « biodiversité musicale », ouvre quelques champs de réflexion : « Je crois que c’est un terreau global qui manque. Il y a la question de ce qu’on passe à la radio, bien sûr. Ensuite, la façon dont on éduque les enfants à la culture est une question fondamentale. La musique classique est vue comme quelque chose d’essentiel. Pas le reste. Quant aux centres culturels, ils sont censés être dédiés à la culture de proximité. Il y en a 118 sur le territoire. Lesquels d’entre eux portent l’étiquette musique ? Ils se comptent sur les doigts de la main. On peut se dire que c’est à cause du manque de public, mais tout est lié, c’est un cercle vicieux. »

Offrir du temps
Au final, labels, salles de concert, manager, bookers, tous sont fauchés. Et, évidemment, l’artiste aussi. Une des premières choses à faire serait d’augmenter l’enveloppe réservée aux musiques actuelles. Bénédicte Linard, la ministre de la Culture (Écolo), entend augmenter le soutien au secteur. « On pourrait revoir le pourcentage de la subvention allouée aux artistes », avance-t-elle.
Elle affirme vouloir aller plus loin et permettre aux artistes « d’avoir le temps de créer et, aussi, de ne pas créer ». Elle aimerait intégrer cette notion d’intermittence dans la refonte du statut d’artiste. Pas l’intermittence à la française, mais la possibilité de disposer de temps de création soutenu par l’État. Pour y parvenir, il faudrait par exemple ne plus lier le statut d’artiste à des logiques rigides de revenus et de jours prestés.
Prendre le temps pour créer, c’est ce qu’a choisi le groupe Girls in Hawaii. Ils alternent une grosse tournée d’une centaine de dates avec un processus créatif de deux, trois, quatre ans. Période pendant laquelle le groupe ne joue quasi pas, tout en développant d’autres projets. « Si le groupe tient depuis 15 ans, c’est aussi parce qu’on se permet ces phases de création, avec leurs hauts et leurs bas », explique le chanteur Antoine Wielemans. Mais il faut que le (gros) succès soit au rendez-vous. Et encore… Les six musiciens de GIH ont le statut d’artiste. Ils ont envisagé de créer une SPRL, de mettre de l’argent de côté avec les tournées qui ont bien marché, mais impossible de permettre six salaires permanents tout le long de la création d’albums.
Même le succès ne serait pas une solution à l’intermittence…
La ministre pointe également des virages clés de la législature à bien négocier : le contrat-programme de la RTBF et la renégociation fin 2022 des conventions et des contrats-programmes des festivals. Ces contrats intègrent des quotas d’artistes de la FWB à faire jouer.
D’autres idées ont été avancées par nos interlocuteurs : instaurer une TVA à 6 % sur les disques et vinyles comme pour les livres, réduire drastiquement le montant des RPI pour marquer la différence entre amateurs et pros, ou obliger ceux qui payent en RPI de s’identifier publiquement. L’objectif serait d’empêcher que des employeurs culturels abusent de ce système pour payer de façon récurrente des artistes sans s’acquitter de charges sociales.
Sécurité pour créer
Électrocuté par le Covid, le secteur y a trouvé l’énergie pour enfin se fédérer.
Rassemblant tous les acteurs de la musique actuelle, le Comité de concertation des métiers des musiques actuelles (CCMA) a vu le jour. La pandémie a aussi engendré des nouveau-nés comme la Fédération des bookers et managers unis (FBMU) ou l’Union des attaché·e·s de presse indépendants de la musique en FWB (UAPI). Dernière naissance en date, la Fédération des festivals de musique en Wallonie et à Bruxelles (FFMWB ASBL), en novembre.
Ce foisonnement prouve que les acteurs s’accordent sur une chose : il est temps de s’organiser pour faire émerger un secteur solide, capable de porter des artistes. Et de les rassurer sur leur avenir ?
En septembre 2020, FACIR et Capitane Records ont organisé une conférence intitulée « Pour une sécurité sociale de la culture et un vrai statut des travailleurs et travailleuses culturels ». Le chanteur Nicolas Michaux explique : « Nous sommes dans un état de culpabilité permanente, de mendicité et de justification par rapport aux marchés. Notre rêve n’est plus d’être connus, mais de sécuriser les parcours de vie. » Une sécurité qui sortirait la musique d’une vision utilitariste et/ou économique, permettant aux artistes d’explorer et de découvrir pour mieux nous nourrir. « Sinon on va terminer avec une production d’une docilité sans nom, avec des artistes auto-entrepreneurs qui copient ce qui marche. » Et ruinent la diversité.





